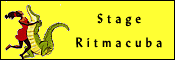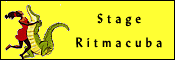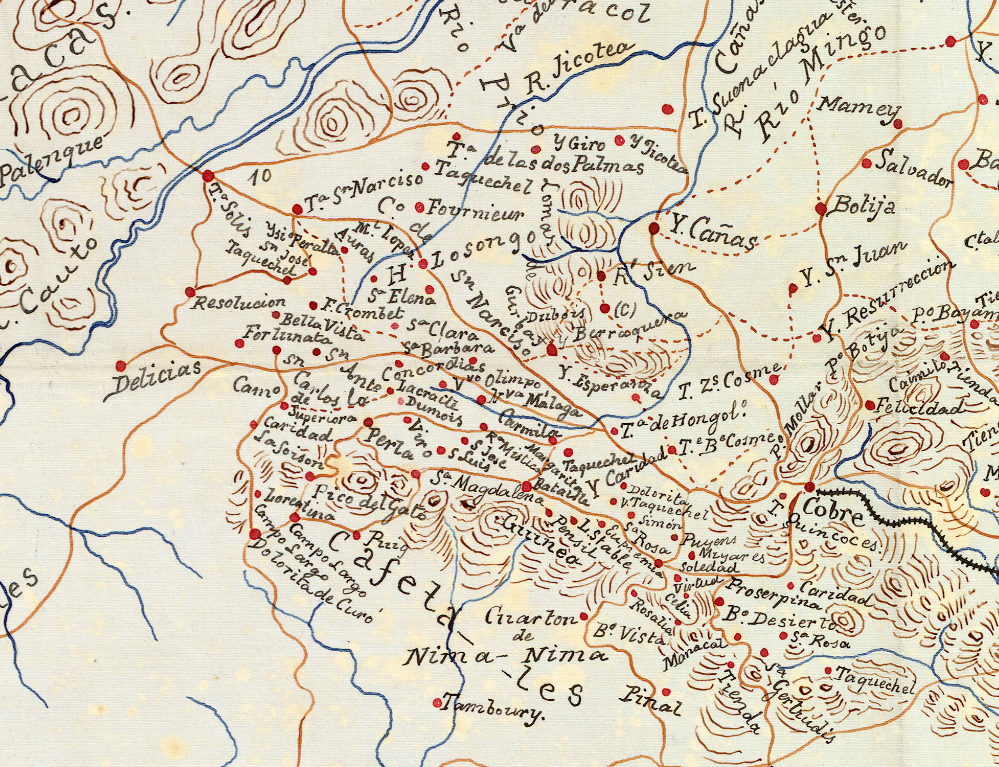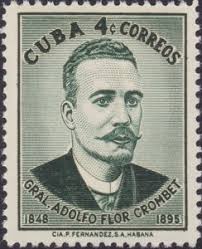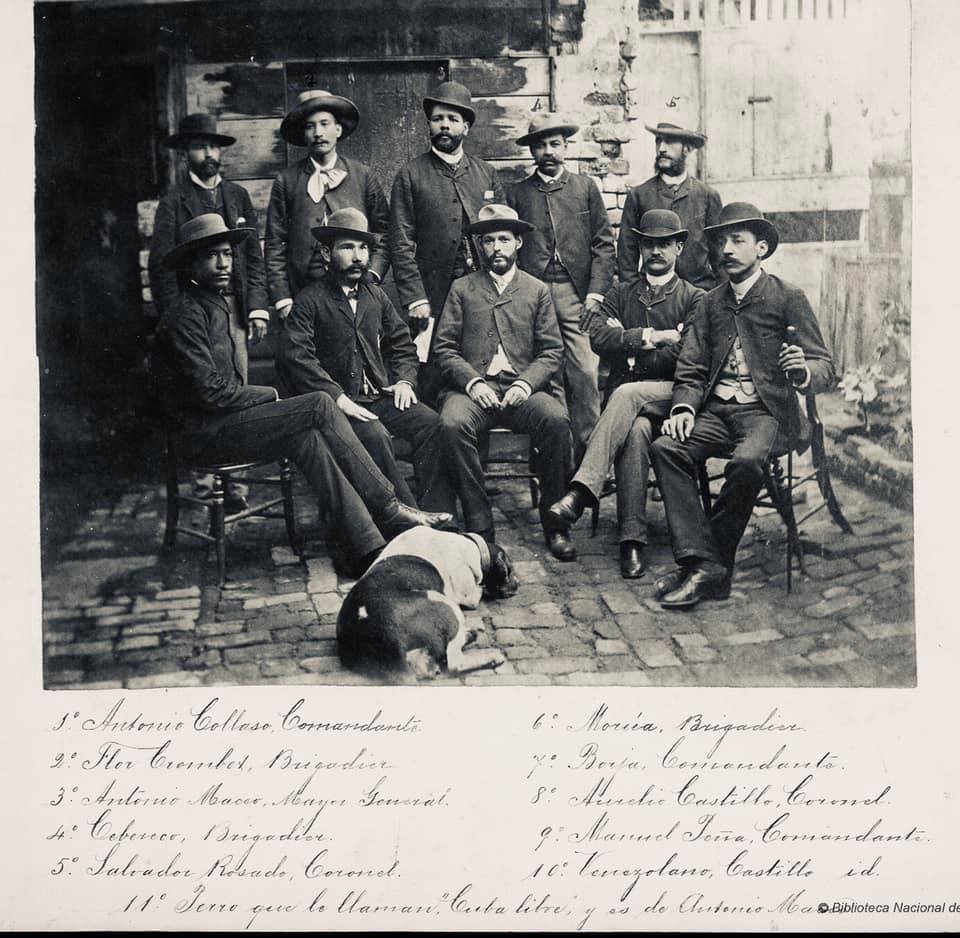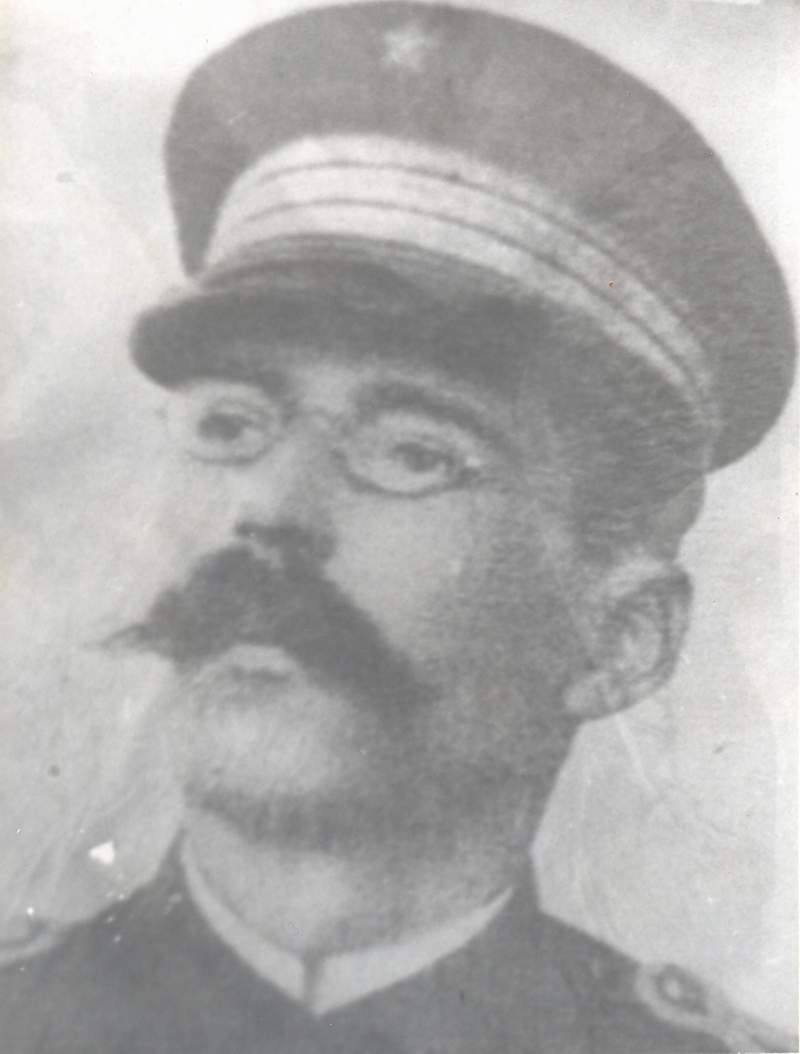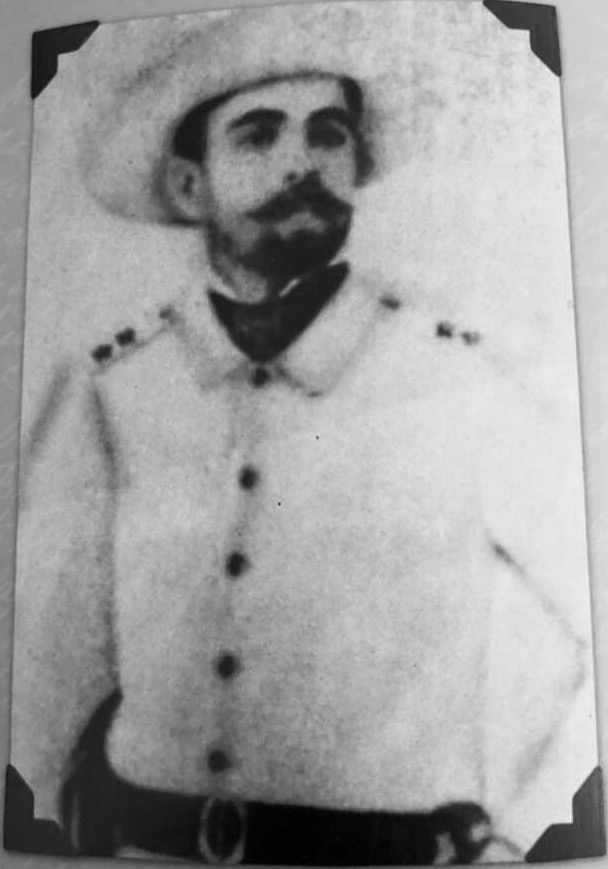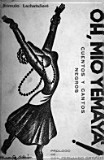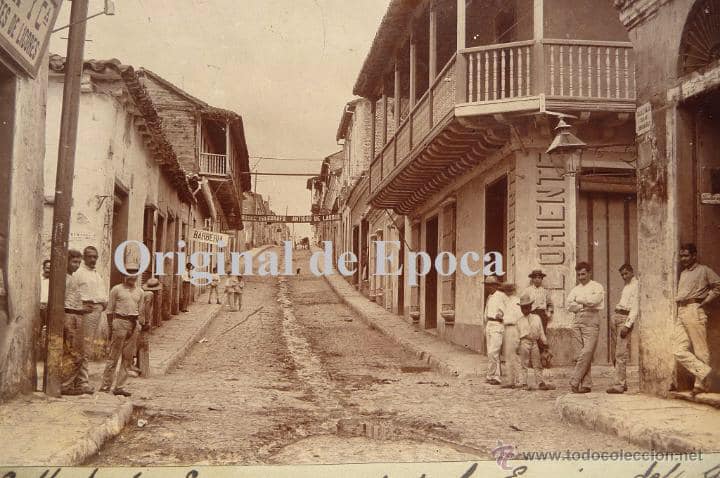DU
« PETIT FRANÇAIS » FILS
D'ESCLAVE ET DE COLON,
LE GÉNÉRAL INDÉPENDANTISTE FLOR
CROMBET
À SON PETIT FILS,
ROMULO
LA CHATAIGNERAIS
PIONNIER DES ETUDES AFRO-CUBAINES

 Flor
Crombet, Romulo Lachatañere
Flor
Crombet, Romulo Lachatañere
Préambule
: La version initiale de mai 2020 de cet article a été
écrite indépendamment de l'ouvrage d'Alfred Conesa Le baiser de
Cuba, un destin français sur le chemin de l'indépendance cubaine.(éd.
ErickBonnier 2019). L'accès à des sources familiales inédites, le
secours du petit-fils de Flor, l'officier cubain Hugo Crombet
permettent, à la suite de ce livre et du dévoilement d'un secret
familial, de renouveler la version jusqe là diffusée sur la
naissance de Flor dans une des plantations des Crombet. Nous avons
été amenés en conséquence à la modifier sur ce point.
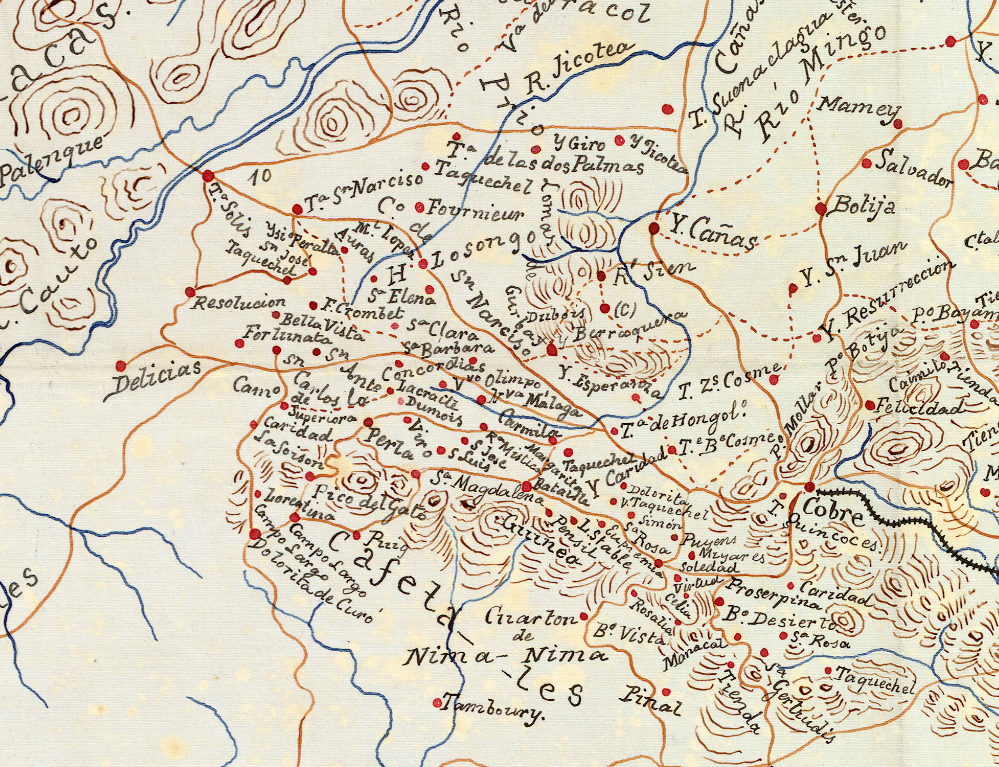 Carte
du 19e siècle de Hongolosongo ("H Losango") avec certaines de ses cafetales
signalées par un point rouge (cf
Bella Vista et "F. Crombet" de la famille Crombet, Lacraite...).
Extrait de carte.
Carte
du 19e siècle de Hongolosongo ("H Losango") avec certaines de ses cafetales
signalées par un point rouge (cf
Bella Vista et "F. Crombet" de la famille Crombet, Lacraite...).
Extrait de carte.
1.
LE « PETIT FRANÇAIS » FILS D?ESCLAVE, LE HÉROS CUBAIN FLOR CROMBET
Flor
Crombet est né le 22 novembre 1850 dans la caféière La Fraternidad (nous
pensons cette date plus crédible
que le 17 septembre 1851 indiquée dans d'autres publications). Cette
caféière du quartier de Hongolosongo, près d'El Cobre, détruite
aujourd'hui, ne doit pas être confondue avec la caféière La
Fraternidad de Ramón de Las Yaguas récemment restaurée. La famille
paternelle de Flor Crombet est française, son grand-père José
Marcelo Crombet est venue de l'île de La Grenade (qui a été par deux
fois française entre 1690 et 1785), vers 1796. Ce dernier a eu neuf
enfants d'un premier lit et autant d'un second lit. Autant dire que
diverses plantations se côtoient dans le quartier de Hongolosongo,
appartenant à ce clan des Crombet : Josefina qui deviendra La
Fraternidad, Bella Vista, La Ninfa, Georgina, La Turbia... Bella
Vista, une des grandes caféières « de Français » répertoriée,
située à environ 450 m. au dessus de la mer, est connue
localement pour son « minaret » qui domine toujours le paysage
environnant (cf. carte).
Le frère aîné du premier lit du patriarche,
Francisco Xavier joue à son tour le rôle de chef de famille. Ici
commence un secret de famille très tardivement révélé. Un frère de
Francisco, José Marcelo vient de sa plantation de La Turbia pour le
charger d'accueillir sa favorite, une esclave mulâtre de sa
propriété enceinte de ses oeuvres, Colombina. L'enfant,
explique-t-il, ne peut pas naître à La Turbia dans la demeure de
l'épouse légitime, Josefina, laquelle doit donner naissance la même
année à un fils légitime (celui-ci s'appellera Eugenio Crombet), ni
non plus être reconnu par José Marcelo. Francisco Xavier accepte de
recueillir la future mère. Mais deux ans plus tard il meurt du
choléra. Dans son testament, le père adoptif Francisco
déclare avoir deux enfants naturels, Manuel et « Flores ». On
sait ce qu'il en est : ce dernier est le fils de Colombina et
est reconnu par Francisco sous le nom de Francisco
Adolfo Crombet.
Mais, peu après la naissance, le père biologique, José Marcelo
ramène Flores à La Turbia (après avoir demandé que Colombina
quitte La Fraternidad) et le confie à une créole blanche María
del Rosario, qui a perdu sa propre fille. María élève
l'enfant qu'elle n'appelle plus que Flor et le familiarise à
la production agricole sur son lopin de terre. Un oncle
paternel, Manuel Crombet, le parraine et contribuera à sa
bonne éducation.
 Du
côté de Hongolosongo
Du
côté de Hongolosongo
Quand notre héros se mariera au Costa Rica (où il a dû s'exiler pour
échapper aux autorités coloniale) en 1892 il dit s'appeler Adolfo
Flor Crombet Tejera, ayant adopté comme nom maternel, en geste de
reconnaissance, le nom de sa mère nourricière. Mais déjà il n'est
connu exclusivement que comme Flor Crombet.
Le jeune métis reçoit la meilleure éducation dans la plantation
familiale et s'y relaient des professeurs de la communauté
française. Au français et à l'espagnol s'ajoutent l'enseignement de
l'anglais et de l'italien. Il devait aussi parler le créole qui
servait de langue de communication dans ces plantations.
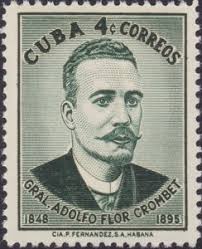
Au moment du soulèvement indépendantiste en 1868, à 17 ans, après de
premiers faits d'armes, il intègre une « compagnie » indépendantiste
nommée « La Francesita » (La petite française), aux côtés du
commandant Prudence / Prudencio Coureaux (plus âgé que lui, mais
qu'il connaît depuis l'enfance), de son frère (légitime) Emiliano
Crombet et des ex-esclaves libérés Camilo Crombet, Noel Crombet
& Cefiro Coureau. On dit que, faute de posséder un drapeau des
insurgés, La Francesita utilisa au combat un autre drapeau
républicain, le français. Emiliano meurt en janvier 1872 dans
l'attaque d'une caféière défendue par l'armée espagnole, l'Eden.
Des confusions ont pu être faîtes entre ce frère Emiliano et son
cousin Emiliano Crombet Philipon (né en 1845), également du
municipio d'El Cobre, combattant des trois guerres et nommé colonel
en 1878. Flor combattra sous les ordres de cet aîné en 1870.
A la mort du commandant Coureaux, la compagnie est dirigée par Flor,
elle s'agrandit de nouveaux membres et il change son nom, elle
devient « La Criolla » (La Créole).
Le président de la République en arme Carlos Manuel de Cespedes, qui
a lui-même libéré ses esclaves et les a enrôlé dans la guerre, le
décrit dans une lettre de 1872 comme un «francesito » (petit
français) créole, grand et fin, très élégant et sympathique ; il
promet d'être un de nos meilleurs chefs». Cet irréductible gagne ses
galons sur le champ de bataille et participe en effet aux trois
guerres d'indépendance, en unissant ses efforts avec le général
Antonio Maceo. Il refuse tout contact avec l'ennemi et fait même
reproche à Maceo d'avoir envisagé des pourparlers dans la guerre des
dix ans.
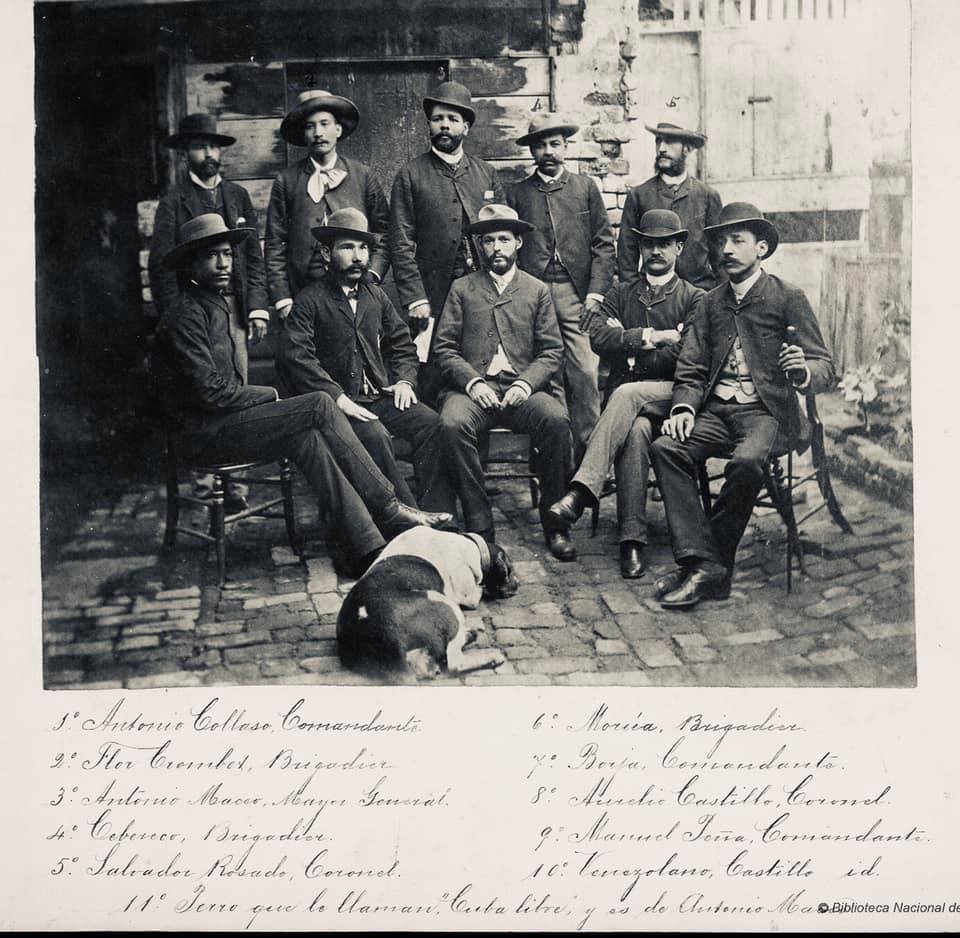 Leaders
cubains (1895) avec de gauche à droite et de haut en bas :
Commandant Antonio Collazo, Général Flort Crombet, Général Antonio
Maceo, Général Cedreco, Colonel Salvador Rosado, Général Morua,
Commandant Borja, Colonel Aurelio Castillo, Commandant Manuel Peña,
Commandant Castillo... et le chien d'Antonio Maceo appelé "Cuba
libre". (N.
B. : dans l'original brigadier
est pour "général de brigade").
Leaders
cubains (1895) avec de gauche à droite et de haut en bas :
Commandant Antonio Collazo, Général Flort Crombet, Général Antonio
Maceo, Général Cedreco, Colonel Salvador Rosado, Général Morua,
Commandant Borja, Colonel Aurelio Castillo, Commandant Manuel Peña,
Commandant Castillo... et le chien d'Antonio Maceo appelé "Cuba
libre". (N.
B. : dans l'original brigadier
est pour "général de brigade").
Issu
du monde des caféières françaises de Cuba, le
paradoxe est qu'il participe aux combats qui
aboutisent aux premières destructions par le
feu des cafetales des Français,
quasi-généralisées au fil de la guerre,
entre assauts et politique de la terre
brûlée. Tandis
que Gomez et Maceo ont établi leur base d'opération
dans la caféière Aguacate du Mont Taurus (Monte Rus)
dans l'actuelle Province de Guantanamo, il participe
contre
les troupes espagnoles
entre
autres aux prises de
Nueva
Málaga, La Dorotea (1868), La Matilde, La Aurora
(1869), El Cristal, gagnant ses galons un à un et,
déjà comme commandant, il est victorieux à la cafetal
La Indiana (1871). A 27 ans, il devient le plus
jeune des généraux de la première guerre
d'indépendance. Une photo le montre à la droite du
"géant" Maceo avec un port de chapeau faisant penser
à un fier vigneron du Languedoc et une lavalière
très "fleur au fusil". La moustache cache une
cicatrice à la lèvre supérieure issue d'un
combat.
 Maceo
et Crombet dans la série télévisée "Duaba.
La Odisea del Honor"
Maceo
et Crombet dans la série télévisée "Duaba.
La Odisea del Honor"
En
1895, il a le commandement de la goélette qui
ramène du Costa Rica à Cuba les frères Antonio et
José Maceo. Une fois effectué ce qui sera connu
comme le débarquement de Duaba, il cède
logiquement le commandement au prestigieux Antonio
Maceo.
Dans ce débarquement de 23 hommes, figure, entre
autres héros, un colonel très proche de Maceo, le
"negro frances"
(Noir français) Aquiles Duverger Lafargue (dit
Arcid...),
d'une famille de propriétaires de petite
plantation de café originaire de Saint-Domingue,
installée à Palmar de Yateras. Combattant des
trois guerres d'indépendance, ce dernier mourra en
1995. "un des chefs les plus intrépides des fils
de Guantanamo, déclara Maximo Gómez.
Les débarqués progressent ensemble vers le Sud,
puis se divisent en deux colonnes. Flor, qui est
accompagné de José Maceo, mourra au combat peu
après, des mains de descendants amérindiens
combattants du côté espagnol. José Maceo s'en sort
de justesse en sautant dans un précipice. De son
côté Antonio Maceo,se dirigeant vers l'Ouest,
opère une jonction qui lui permet de conduire
"l'invasion" de l'Ouest du pays.
Le corps de Flor avait été ramené à Yateras par le
groupe d'amérindiens. A La Felicidad, plantation
devenue quartier général des Espagnols, un
planteur français nommé "Tomás Rosseaux"
(peut-être Rousseau par rapport aux patronymes
repérés) l'identifie, il l'avait rencontré dans
une mission de Flor à Paris. Les planteurs Enrique
et Felix Lescaille se chargent de l'enterrer dans
le cimetière de la plantation Jaguey près de
Felicidad (CONESA pp.188-189). Enrique Lescaille
était propriétaire de L'Hermitage /El Hermitaño
(la même propriété où s'installera au XXe
siècle René
Bénégui).
Felix Lescaille fréquentait la même loge
maçonnique que Flor. Lui qui avait servi sous les
ordres d'Antonio Macéo pendant la guerre des dix
ans, avait changé de camp et avait organisé les
escouades d'amérindiens chargés de traquer les
rebelles.
Un fils de Flor Crombet était né au Costa Rica. ll
reviendra au petit-fils de Flor Crombet, Hugo
Crombet, lui aussi né dans ce pays, mais dont la
mère rejoint ensuite Santiago de Cuba avec sa
progéniture, ce qui a permis à Hugo de devenir
colonel cubain et de faire le récit du
débarquement héroïque de son grand-père dans un
livre intitulé La Expedición del Honor.
Ce récit sera à son tour magnifié en 2013 dans une
série télévisée cubaine de 17 volets "Duaba. La
Odisea del Honor".

A
Duaba, le monument au débarquement des frères
Maceo et Flor Crombet

A
Santiago de Cuba, le parc connu sous des noms différents : La
Placita, Placita de Santo Tomás, Placita de los Mártires et
Parque Flor Crombet, se dernier étant le nom officiel. Avec
l'obélisque dédié à Flor Crombet, en minerai de de la mine
d'El Cobre, de son territoire d'origine. Photo Miguel
Rubiera Justiz/sdl
José Marti a dit
de lui après l'avoir rencontré «...Flor
a un coeur noble, un jugement sain et pense comme je pense
sur le futur destin de Cuba».
Alignement
des héros, Santiago de Cuba
*
Crónicas
de Santiago de Cuba d'Emilio Bacardi
Moreau
ANNEXE : AUTRES OFFICIERS INDÉPENDANTISTES D'ASCENDANCE
FRANÇAISE
Dans
le même "quartier" rural où est né Flor, la même année,
dans le même milieu des planteurs français, est né un
autre général des insurgés cubains, José Lacret
Morlot (1850-1904). Sa plantation d'origine est
cartographiée comme "Lacraite" (cf carte). Il fut d'abord
aide de camp de Antonio Macéo, donc un homme de confiance,
avant de gagner ses galons. Le contre-insurgé de
réputation sanguinaire González Boet organisa l'assassinat
du paisible père de José Lacret, le colon français,
décapité sur son cheval d'un coup de sabre, simplement
pour mortifier le fils insurgé*.

Le
général José Lacret Morlot
Un
autre exemple de général indépendantiste descendant d'un
colon français de Cuba est le général de brigade Carlos
Dubois Castillo (1861-1906) né dans le Municipio
de Sagua de Tánamo (actuelle province d'Holguín) dans un
environnement de plantations de café. Fils du colon français
Charles Dubois Revé et de Clara Castillo. Son père était un
cultivateur de café de Santa Catalina, ce hato
ayant été partagé par des familles de Français pour
développer cette production : les Vidaud, Bientz Lagrave,
Revé, Fousamné, Lamothe, Duboys Revé, Osorio Revé, Casurd
(Cassourd?), Lándersen... La majorité des familles de San
Catalina indique une origine pyrénéenne (Gers, Béarn).
Il étudie en France
et soucieux des influences des idéaux de liberté, d'égalité
et de fraternité, il rejoint l'Armée de libération mambí le
9 mai 1895, influencé par le général Antonio Maceo lors de
son passage dans sa région et participe à l'invasion de
l'Occident. Lorsque les libéraux se sont soulevés contre le
processus de réélection du président conservateur pro
états-unien Tomás Estrada Palma, en août 1906, il est
reparti "dans la manigua"
(comme nous disons "dans le maquis"). L'issue devait lui
être fatale (comme elle le fut pour le général noir Quintín
Banderas, attaqué traîtreusement,
par des envoyés d'Estrada Palma. Il
meurt ainsi de blessures à la machete).
La mort de José Lacret Morlot est survenue alors qu'il était
malade de fièvre jaune dans la plantation de café Kentucky,
à Alto Songo, le 21 août 1906, persécuté par les forces de
l'armée présidentielle. Kentucky, malgré son nom, ou à cause
de lui, avait été fondée par des Français de la grande
Louisiane après 1809.
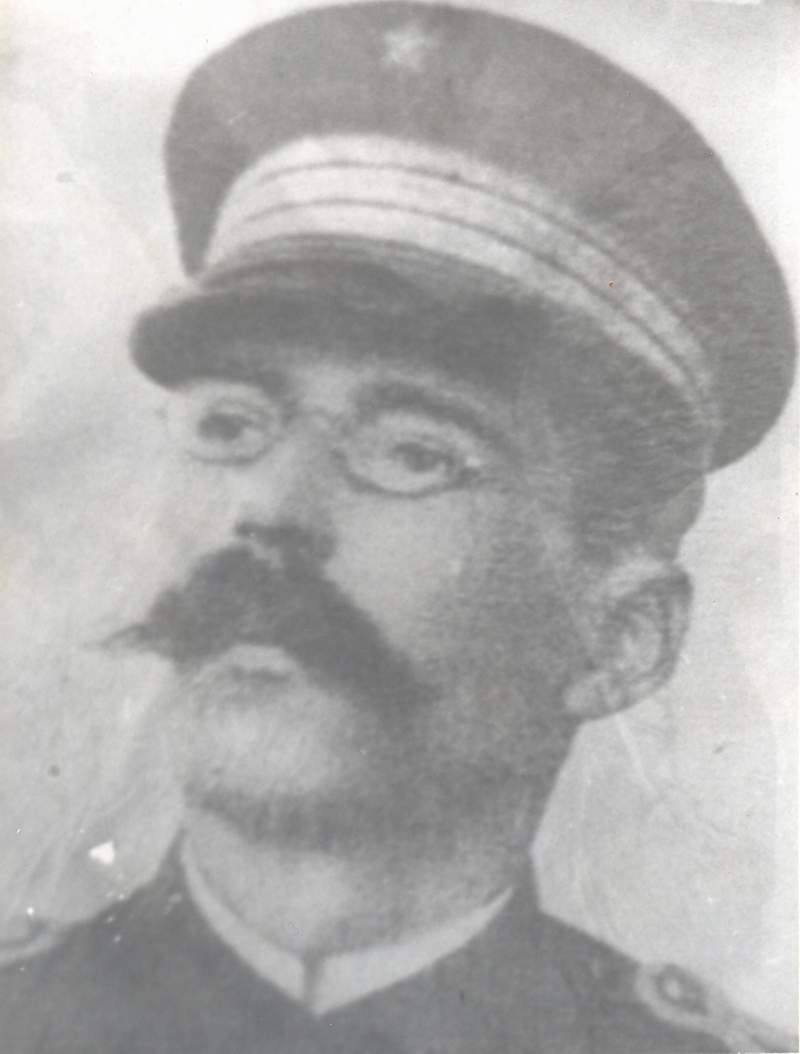
Le
général Carlos Dubois Castillo
Un
autre général de brigade d'ascendance française est Alfonso
Goulet Goulet (1865-1895). Né aussi près de El
Cobre, prisonnier dans la "petite guerre" de 1879-80 (la
deuxième), il fut
déporté en Espagne, devant à son jeune âge (14-15
ans!) de ne pas être fusillé. Il participa à la
conspiration dite Paz de Manganeso en
1890. Selon des sources espagnoles, cette
conspiration avorta par le refus des propriétaires
des mines de manganèse de les appuyer, par intérêt
économique. Il prit part aux préparatifs de
l'insurrection de 1895 aux côtés de Moncada et
Quintín Bandera. Fraîchement nommé général de
brigade sous les ordres de Maceo il mourrut au
combat sur les hauteurs de La Caoba.

Général
de brigade Alfonso Goulet Goulet
Le
fils aîné du grand indépendantiste Emilio Bacardi
Moreau, Emilio
Bacardi Lay s'illustra au grade de
colonel dans la dernière guerre d'indépendance.
Descendant de l'immigration française par son père
(dont la mère s'appelait Moreau) et par sa mère :
famille Lay unie à une Berluchand. En résumé trois
grands parents issus de cette communauté. Le
quatrième, Bacardi, d'ascendance catalane (Sitges)
illustrant la bonne entente des communautés
d'origine catalanes et française en Oriente à
cette période. Né à Santiago de Cuba en 1877 il
s'éteindra à Miami en 1972.
Colonel
Emilio Bacardi Lay :
à
gauche collection Maria del Carmen, à droite
archives de l'ELC
Il rejoint l'armée indépendantiste à 17 ans,
devenant adjoint "par mérite" de Antonio
Maceo. Il prendra contact avec José Marti dans
un déplacement à New-York. Il combat à
l'ouest (entre autres Peralejo, Sao del
Indio...), à Matanzas, puis
Cienfuegos.... Blessé à la baïonnette
à Calimete et par balle à Manjuari. Après
l'indépendance, il ne fit pas de carrière
politique. Après divers voyage à Miami, il s'y
installe en 1936.
Luis Bonne
Bonne (1842-1917) de Santiago de
Cuba. Ses parents étaient cousins. Á 26 ans il
incorpore l'ELC, en 1868. Dans la guerre des
dix ans il termine capitaine d'escorte
d'Antonio Macéo. Il accède au grade de
commandant dans la guerra chiquita, il est
sous les ordres de José Macéo quand celui-ci
meurt en 1996.il devient chef de la brigade
d'El Caney, puis général de brigade en 1897.
Il est blessé dix fois par balle. À
l'indépendance, il se retire dans sa ville
natale.(1)
Général
de Brigade Luis Bonne
Mentionnons aussi dans les généraux
d'origine française de l'indépendance
cubaine, le "mayor general" Julio
Sanguily Garitte (1845-1906)
issu, lui, d'une plantation de café de San
Catalina de Güines (Province de La
Havane). Son frère cadet Manuel
(1848-1925) devint lui-même capitaine, fut
élu sénateur après l'indépendance et est
un historiographe des guerres
d'indépendance. Les deux avaient la
nationalité étas-unienne en plus de
l'espagnole, avant de passer à la cubaine.
Leur père Julio avait les nationalités
espagnoles et française. Leur mère, Mary
Garitte était anglaise. Leur grand'père,
naturalisé états-unien en 1772, premier de
la lignée à s'installer à Cuba, s'appelait
Jean-François Saint-Guily. Julio, le père
de la fratrie fit des études au collège
militaire d'élite de Sorrèze, près de
Bordeaux sous le nom de Saint-Guily.
Il semble qu'il ait voulu ensuite
hispaniser son nom pour ne pas éveiller de
méfiance. Leur frère aîné, Guillermo /
William "le premier Cubain d'Australie",
fonda une lignée Sanguily à Sidney.
http://www.cubanosfamosos.com/es/julio-sanguily-garitte
Nous
manquons jusqu'ici
d'informations sur le colonel
Carbó Monet
figurant dans une histoire
collective de Santiago de
Cuba.
(1)
Le patronyme Bonne
répandu en
Oriente vient du
corsaire français
Jean-Jacques Bonne. En
1809, il essaya de se
faire passer pour
Hollandais, puisque né à
Curaçao. Il obtint de de
ne pas se faire expulser
et prit la nationalité
espagnole. Associé à un
autre corsaire (Joseph
Mourlot, il poséda
plusieurs plantations
dont une à Limones. Les
trois qu'il possédait à sa mort
se nommaient, la Méprisée, la
Gran Colina et Pitit Plaza (nom
créole dit à l'époque patuá).
Il eu trois enfants naturels
avec une Ermina Rosa Porel et
deux avec une Angela Denise
Demiot. Il reconnut ces cinq
enfants (RENAULT 2012/
Geneanet). Nous connaissons deux
des trois enfants d'Elmina Rosa
Porel
- Maria Amalia Bonne (née au
Caney et décédée à Bordeaux),
- Cornelia Angela Mathilde,née à
Santiago de Cuba en 1821, mariée
à Paris avec Charles-Edouard
Specht (Curaçao-Santiago de Cuba
1870), qui termina sa vie en Ile
de France (1884).
Un des deux enfants d'Angela
Denise Demiot est ;
- Marie Philomène Bonne,
Santiago, de Cuba, mariée en
1821 à Jean-Baptiste de Mégret
de Belligny. Sa descendance est
liée à Bordeaux.
Deux
enfants au total ne sont pas
répertoriés jusqu'ici, où peut
se trouver une descendance mâle.
|
UN COMBATTANT FRANÇAIS MYSTÉRIEUX
Notre
recherche sur la famille Bégué à Cuba a en effet
fait apparaître un parfait homonyme de Félix
Begué Begué, l'agent consulaire de France
à Guantanamo.
En
effet, parmi les vint-trois enrôlés venus de
France dans la guerre d'indépendance de 1995-98
répertoriés dans des documents inédits en notre
possession nous rencontrons un Félix Bégué Bégué.
Il est décrit ainsi : Français de 25 ans,
célibataire, Incorporé à l'armée de libération
cubaine le 20 avril 1896 comme simple soldat
(Corps 1, Légion 4, Exp. 86), mort le 5 août 1897.
Il est mort de fièvres à Hondones, dans la Ciénaga
de Zapata. Il fait partie des huit volontaires
venus de France dont la mort a été enregistrée
dans cette guerre.
Son
nom le rattache à la nombreuse famille béarnaise
des Begué, où la double descendance paternelle
et maternelle Begué n'est pas une rareté et où
l'émigration "en cascade" vers Cuba se poursuit
sur des dizaines d'années. Rien ne permet
jusqu'ici de préciser ses attaches avec ce pays.
L'enracinement de la famille Bégué à Cuba et et
sa prospérité avant la guerre d'indépendance est
une piste qui reste à préciser. cf
http://www.ritmacuba.com/Fragments%20me%CC%81moriels%20sur%20les%20planteurs%20francais%20a%CC%80%20Cuba.html
|
2.
LE PETIT-FILS ROMULO LACHATAIGNERAIS CROMBET... ET
L'AFRO-CUBAIN
Après
la mort de Coureau, Flor Crombet avait unit sa vie à la
soeur de son camarade de combat, nommée Cecilia.
Flor et Cecilia donnent à leur fille le nom de Flora.
Celle-ci se maria à un autre descendant de Français de la
province orientale, Romulo La Chataignerais, avec qui elle
eu cinq enfants, le benjamin, héritant du nom de son père
Romulo, naissant à Santiago de Cuba le 4 juillet 1909. Un
esprit aussi résolu que son grand-père comme nous allons le
voir.
Romulo La Chataignerais Crombet fait ses études secondaires
dans sa ville natale, puis obtient son doctorat en pharmacie
à l'Université de La Havane.
Il lutte contre la dictature de Gerardo Machado dans les
rangs des étudiants. Plus tard, il rejoint le Parti
communiste de Cuba. Il purge une peine de prison pour avoir
participé à la grève de mars 1935. Il part grâce à une
bourse aux États-Unis et combat pendant la Seconde Guerre
mondiale. Nicolas
Guillén le décrit comme "un
homme de visage fin et à la voix douce, un jeune
intelligent et curieux, confiant en lui-même".
Quand il commence à publier, peut-être las d'entendre son
nom « exotique » dans le contexte cubain, nom maltraité par
une prononciation à l'espagnole, peut-être aussi par volonté
de ne pas marquer de distance par rapport à son lectorat, il
décide de modifier son nom en lui donnant une orthographe
castillane « Lachatañeré ». Forcément fier d'être le
petit-fils d'un héros de l'indépendance bien éduqué et
justement glorifié, qu'il n'a pu connaître directement, il
sait qu'il est aussi l'arrière petit-fils d'une esclave dont
le destin est resté mystérieux (Flor avait échoué dans ses
tentatives pour en savoir plus sur sa mère éloignée de la
plantation familiale). Son approche de la vie populaire, de
la religion populaire, c'est-à-dire des cultes afro-cubains,
dans les périples peu fortunés de sa vie havanaise l'amène a
publier dans ce domaine.
Il collabore aux journaux "Diario de Cuba" (Santiago de
Cuba) et "Noticias de hoy" (La Havane) et dans les revues
"Estudios Afrocubanos" (où il a publié "El sistema religioso
de los lucumís y otras influencias africanas en Cuba"entre
1939 et 1940), "Mediodia " (proche du parti communiste),
tous deux de La Havane, et "Vision", de New York. Il donne
de nombreuses conférences.
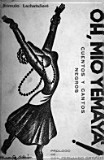
Il
publie « Oh mio Yemayá,
cuentos y cantos negros » (1938), avec une préface
de Fernando Ortiz (lequel accepte de la part du jeune
chercheur le rejet du terme « brujeria
», sorcellerie, pour parler du système religieux lucumí**)
et « El Manual de
Santeria », qui porte deux sous-titre différents :
sur la couverture «
Estudios afrocubanos » et dans le texte «
El sistema de cultos Lucumí ». Ce dernier livre
paraît à La Havane en 1942 (alors qu'il réside déjà depuis
deux ans aux États-Unis), là encore dans une maison
d'édition liée au parti communiste.
Ces deux publications en font un pionnier des études
afro-cubaines aux côtés de Fernando Ortiz et Lydia Cabrera.
Et aussi un intellectuel révolutionnaire analysant le rôle
de la question noire dans la nécessaire transformation
sociale et politique.
L'ensemble de ses écrits sur les cultes afro-cubains est
réédité à La Havane en 1993 sous le titre «
El sistema religioso de los afrocubanos » avec une
importante préface de l'historien Isaac Barreal (plusieurs
rééditions).
En 1995, les problématiques
respectives de Romulo Lachateñere, Fernando
Ortiz et Lydia Cabrera sont analysées en français par
Erwan Dianteill (Le
savant et le santero, L'Harmattan). Est incluse
dans cette parution la première traduction de Lachatañeré
en français : "L'origine des cultes et leur mode de
fonctionnement",
un chapître d'«
El sistema religioso de los afrocubanos », par
l'anthropologue congolais formé à La Havane, Wilfrid
Miampika.
Dans un article que Romulo Lacahatañere publie d'abord en
anglais), "Quelques aspects du problème noir à Cuba",
l'analyse distanciée des contradictions entre noirs et
mulâtres et des divisions entre mulâtres se joint à la
connaissance intime de son milieu d'origine et
de sa mentalité, héritée du côté paternel comme
maternel :
"Ces divisions, quoique
surgies au cours de l'histoire par le caractère
particulier de l'économie esclavagiste de la région, ont
été aussi influencées par chaque groupe de mulâtres, aussi
bien les descendants des Français - à travers des réfugiés
qui échappèrent à la révolution haïtienne - que les
mulâtres hispanophones. Le premier groupe reçut une
éducation "à la française", avec un sens libéral certain,
plus complète que celle reçue par les descendants
d'espagnols. Ils reçurent des avantages économique sur les
seconds, considéraient ceux-ci inférieurs culturellement
et s'ils ne se séparèrent pas d'eux, du moins les
considéraient avec condescendance. Les mulâtres de culture
française, appelés "les Français de la Rue Le Coq" (en
français dans le texte), du fait de la coutume reculée
dans le temps d'installer leurs commerces dans la rue
appellée calle del Gallo
à Santiago de Cuba, s'efforcèrent de vivre à la manière
française et dépréciaient le dialecte dérivé de l'espagnol
: "pagnol", préférant parler le patois dérivé du français"
(notre traduction)...
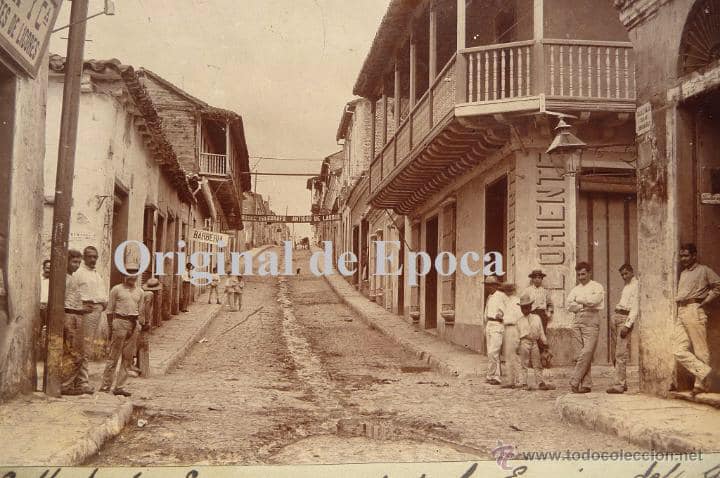

Vers
1900 et en 2020 : Croisement de la rue Gallo et bas de la
rue Enramadas (montante), Santiago de Cuba. 1. La
banderole en travers de la rue correspond à l'hôtel
historique français "de Lassus". 2. Le symbole du coq à
l'origine du nom de la rue (un coq de métal surmontait une
maison de Français).
Des
trois intellectuels découvreurs de l'afrocubanité à Cuba, il
est le seul à ne pas parler de l'extérieur, son analyse est
liée à son vécu dès l'enfance et avec son vécu de métis dans
les quartiers populaires de la capitale.
À sa mort dans un accident d'avion à Puerto Rico, en 1951,
l'intellectuel engagé en même temps que biologiste (déclassé
du fait de sa vie militante), Romulo Lachatañeré né
Lachataignerais était employé de laboratoire au Columbia
University Hospital et membre du Parti Communiste
des États-Unis.
© Daniel Chatelain / Ritmacuba. 2020
**
Ce
qui était une critique implicite de Fernando Ortiz qui
avait publié un livre au titre plus tard contesté "Los
Negros Brujos" (Les Noirs Sorciers).