
Retour à l'accueil
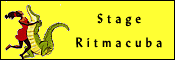
Santiago de Cuba - Juillet 2021
 Retour à l'accueil |
|
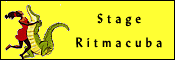
Santiago de Cuba - Juillet 2021 |
Mise en ligne de la page : le 15/07/2020. Dernière modification
02/01/2023.
La page avec tous les textes du site
Par Daniel Chatelain

Environs
de
la Gran Piedra - DR
Sommaire :
Avant-propos
1. PRESENTATION, SUR LES TEXTES SELECTIONNES
2.
FABLES ET POEMES DE PRUDENT DAUDINOT (SELECTION)
- Corneille avec Renard
- Mulet qui vanté famille li
- C’est ouanga !
- Elégie (extrait)
3.2. Préface : « Piti causement »
3.3. La banza, la lyre créole, présente à Cuba? (commentaire de Daniel Chatelain)
3.4. Poémes et contes sélectionnés d’Hippolyte Daudinot
- Blancs Dada et langue créole
- Vini n’en Palène
- Soleil l’amour (présentation, extrait, non transcrit)
- Beauté Ibo
- Compèr Malice et compèr Bouqui (présentation, non transcrit)
- « Non » femmes, souvent c’é « oui »
- C’é Zombi .
(con
traducción parcial en español)
5.
LA RELATION AU CREOLE DES FRERES DAUDINOT
6. CREOLE CUBAIN : UN CREOLE QUI S’ECRIT QUAND S’ÉVANOUIT L'OASIS CULTUREL QUI L’A PORTE.
7. LEXIQUE : SELECTION DU VOCABULAIRE CREOLE DES DAUDINOT
Annexe : le manuscrit, les difficultés de sa lecture, son sommaire complet et sa pagination originale


Danse d’esclave avec tambour et "guitare créole". XIXe s. Tableau attribué à Agustino Brunias. Musée de Bordeaux Aquitaine.
Cet article part de la transcription d’un manuscrit en créole écrit part deux Cubains à deux moments différents du 19e siècle. Le contenu mis à jour par cette transcription et sa traduction nous ont conduit à examiner ce créole particulier, son vocabulaire et ce qu’il révèle d’un culture localisée dans le Sud-Est de Cuba. Il semble être la seule trace écrite connue de cette forme linguistique anciennement pratiquée dans les plantations crées par des réfugiés de la colonie de Saint-Domingue et autres Français d'Amérique et de la métropole. La tradition orale issue de ce même contexte nous est parvenue, elle, à travers les chants de la tumba francesa, celle-ci devenue patrimoine immatériel de l’humanité .
Comment se présente-t-il? C’est un manuscrit de 74 p. sur papier à liséré latéral d’un papetier de Paris. En créole, à part la dédicace en français. En vers, à l’unique exception de la préface. Ecrit avec une encre pâlie par le temps, de telle manière qu’il a fallu des reproductions avec un noircissement pour arriver à en lire l’essentiel.
- non daté, avec une différence de dates entre les deux parties mesurée en décennies, comme l’enquête sur les deux auteurs a permis de l’établir.
- deux auteurs, le second, Hippolyte Daudinot étant le frère cadet du premier, Prudent, ce frère aîné d'une fratrie de quatre garçons et une fille. Hippolyte écrit après la mort du frère aîné et ayant sauvé de la destruction 14 feuillets initiaux (parmi d’autres indéchiffrables). Qui lui servent de modèle. C’est Hippolyte lui même qui narre ce sauvetage.
- le premier était connu d’autres planteurs pour écrire en créole. Le second a recherché ces papiers dans les biens du défunt à la demande d'autres personnes de son environnement, de la communauté française des propriétaires de caféières, telles les sœurs de Mme Jules Raoulx (Léocadie née Heredia Girard) et cette dernière, à qui a été dédié le manuscrit et l’a gardé.
Les textes se distinguent des chants de tumba francesa, en particulier par le procédé de versification, issu du français. Par la proximité avec la bonne orthographe française aussi. Ils sont destinés à être lus, peut-être contés. Ce ne sont pas des chants. Mais il y a des cas de citations de chanson française ou de berceuse créoles. Et des allusions à la musique de plantation, qui vont se révéler précieuses, rejoignant des éléments connus par la tradition orale ou plus surprenants, comme la présence jusque là ignorée sur le sol cubain de l’instrument banza utilisé dans le titre choisi par Hippolyte Daudinot.
Cette publication ne reproduit pas l’intégrale du manuscrit, qui nécessiterait une équipe plus large, mais une partie représentative, les textes sélectionnés contenants les plus frappants des éléments culturels spécifiques.
Remerciements chaleureux à Marie José « Pepa » Delrieu, descendante de Jules Raoulx et Léocadie Heredia Girard pour m’avoir confié le volume manuscrit retrouvé à Oléron dans ses papiers de famille. N’étant pas moi-même féru de créole, la contribution de Daniel Mirabeau a été décisive, par ses traductions doubles en créole haïtien moderne et en français pour retrouver le sens des transcriptions
N. B. : Les hésitations sur la transcription sont signalées par un (?) à la suite des syllabes douteuses (voir le détail des possibilités de confusion en début de l'annexe).
Hippolyte Daudinot a pu sauver onze textes des écrits en créole de Prudent Daudinot postérieurement à son décès à Cuba, dont cinq fables et six poèmes. Trois des cinq fables apparaissent d’entrée de jeu comme des adaptations de La Fontaine :
|
Corneille avec Renard Crapaud avec taureau Youn chien marron et youn mouton |
Le Corbeau et le Renard La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf Le loup et l’agneau |
Une quatrième, Lapin avec Crapaud, prend à témoin La Fontaine dans le texte.
Nous avons sélectionné ici trois fables et deux poèmes.

Arbre du jardin botanique de la Gran Piedra
Corneille avec Renard
Version de « Le Corbeau et le Renard » de La Fontaine.
Les différences avec le texte de La Fontaine sont dûes à une recontextualisation dans le monde caribéen et un caractère didactique de la version. Ainsi il explique dans le texte le mot renard : « yo mitan chat, l’autre mitan chien » (moitié chat moitié chien). Cette explication, quoi qu'elle vaille, est sans doute destinée à de petits créoles et au personnel…
|
Original |
Créole haïtien moderne |
Transcription littérale en français |
|
Dans temps corneil’o yo té manger fromage, Yo renard, l’animau bien fin… (Yo mitan chat, l’autre mitan chien) Garder corneil’, qui sans faire tapage, En haut grand mapou voisin, Z’après manger youn gros fromage. Mouché renard comme gagné langage Pour tromper sot, qui douce passé sirop Et sot, n’en mond’ cilà gagné que trop. C’est vous, li dit – bonjour mouché Corneille ! C’est piti bel ou bel en haut bois là ! Chanson vous c’est miel n’en z’oreille ;
C’est rossignol li même qui dit ça. Moin qui conné piti bien la musique, Chanté pour moin, vous va fair’ moin plaisir. Corneille c’est z’oiseau qui bourrique. Li croir’ renard, li té gagner désir Anpi chanter, car Pipirite Zé faire li croir’ li té gagné mérite Papé rossignol dans mapou[1] chanter Li v’lé chanter, fromage li tomber. Mouché renard li ramasser ; Et pi l idit « Papa Corneille ! Depuis raison charré moin n’en treille » Marraine ! moin --( ?)né[2] beaucoup. Fais comme moin. Voix vous pas bel du tout ; Mais n’en plaç’ à li, qui fromage ! Vié z’oiseau, li temps pour vous sage, N’a pas jamais conté flatteur Car toujours li porter malheur Li vanté voix lorsque li v’lé fromage » |
Yon fwa sou yon tan, konèy o yo te manje fomaj Yo rena, zannimo byen fèn Yo mitan cha, lòt mitan chyèn Gade konèy ki pa fe kabalye Anwo gan mapou vwazen
Apre manje yon gwo fwomaj Monchè rena, kòm ganye langaj Pou twompe sò, ki dous pase siwòp E sò nan mond sila ganyé twòp Bonjou monche Konèy Se bèl piti w bèl anwo bwa la Chante w se miel nan zorey Se « rossignol » li menm qui pale sa mwen ki konnen pitit myzik Chante pou mwen w fe mwen plèzi Konèy se zwazo ki bourik Li kwè rena, li w ganye anvi Anpil ...chante paske Pipirite Fe li kwa li tè ganye merit Papa zwazo nan mapou chante Li vle chante fwomaj li tonbe Monchè rena li ramase Epi li di : Papa Konèy Depi rezon chante chare mwen nan tray Marenn ! Mwen --(?) anpil Fais Fe kom mwen. Vwa w pa bèl Men nan plas a li ki fwomaj Vyè zwazo litan pou w saj Sispann di flate ou Paske li toujou pote movè chans Li fe lwaj vwa w lè li te vle fwomaj o |
Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage. Maître Renard, l'animal malin L'observe sans faire de tapage Lui tint à peu près ce langage Pour l'embobiner, il lui passe la pommade À dessein de remporter l'affaire Hé, bonjour Monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli en haut de cet arbre Votre chant est du miel pour les oreilles! C'est le rossignol qui pépie comme cela Je reconnais sa belle musique Vous écouter me ravit Le corbeau est un oiseau qui n'est qu'un âne Il crût le renard, de chanter l'envie Etait grande pour un Pipirite
[5] Il lui fait croire qu'il en a gagné le mérite Père rossignol dans le mapou se mit à chanter De sa volonté de chanter, le fromage chût Monsieur renard de le ramasser Il lui dit : Père corbeau Pour ceci, j'ai tissé ma toile Marraine !….. Faites comme moi ! Votre voix n'est pas belle Mais à sa place, quel fromage ! Vieil oiseau, il serait temps pour vous d'en tirer leçon De ne plus écouter un flatteur Car toujours il porte malheur Il a loué ta voix quand il voulait du fromage |

Mulet qui vanté famille li / Milèt ki vante fanmi li/ Mulet qui vante famille
Nous n’avons pas reconnu de modèle pré-existant à celle-ci, par contre bien située dans le contexte social et historique. On parle ici de changement de maître, c’est une fable sur l’esclavage. Avec un morale intéressée destinée aux esclaves de la plantation : on ne change pas une personne avec des principes, en l’occurrence chrétiens, contre un contremaître sans cœur et sans reconnaissance. Elle semble faîte pour être lue ou contée aux esclaves de l’habitation.
Le travail esclave est comparé à celui du mulet qui transportait sans trêve le café depuis les montagne jusqu’à la baie où il sera exporté. Un mulet qui sera remplacé sans vergogne, une fois fourbu et sans force, par une belle pouliche.
L’allusion à la guerre du Sud entre les généraux Toussaint-Louverture et Rigaud avec ces grandes pertes humaines (certains ont parlé de guerre d’extermination) et les oppositions exprimées en termes de Noirs contre Métis témoigne de la mémoire des événements dramatiques de la Révolution haïtienne dans la communauté des réfugiés à Cuba au moins une génération après les faits (cf note 8 sur cette guerre).
|
Dialecte original |
Créole haïtien moderne |
Français |
|
Vanter, c'est très
mauvais' manière Grand maman li té dit
bonne aventure, Youn capataz et capataz
pas joué? Nègres vantés qui mandé
changer maître, |
Vante, se yon move
mannyè Gran manman li di lavni Nèg vante ki mande
chanje mèt |
Se vanter, quelle
mauvaise manière Sa grand-maman disait la
bonne aventure |
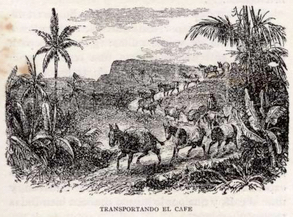
Colonne
de mulets transportant des sacs de café (dessin de Samuel
Hazard)
C’est ouanga !
Thème de l’ensorcellement. Il pourrait être tentant d'y voir une part autobiographique involontaire de cet auteur mort dans la force de l'âge... Y-a-t-il une part de regard ethnographique avant l'heure? Mais si lui, ancien étudiant dans l'élite bordelaise (cf infra), ne s'appropie pas les croyances populaires ici présentes, c'étaient probablement celles de sa famille maternelles et de tout son entourage sur la plantation.
|
Original |
Créole haïtien moderne |
Français |
|
C’est youn wanga ! c’est youn wanga, nénéne ! Jétte remède ou dans youn coin, Ou vlé guérir moin – qui la peine ? Capoulata[10] trouvé bout’moin Moin v’allé brûler youn chandelle Pour vous Saint’Vierg’, maman Bondié Pour fête à vous dans la chapelle, Outi ça qui v’lé, yo fait veu Moin va monter la dans montagne, Outé jamais yo pas tender Quand bamboula battr’ dans campagne, Tambour ou cha cha résonner Pour voir si vié maman sorcière, Qui chanté la nuit dans joupa P’allé di moin ça qui faut faire, Li qui la rein’ capoulata Ma parlé saint, m’a hélé diable ! Zaut tourment cilà la finir. Souffrir encor, mon pas capable, Pitot, nénéne, pitôt mourir. |
Se youn wanga ! Se youn wanga, nenene! Jete remèd ou nan koin Ou vle geri m', èske li vo li ? Kapoulata di ke pou mwen li nan fen an Mwen ta renmen boule yon lanp Pou w sen vièj, manman Bondye Pou selebre w nan chapèl la Zouti sa ki vle pou fe swè[11] Mwen pral monte nan mòn lan Ou te janmè ou pa tande Lè banboula bat pwovens lan Tanbou a tchatcha a rezone Wè si sa sosyè fin vye granmoun Ki chante lannwit nan jou pa Pou ale di mwen sa ki fo fè Li ki larenn kapoulata Mwen pale sènt, m'a ele dyab Se konsa, ki lòt touman m 'sispann Soufri ankò, mwen pa kapab Pito, non pito mouri |
C'est de la sorcellerie, de la sorcellerie, non non non ! Jettez donc votre remède dans le coin Vous voulez me guérir, est-ce bien la peine ? La guérisseuse dit que pour moi c'est la fin
Je voudrais brûler un cierge Pour vous Sainte Vierge, mère de Dieu Vous honorer dans la chapelle Avec les offrandes qu'il faut pour vous faire un vœu Je vais monter dans les mornes Tu ne les as jamais entendus Quand le bamboula bat dans la campagne Quand le tambour ou le tchatcha résonne Voir si cette vieille sorcière Qui chante la nuit dans dans la baraque Saura quoi me faire pour aller mieux Reine guérisseuse J'ai imploré les Saints, le diable Pour que mes tourments cessent De souffrir encore je ne suis pas capable Non non non, plutôt mourir ! |
A ce stade de notre travail nous n’avons pas transcrit les poésies sentimentales de Prudent Daudinot, d’ailleurs assez courtes : Bouton rose ; Non, ça pas belle ; Désespoir (en alexandrins) ; Chagrin (sur une trahison féminine). Voici un extrait du dernier de ces poèmes, Elégie :
Elégie
|
Original |
Créole haïtien conntemporain |
Français |
|
Adieu belle fleur, belle rose Voir toué fait cœur moins trop souffrir … Depuis z’yeux li metté cœur moin n’en chaîne, C’est pas youn fleur, c’est l’amour moins besoin ? |
Orevwa[12] bèl flè, bèl roz We ou fe kè mwen twòp soufri … Depi je li mèt kè mwen nan chèn Se pa youn flè se lanmou mwen bezwen |
Adieu belle fleur, belle rose Te voir me fait par trop souffrir … Depuis que tes yeux ont mis mon cœur aux fers Ce n'est pas de fleur, mais d'amour dont j'ai besoin |

Danse masón de Tumba Francesa sur un séchoir à café de la cafetal La Fraternidad après rénovation. Photo Carlos Manuel Ponce Sosa.
En respectant l’ordre voulu par Hippolyte Daudinot, nous reproduisons maintenant sa dédicace puis sa préface en créole dite « Piti causement », avant de passer à ses propres créations en vers. La dédicace éclaire aussi, pourtant, les écrits précédents de Prudent.
Commençons donc par le seul texte en français de ce manuscrit. Nous reviendrons sur sa destinataire principale et sa famille après les exemples de transcription du manuscrit et la reconstitution de la biographie des premiers Daudinot à Cuba.
De mes humbles efforts, je viens, Léocadie,
T’offrir les résultats. A toi ma bonne amie,
Ce travail, justement, doit être dédié,
Puisqu’il fut inspiré par ta vieille amitié,
Dont le bon souvenir fit germer en ma tête,
L’ébouriffant dessein de jouer au poète
Je parle ici d’un fait depuis longtemps passé,
Mais dont le souvenir ne s’est point effacé.
De mon frère en ce temps, un modeste poème,
Parut intéresser et ta mère et toi-même.
Il ne vous déplut point, et vous louâtes fort
Qu’en langage créole on eût fait cet effort.
De chercher ces écrits vous me fîtes prière ;
En vos désirs, en vain, je voulus satisfaire ;
Je cherchai sans succès – mais en ces temps derniers,
J’en trouvais quelques uns parmi de vieux papiers.
Je te les offre ici.
Puis me vint la pensée
De suivre, moi chétif, son œuvre commencée.
Ce dessein, j’en conviens, est fort audacieux,
Mais l’audace, dit-on, sourit et plaît aux Dieux,
Et ne déplaît pas trop, je présume, aux Déesses,
Des hommes et des dieux, adorables maîtresses.
Or, de tout cœur viril le plus doux des plaisirs
Ne fut il pas toujours de combler leurs désirs ?
Aux champêtres travaux ma jeunesse asservie,
Ne s’abreuva jamais aux flots de Castalie [13] ;
Jamais je n’ai gravi les flancs de l’Hélicon[14] ;
Mon vol n’est point celui de l’aigle et du faucon[15]
Ma verve ne saurait être mieux comparée
Qu’au vulgaire Pierrot qui prend sa becquetée
Sur le bord du chemin, dans les obscurs nipeaux(?)
Et dont le vol atteint à peine les ormeaux.
Je ne pourrai jamais de la céleste Lyre
Tirer les fiers accents des bardes en délire,
Mon ambition se borne à l’infime Banzá,
Mon Pégase, un – (?)ouin, l’humble ami de Panza[16]
Je contemple, fervent les cimes du parnasse,
Mais n’en approche point – ce n’est pas là ma place.
Les lauriers de Pindare à mon front ne vont pas ;
En fait d’ode et sonnet, je m’en tiens aux « Sambas »[17].
Du langage naïf qui charma mon enfance,
Puissent les doux accents t’inspirer l’indulgence
Pour les faibles efforts d’un sénile « mambo »[18]
Qui s’embarque insensé ! dans un frêle bateau,
Sur ces flots orageux, si féconds en naufrage,
Qu’affronte l’imprudent et qu’évitent les sages.
Le mobile, chez lui, n’est qu’un ardent désir
A toi même, à tes sœurs de vous faire plaisir.
Que de nos jeunes ans la douce souvenance
Assure à son travail un peu de bienveillance,
Ses vœux seront comblés – qui n’envierait le lot
De votre serviteur dévoué
Daudinot ?

Entre Santiago de Cuba et la Gran Piedra
Hippolyte Daudinot, dans la partie finale de cette
préface, fait part d’une expérience, bien connue de
nos jours par les santiagueros
frappés par la différence de température entre la
baie et un point culminant environnant, la Gran
Piedra, entourée de vestiges des caféières française
: « Quand on a monté jusqu’en haut gros morne, on toujours trouvé
fait frète. Yo mim qui monté mille fois pli haut,
yo do trouvé gros frète mêm, même. Alors yo do
porté bon capote, bien chaud. Ensuite yo do prend
temps, et mon pas crèr que y’a trouvé
« tienda » catalan n’en chemin ».
Chez lui, comme pour ses compatriotes qui en
peuplaient les flancs, elle devient montée de la
« Grosse Roche ».Celle-ci avait dominé le
paysage de son enfance dans la propriété familile de
la Soledad (cf infra)
Il y a de même une allusion au Monte Rus/Mont Taurus (taureau), dans les hauteurs de Guantanamo, un des lieux emblématiques des caféières, ici sous le nom de : « Mounté bèf », nous reviendrons sur cet indice que nous laisse Hippolyte Daudinot sur sa vie adulte à Cuba dans la partie sur sa biographie.
|
Original, en créole |
Traduction (Daniel Mirabeau) |
|
« Chères z’amies mouin, Z’auts conné que moun yo hélé « z’auteurs », c’est à di, qui écri livres, yo toujours metté, n’en commencement livr’ la, quelques piti bétises yo hélé tantot « Préface », tantot « Avant-propos », tantot « Observations ». Yo fait ça pour di moune (qui pas mandé yo) pourqui yo écri, pourqui yo di ci, pourqui yo di ça, et patati et patata ! Alors mouin même, nou di com’ ça : « Pourqui mon pas lé fair’ com’ yo ? Pisque tout’ piti chiens fait ça, nou bien capab fair’ li ton ». Mon ouér z’auts à pé zi parc’ que mon metté corps mouin « n’en rangs z’ognons, n’en mitan z’échalottes ». Z’auts di com ça : « Joug[19] chien tou ! ». Est’ c - que vié « mambo la gagné fronté hélé corps, li « z’auteur », et piti cahier li la gnoun[20] livre ? ». Non, chères ricaneuses mouin yo ! c’é pas la peine nou vini charré mouin. Mon pas assez sot’ pour hélé cahier moin « livre ». Mais nous conné bien que « quand ou pas gagné chien pour méné la chape, ou méné mouton. Fini vi, et conté mouin ! Piti causement mon annoncé la, c’est pour di comment mon trouvé fourré corps moin n’en z’affaires vers, quand tête à mouin dijà blanche, quand jarret dija commencé tremblé. Mon ti gagné gnoun frère, qui mouri, pauv’diable, depuis longtemps. Li té conné bout’ vers Français depuis li té pití. Gnoun jour, l’idé prend li fair’ vers créoles. Li fait yo, et moune trouvé yo pas trop laide. Après frère moins mouri, quelques madames, bons z’amies mouin, di mouri com’ ça : t’en pri’, cherché n’en papiers frère ou, pour ouér si m’a trouvé vers créoles li té coutume fair ». Mon fouillé partout, mon pas trouvé agnén. Gnoun l’anné passé après l’aut’, jong’ l’anné ci la rivé. Gnoun jour mon t’a pé fouillé n’en vié papiers, mon trouvé gnoun piti paquet tout sale. Mon l’ouvri li, c’été brouillons vers créoles, écriture frère mouin, mais écrit avec crayon, et tout’ embrouillé. C’é piti travail mon travail pour dechiffré yo! Et encor, mon déchiffré nic 8 ou 10, pour les z’auts, n’en point moyen. Même n’en ça mon réussi débrouillé, ti gagné des morceau qui ti manqué. Alors moin mem’, pauv’diable qui pas jamais conné bout z’affaire ci là layo, mon touyé corps moin pour remplacé yo. Mon gratté têt’, mon gratté z’oreill’, mon frappé pied, mon gardé en l’air, mon sué joug’ temps mon réussi tant bien que mal (plus mal passé bien). Après mon caba avec vers frère mouin, mon prend songé, et mon di com’ça, à part mouin : « madames la yo, bel’ piti z’amies mouin yo, prend plaisir n’en vers créoles. Si, mon sayer fair quelques uns moué mêm’ ? » ça mon pa lé[21] fair pour yo ? ça pas métier mouin, c’est vrai ; mais pour conné langue créole, personne pas lé calé moins là ! Est ç’ que dempi monté piti, dempi m’a pé couri n’en savane avec grand chemise blanche ou bien mamelouk, mon pas té coutume chanté : « Chimbé[22], nous pas largué, nachon créole c’é nachon maman moué » ; c’é nachon mouin et sacridghé ! pourqui mon pas lé composé n’en langue mouin ? Mais, tendé mouin bien ! nous pas allé crèr que m’a pé baill’ nous sambas cordon bleu, n’en point danger ! Mon pas jamais conné bagail français hélé « La Lyre Apollon ». Mon pas conné manié z’outil ci là la, et pour di vrai, mon pas jamais ouér li. Tout ça m’a pé cherché fair’, c’é bail’ quelques pitis sambas, en haut pauv’ Banza créole. Mon ouér que frère mouin, com’ tout’ les zaut’s qui écri en créole, traité langue créole con’si c’été français. Yo v’lé forcé pour langue nous suivre tout’ règles de ça yo hélé « L’art de la Versification Française ». Mon mandé z’auts, z’amis mouin, si ça gagné bon sens ! Songé donc ! Dempi diable té piti moune, ya pé poli, repoli, re repoli langue français, tandis que créole, pauv’diable, c’élangue qui comence ayer. Français héc, et, même, mur. Créole même, li hohotte encor. C’é langue piti moune, négres, et moune qui pas conné li, qui pas conné écri, qui pas conné agnén. N’en tout’ langue n’en moune gagné vers, et, n’en tout’, gagné quelques règles qui pareils. Mais à côté règles ci là la. Yo gagné l’auts qui particulier à chaque langue. Pour gagner pile règles, français calé ya tout’ ! règle côté ci, règles côté là, règles en haut, règles en bas ! N’en tout’ règles la yo, n’en point gnoune qui bète, com ci là qui aim : faut ou metté - gnoun rime qui mâle , et l’aut’ rime qui femelle. Z’auts tendé ça ! N’en qui langue, à part français, yo jamais tendé z’affair com’ça ? Vers garçon avec vers femme ! mais si c’é com’ça, comment ça fait que dempi temps y’a[24] pas metté yo gnoune à côté l’aut, yo pas trouvé moyen faire pitite? Eh bien ! yo v’lé fourré mâle avec femelle yo n’en vers créoles. Et pour yo capab’ rivé, yo obligé gâté langue nous. Yo ‘bligé, à tout moment, metté paroles français. Créole comprende ça, c’est vrai, mais c’é pas créole même, mêm’. Ça semblé créole que moune sotte parlé, quand yo v’lé faire’ ou ouèr que yo conné parlé français. C’est ça nous hélé « parlé pointu ». Yo crère que gnoum fois c’é com’ ça en français, moun ver( ?) pa capab bon de li pa pas gagné mâle mêmé avec femelle. Mandé yo (si yi conné l’aut’ langue passé par à yo) si Byron, Pope, Shakespeare, Schiller, Goethe, Dante, Japes, Espronce da sans( ?) jamais conné rime mâle avec rime femelle ? Mandé yo li vers français pli bel passé cilà composes yo que mon nommé ? Yo gagné ça yo hélé « Cadémichiens ». Mon pas ça di(?) nous, bien juste, qui nachon bête ça yé, mais d’après ça mon lire, mon crér c’é gnoun tas de viés mambos, qui té z’auteurs, ou composes, ou l’aut quichose com’ça. Yo vini vié ; yo bouqué travail, yo pas bon pour à rien encor. Ça fait moune fait avec yo, Ça nous même coutume fair’, là bas, avec vié nég et viés z’animaux, yo bail yo « liberté savane ». Mon pas bien sur, mais mon crér c’équichose comm’ça. Viés corps la yo, yo gagné z est passé yo gros. Ya crér voi pas cousin yo. Yo fourré vié nég yo (plein tabac) n’en tout’ z’affaires z’auteurs, n’en tout’ z’affaires livres. Yo même qui coupé, tranché, jugé tout’ qui chose ! Avec ça, c’é des vrais « goumanache » ; Yo fourré viés baguettes tambour yo n’en culottes. Z’habit galonné n’en dos ; n’épée à côté, chapeau à cornes n’en tete.Yo rassemblé, temps en temps, n’en gnoun grand joupa (ou dans gnoun parc, mon pas conné qui l’est-ce) et là chacun enfoncé corps li n’en gnoun grand fauteuil rembourré, joug’ temps moune ouér bout’ med yo, gnoun bord, et l’aut’ bord, lunette a yo et tête calé yo, qui semblé calebasse ! Alors, gnoune lévé, et commencé di des bêtises. Les aut’s, yo tout’ prend cabiche, temps en temps, gnoune va tirer bras li ou bien jambe li, liva l’ouvri gnoun z’yeux, mais la torné fermé li tout’ suite et l’a tourné prend ronflé. Yo hélé ça : gnoun « séance de l’académi ». C’é là, nonc, que yo jugé tot’ z’affaires livres. Yo doué, parconséquent, conné tot ça qui gardé vers, avec rime, mâle et femelle. Eh bien ! annous parier gnoun qui chose ! M’a prend deux gris vers terre. M’a hélé tout’z’auteurs la yo, tout cadémichiens la yo, et m’a dit yo « A là deux vers, di mouin, aç’tor, ça qui mâle, et ça qui femelle ? Yo pas fouti !! (pardon mesdames, mot la c’é bon créole). Ça qui rivé ? avec tout’ fandangue[25] la yo, vers français semblé gnoun cheval qui n’en savane, avec z’entraves n’en jambes. Vers anglais, allemand, italiens, pagnols semblé cheval qui largué n’en gnoun savane entouré. Quand yo marché tout les deux, qui l’est-ce qui marché pli bel ? Encor gnoun comparaison : tout’ règles la yo, c’é pour faire calalou la bien douce. Eh bien ! calalou yo douce c’é vrai. Mais yo pas v’lé metté piment, yo di li piqué trop, yo pas v’l’ metté tom tom ; yo di li trop lourd. Di mouin un peu ? pour gnoun calalou bon, vrai, vrai, faut pas piment ? faut pas tom tom ? He bien ! z’amis faut pas nous quitté yo metté z’entraves ci là la yo n’en langue nous. Faut pas yo vini gâté, commandé la case à nous. Songé, nonc ! cher créole nous, langue maman nous té parlé nous, quand nous mêmes té commencer balbutier quelques mots. Ah ! oui, mon songé (et z’auts di(?) songé con’ mouin), quand, à jouér(?), li ti fair’ mouin chinta en hauts genoux li, pour li tiré conte ba mouin. Et pi, quand sommeil commencé batt’ mouin, li appuyé tête mouin en haut poitrine li et li prend chanté : « Dodo, cher pitit’ a mouin Si ou pas dors Chien marron à maman on Nous songé ça, di mouin ? » Ha ! qui côté tout Victor Hugo yo, Shakespeare yo, Byron yo, Pindare, yo, et même, grand papa yo Apollon, va jamais fouti écri quichose qui capab’ sonné douce n’en z’oreilles mouin com fouti chanson ci là ? Marraine qui baptisé mouin ! quand mon tendé li, semblé mon gagné lait maman mouin n’en bouche ! Composes la yo (yo hélé yo « poëtes ») gagné gnoum z’animau, mon pas conné si c’é cheval, mulet ou bourrique. Z’animau-là gagné z’ailes semblé z’oiseau.[26] Poëtes la yo, yo grimpé en haut dos li. Mon pas conné si c’é avec selle ou avec z’apparon ; ou bien si c’é à poil ; Mais pour gnoun raison que m’a dit plus bas, mon crée que c’é avec z’apparon. Gnoun fois yo bien chinta en haut dos li, yo fouti li gnoun coup z’épron, et a là yo parti ! Bête la mounté, mounté, joug li dépassé mogote[27] et la « Grosse roche », li mounté toujours, joug’ li rivé la lune avec z’étoiles. Pendant l’ pé mounté, papa composé a pé fignolé en haut z’outil là (la lyre) et pi la pé chanté samba, l’a pé parlé, parlé, parlé, joug’ li déparlé, des fois, et personne pas comprend’ li encore. Mais
mon m’a t’à voudré li conné quichose. Quand on mounté jusqu’en haut gros morne, on toujours trouvé fait frète. Yo même qui monté mille fois pli haut, yo di trouvé gros frète même, même. Alors yo di porté bon capote, bien chaud. Ensuite yo di prend temps, et mon pas crèr que y’a trouvé « tienda » catalan n’en chemin. C’é pour ça mon crér que yo dois gagné z’apparon avec Céron, pour porté provisions. Si cheval ou bourrique blanc dada la yo gagné z’ailes, nous mêm’, pauv’ diables créoles, nous pas gagné ça. Gagné crér les qui conné « Mounté Béf »[28], mais ça pas n’en gout mouin. M’a contenté mouin de gnoun piti bourriquet, bien tranquile, et mon va aller bien doucement. Comm’ça, si bourrique la butte, mon pas lé couri risque capé cou mouin. Quand à tout’ z’entraves à yo, zécac ![29] Nous conné or, z’ami mouin, ça nous doué attend’ di mouin. Agnen qui bien bel. Nic des bêtises, écrits n’en gnoun langue qui va faire nous songé bon temps jeunesse à nous. Si ça ennuyé z’auts, z’affaires z’auts !! Mon va rété, pas moins, bon z’ami et serviteur z’auts
|
Chères amies , Vous n'êtes pas sans savoir que les prétendus « auteurs » commencent toujours leurs ouvrages par quelques phrases rassemblées sous le nom de « préface », « avant-propos » ou « observations ». A mon humble avis, ils font cela pour se justifier, expliquer le pourquoi du comment, etc... Alors pourquoi ne ferais-je pas de même ? Si tel est la norme, nous nous croyons bien capable de nous y tenir. J'ai le plaisir de constater qu'ils sont classés en deux catégories, en rang d'oignons et d'échalottes. Les autres pourraient dire : « Tenez votre chien en laisse ! »[23] Ils diraient ainsi : « Est-ce qu'un vieux sorcier comme moi saura affronter leurs critiques, mon modeste cahier résistera t-il à leurs livres? » Non, mes chères critiques ricaneuses ! Inutile de me charrier, ma pédanterie n'ira pas jusqu'à faire passer mon petit cahier pour un livre. Mais je reconnais volontiers que « le chien de berger n'a point gagné tant qu'il n'a pas rassemblé son troupeau ». J'en reste là avec mes histoires. Cette petite causerie de préambule a pour objet d'expliquer comment diable je me suis trouvé dans ces affaires de versification, à l'âge où mes rares cheveux sont blancs et mes jambes tremblantes. C'est à mon frère, paix à son âme, que je le dois. Depuis son jeune âge, il connaissait quelques vers en français. Un jour, l'idée lui a pris d'en écrire en créole. Ces vers, je les trouvais pas mal troussés. Après sa mort, de bonnes amies m'ont priées de redonner vie à ses poésies créoles qu'il aimait tant écrire. Malgré mes recherches, je ne les ai point retrouvées. Bien des années sont passées jusqu'à aujourd'hui. En fouillant, j'ai découvert au milieu de vieux papiers crasseux, quelques brouillons de vers en créole. Il s'agissait de l'écriture de mon frère, couchée à la mine de crayon et passablement embrouillée. Quel travail se fût pour en déchiffer le contenu! Et encore, j’en ai déchiffré 8 ou 10, mais les autres je n’y suis pas arrivé. Même ceux que j’avais débrouillé, beaucoup de fragments manquaient. Je me suis fait violence à tenter de les reconstituer. Des heures à me gratter la tête, à frapper du pied, lever les yeux au ciel, suer sang et eau, pour arriver tant bien que mal au résultat présent. Après avoir liquidé la somme de travail des poèmes de mon frère, une idée a germé dans mon esprit : « Mesdames, chères belles amies,
vous qui affectionnez les vers en créole,
pourquoi je n'essaierais pas d'en écrire
moi-même ? Ne serait-ce pas le moment
de vous les écrire ? ». Certes, de poète je n'ai point le métier ; mais pour ce qui est de
la langue créole, personne ne saurait être
plus compétent ! Depuis mon plus jeune
âge, lorsque je prenais encore la têtée, puis
courant la campagne en chemise blanche, j'ai
eu coutume de fredonner ceci : « Chers amis, je ne suis point fini, la nation créole, c’est la
nation de ma mère ». C’est ma
nation et, sacredieu, pourquoi diable je
n'écrirais pas dans ma langue ? Ecoutez-moi bien ! N'allez pas croire que je puisse chanter comme un cordon bleu, point de danger!. Je ne connais pas les astuces en français pour chanter comme avec la "Lyre d'Apollon". Je ne sais manier les outils pour cela, et pour dire vrai, ne l'ai jamais entendu chanter. Tout cela ne m'empêche pas d'essayer de faire quelques chansonnettes, avec ma modeste banza créole Ce que j'ai appris de mon frère, comme des autres qui écrivent en créole, c'est de lui prêter autant de considération que celle que l'on porte à la littérature française. Nous nous sommes donc astreints à une série de règles qui sont issues de « L'art de la versification française »[31]. Certains de mes amis m'ont demandé si cela m'avait aidé. Pensez-donc ! Le français est une langue polie et repolie par les siècles, alors que le créole, pauvre diable, est né hier. Il babille encore, c'est une langue jeune qui ni se lit ni s'écrit. Dans
toutes les langues, une poésie existe et pour
toutes, des règles la régissent. Ce sont pour
la plupart les mêmes, avec quelques
particularités ça et là. On gagne à observer les particularités de chaque langue. Mais de toutes, c'est le français qui est de loin la plus complète. Des règles par ci, des règles par là, en haut et en bas ! Mais dans toutes ces règles, point de sottises ni stupidités. Comme celle-ci que j'affectionne : accorder les rimes en fonction du genre, masculin ou féminin. Dans quelle autre langue trouvons nous cela ? Des vers masculins ou féminins ! Si cela est aussi simple, comment se fait-il qu'en les mettant côte à côte on n’ait pas trouver le moyen qu'ils fassent des petits ? Fort bien ! On va mettre des genres également dans les rimes créoles. Pour y parvenir, il va nous falloir les priver d'une partie de leur beauté. On est contraint parfois d'adjoindre quelques mots de français. C'est une licence compréhensible, mais nous ne sommes donc plus dans le vrai créole. Cela ressemble alors à une sorte de parler où l'on essaie d'imiter le français. C'est ce que nous qualifions de « parler pointu ». Nous
croyons que si une poésie
fonctionne en français, pourquoi ne
pas l'accorder de même en créole? Demandez-vous si Byron, Pope, Shakespeare, Schiller, Goethe, Dante, Japes, Espronce n'ont jamais accordés une rime mâle avec une femelle ? Demandez-vous également si la poésie française du passé était plus belle que celle des auteurs sus-cités. On peut leur reconnaître cela, je les appelle les « académichiens ». Je ne trouve pas leurs règles bien justes. De ce que je lis de leur part, ce sont de vieilles badernes qui se disent auteurs, compositeurs ou quelque chose entre les deux. Je vieillis, fatigue plus vite, mais encore en alerte et pas encore bon à jeter. Moi et eux, ça fait deux. On a le même savoir-faire, mais pour ma part je revendique la liberté que ma langue courre la campagne à l'envi, en compagnie de mes vieux amis et animaux . Je n'en suis pas certain, mais ma pensée est de cet ordre. Leurs vieux corps se sont engraissés. Je ne crois pas que nous et eux ayons des liens de parenté. Ils ont fourré leur nez dans tout ce qui à trait à la littérature et aux auteurs. Ce sont les mêmes qui coupent, tranchent, censurent tout écrit ! Par dessus le marché, ce sont des gougnafiers, affublés de baguettes de tambour attachées au pantalon, d'habits galonnés, l'épée au fourreau et coiffés d'un bicorne. Ils se rassemblent de temps à autre, dans une grande case (ou dans un grand parc dont je ne connais pas le nom).[32] Dans ce lieu, le corps engoncé dans des fauteuils rembourrés, ils passent le temps à pérorer, leurs lunettes bien calées sur leur têtes en forme de calebasse ! Parfois l'un d'entre eux se lève et commence à égrener son discours stérile, sous le regard des autres se lissant la barbe, dans un demi-sommeil ou ronflant ouvertement. On appelle cela « les séances de l'académie ». C'est
à eux qu'il faudrait s'en remettre pour juger
les affaires de littérature ? Pour sûr,
ils ont la connaissance de la poésie, ses
règles de rime masculine et féminine.
Soit ! Nous parions être capable de
sortir quelque chose. J'en appelle à tous ces
auteurs, ces académichiens et leur dit :
voici deux vers, maintenant lequel est
masculin et lequel est féminin ? Vous
n'êtes pas foutu de répondre ! (pardon
Mesdames, mais ce mot là est correct en
créole). Que se passe t-il ? Avec tout vos discours fangeux, la poésie française ressemble à un cheval entravé galopant la campagne. Pour ce qui est de la poésie anglaise, italienne, espagnole le même cheval paraît livré à lui-même dans cette campagne. Quand nous marchons côte à côte, qui a la plus belle démarche ? Encore une comparaison : toutes vos règles, c'est pour rendre le calalou[33] meilleur. Mais vous ne souhaitez pas y mettre de piquant, trouvant le piment trop fort. Pas même un peu ? Pour un bon calalou, ne faut-il pas du piment et un tom tom[34] Soit, mes amis ! Nous mettrons des règles et entraves çi et là dans notre langue. Mais ne venez pas nous embêter, commander sous notre toit. Songez donc ! Mon cher créole, la langue apprise de ma mère lorsque je balbutiais mes premiers mots. Oh que oui ! Je me souviens quand elle me faisait asseoir sur ses genoux pour me conter tout bas des histoires. Et quand le sommeil me gagnait, la tête endormie sur sa poitrine, elle fredonnait : « Dodo, cher petit Si tu ne dors pas Le chien sauvage de maman viendra Tu t'en souviens, dis-moi ? »[35] Ah ! Qui de leur Victor Hugo, Shakespeare, Byron, Pindare et même du vieil Apollon serait foutu d'écrire quelque chose qui sonnerait aussi doux à mes oreilles que cette chanson là ? Marraine qui m'a baptisé, quand je l'entend, il me semble que le lait maternel gagne ma bouche ! Leurs
composés (ils les nomment poètes), si je les
comparais au règne animal, je ne saurais dire
s'ils sont chevaux, mulets, bourriques. Ces animaux là, ils sont ailés. Ce poète, on lui grimpe sur le dos, harnaché d'une selle et d'éperons, ou à crû. Mais pour les raisons citées plus bas, je crois que c'est avec des éperons. Une fois bien assis sur son dos, on lui met un bon coup d'éperon sur le flanc, et c'est parti ! La bête galope, monte, dépasse le Mogote et la Gran Piedra, continue de monter jusqu'à arriver dans la lune et les étoiles. Pendant cette chevauchée, papa-composé a eût le temps d'affuter sa lyre. Ensuite, il a entonné les chants du samba, en parlant, causant, éructant des paroles que personne ne pouvait comprendre. Mais comme on voudra, il sait de quoi il parle. Quand
on arrive en haut de la Gran Piedra, on trouve
toujours qu'il fait frais. Moi-même qui suis
monté bien plus haut, je me fais à chaque fois
la réflexion. Une bonne cape bien chaude sera
alors appréciée. Surtout, prenez votre, temps,
vous ne trouverez pas en route l’échoppe du
Catalan[36]
pour faire une halte. C'est pour cela
que je dois gagner mes éperons avec Cicéron
pour porter nos provisions Si
le cheval blanc a gagné ses ailes, nous autres
pauvres diables créoles, ce n'est point le
cas. J'aime à croire que nous pourrions monter
sur des bœufs, mais je n'en ai pas réellement
le goût. Sur ma petite bourrique je gravis la
montagne, prenant moins de risque à me rompre
le cou. Quand à toutes vos entraves, fi!
Je
suis un comédien mes amis, doué pour
l'attente. Un agneau qui bêle gentiment.
Foin
de ces bêtises, les écrits dans ma langue
créole vont me rappeller le doux temps de ma
jeunesse. Si certains n'y trouveront qu'ennui,
c'est leur affaire. Nous resterons tout de
même bons amis, et moi votre serviteur,
« Composé » (L’auteur)
|
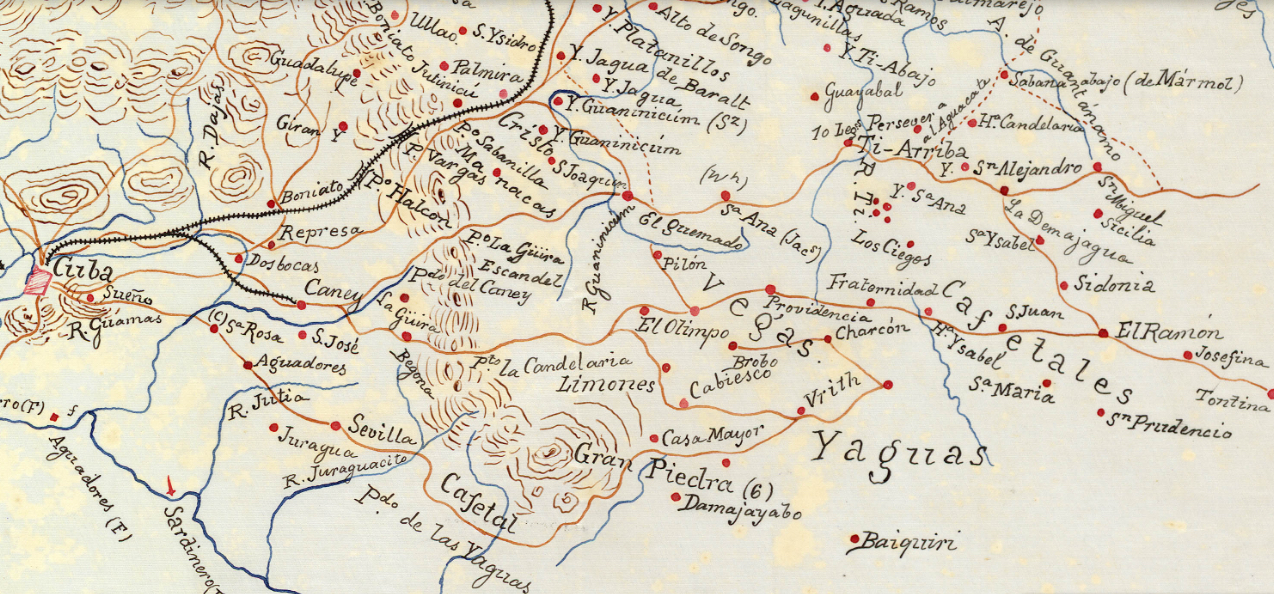
Carte
1 : Est de Santiago de Cuba ("Cuba") localisant la
Gran Piedra (19e siècle). La première propriété du
père de nos auteurs, La Soledad se situait
immédiatement au Nord du point rouge de
"CasaMayor".
Yo
va
conté
Chacha
roulé
Tambour
ronflé
Banza
sonné
Samba
chanté
Pour
plaisir
toué !
(extrait de
« Vini n’en Palène », texte complet
infra).
- La comparaison entre la lyre du poète classique et la banza du Créole proposant ses vers, en
l’occurrence
Hippolyte
Dandinot,
-
de même que le titre du recueil :
« Banza créole »
- et enfin la mise en situation dans le texte du
manuscrit de ce banza mêlé aux instruments connus
liés aux plantations des Français de Cuba :
sonnailles tchatcha, tumbas (tambours
emblématiques de la tumba francesa),
tout cela nous semble nécessiter un developpement
préalable aux transcriptions qui suivent.
Il y a quelque chose de très inattendu dans ce terme banza, ici considéré par l'auteur né à Cuba comme un terme évident et qui par contre n’apparaît jamais dans la litérature cubaine ou dans les vastes études des multiples instruments de la plus grande des îles Caraïbes. Par contre l’instrument n’a rien d’inconnu dans la colonie de Saint-Domingue, puis dans le Haïti du 19e siècle et en Louisiane (laquelle a d'ailleurs eu son lot de réfugiés de Saint-Domingue, comme Cuba)…

Détail
d’une banza haïtienne, XIXes.
(musée de la Philarmonie de Paris)
Surnommé le troisième découvreur de Cuba après Colon et
le géographe-cartographe Humboldt, Fernando
Ortiz a consacré 5 tomes à l’inventaire des
instruments cubain, son apport principal en
tant que troisième découvreur étant
l’afrocubanité, y compris dans ce domaine
musical.
Pas d’entrée banza dans ces 5 tomes, mais deux entrées successives concernant des « Instrumentos pulsativos » ayant des points en commun : « tre de güiro » (type particulier de tres/très) et l’entrée « banjo ». Le banjo est décrit au long de sept pages comme instrument afro-americain de la musique populaire et introduit à Cuba à ce titre. Ainsi apparaît sur les boîtes de cigares cubaines un yankee jouant cet instrument. A propos de l’origine du banjo, Ortiz se réfère à Hearn pour dire : «dans les Antilles françaises on connaît encore le banza, espèce de guitare formée d’une demi-calebasse comme caisse de résonnance, couverte d’une peau unie à un grand manche tirant quatre cordes. » Il mentionne que selon Sachs la banza est une guitare de quatre cordes des Noirs haïtiens. Il mentionne également que, dès le 18e siècle, Labat décrit une espèce de guitare jouée par « presque tous les Noirs », la description rejoignant celle de Hearn. « Certains, ajoute Labat, apprécient ses harmonies au même titre que les compagnons espagnols et italiens munis de guitare ». Ortiz ajoute : "cette guitare n’est rien d’autre que le banju". Dans les origines du mot banjo, aux côtés de banju, bant’you il n’oublie pas banza « venu du Congo ». Il cite enfin l’auteur Chatelain, qui n’a bien sûr rien à voir avec l’auteur des lignes présentes (je le crois louisianais), lequel soutient que le nom du banjo nord-américain vient du mot bantou mbanza, que les étrangers « prononcent banza ou banja ». Quant au changement du a en o, ajoute Chatelain, "il est fréquent dans la prononciation des mots bantous, de même que celle des anglophones quand ils parlent une langue romantique" (les différentes traductions sont les nôtres).
Il n’est pas anodin non plus –et Ortiz ne se prive pas
de son côté le rappeler– que
Moreau Gottschalk, Louisianais réfugié de
Saint-Domingue, intitule banjo une de ses
pièces évocatrices des plantations de
Louisiane.
En ce qui concerne l’entrée « tre
de güiro », Ortiz parle, sans
exemple précis, d’un instrument qui aurait
les cordes d’un tres (3 cordes doublées)
mais dont la caisse de résonnance ne
correspondrait pas à l’usage andalou, mais
était constituée d’une calebasse… comme la
banza (il omet de préciser toutefois,
l’usage probable d’une peau tendue, qui fait
de la banza, comme le dit Ortiz pour le
banjo "un fils androgyne de corde et
tambour").
Quatre décennies après Ortiz, le Centre cubain de la
musique (CIDMUC) reprend savamment l’étude
des instruments cubains pour faire part de
l’état de la recherche, en deux tomes et un
Atlas. [37]
Dans cette mise au goût du jour
disparaissent banjo et « tre de
güiro ». Il est facile de
conclure que pour les plus savants des
organoloques cubains contemporains, on n’a
pas eu connaissance et donc il n'y a pas eu,
de banza cubaine... du moins sous ce nom.
Mais Hippolyte Daudinot nous incite à penser
le contraire...
Par
contraste, la littérature concernant le
banza à Saint-Domingue est prolixe :
En 1810, un ex-planteur de la colonie de Saint-Domingue, Richard de Tussac, publie un livre intitulé Le Cri des Colons. Une grande partie a été écrite comme une réfutation du travail de l'abolitionniste abbé Grégoire, lequel avait critiqué les attitudes racistes, en partie en célébrant la culture musicale des personnes d'ascendance africaine réduites en esclavage. Ardent défenseur de l'esclavage, Tussac a répondu en arguant que c'était absurde et que la musique produite parmi les esclaves était celle de «barbares», p. 292). Ironiquement, cependant, afin de faire valoir son point de vue, il a offert un témoignage durable du talent artistique de ceux qui fabriquaient des banzas dans les plantations : "Quant aux guitares, que les nègres nomment banza, voici en quoi elles consistent : Ils coupent dans sa longueur, et par le milieu, une calebasse franche (c’est le fruit d’un arbre que l’on nomme calebassier). Ce fruit a quelquefois huit pouces et plus de diamètre. Ils étendent dessus une peau de cabrit, qu’ils assujettisent autour des bords avec des petits cloux (sic); ils font deux petits trous sur cette surface, ensuite une espèce de latte ou morceau de bois grossièrement aplati, constitue la manche de la guittare ; ils tendent dessus trois cordes de pitre (espèce de filasse tirée de l’agave dite vulgairement pitre) ; l‘instrument construit, ils jouent sur cet instrument des airs composés de trois ou quatre notes, qu’ils répètent sans cesse ; voici ce que l’évêque Grégoire appelle une musique sentimentale, mélancolique ; et ce que nous appelons une musique de sauvages. (Cité par duke.edu).
Avec pareilles conceptions de ce siècle, on ne sera pas étonné qu'Hippolyte Daudinot s'attende à un certain mépris en faisant de la banza un symbole de la culture créole.
Le naturaliste Michel-Etienne Descourtilz, offre lui aussi des détails à propos de l'instrument dans son volume 5 de sa "Flore pittoresque des Antilles", publié dans les années 1820, mais basé sur un voyage en Haïti dans les premières années du 19esiècle. Sa description de la banza est insérée dans une partie sur la “courge calebasse.” A propos de celle-ci, il note que les “Créoles et Noirs” des Caraïbes ont créé des plats aussi bien que “des banza, instrument nègre, que les Noirs préparent en sciant une de ces Calebasses ou une grosse Gourde dans toute sa longueur, et à laquelle ils ajustent un manche et des cordes sonores faites avec la filasse de l'aloe". (Cité par duke.edu).
Sur l’existence de
la banza en divers lieux :
- au Surinam : un "bania" construit par un esclave collecté vers 1770 est au Nationaal Museum van Wereldculturen (Pays-Bas).
-
à Saint-Domingue (colonie française) :
- après l'indépendance à Haïti : L’abolitionniste Victor Schœlcher ramène un banza d’Haïti en 1840 qu'il donne au musée du conservatoire de la Ville de Paris (reconstitué en 1997 après démontage et stockage prolongé, l'instrument est actuellement dans les collections de la Philarmonie de Paris). Description muséale de 1874 : « Cette sorte de guitare, montée de 4 cordes et d’une forme très pittoresque, est d’un usage général parmi les nègres de Saint-Domingue” (comme souvent à cette période Saint-Domingue, en quelque sorte par habitude, est mis à la place d’Haïti). C'est l'instrument de la photo vue plus haut.
Différents détails de la banza rapportée par Schœlcher sur cette page : https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/doc/MUSEE/0157295
- En
Louisiane :
Dans
sa
description de Congo square Benjamin Henry Boneval
Latrobe, Impressions Respecting New Orleans,
Diary and Sketches, 1818-1820, termine
en décrivant un instrument à corde qui pour lui
est le plus remarquable des instruments de cette
concurrence, dont il dessine par ailleurs deux
tambours. Mentionnons qu’à cette époque les Noirs
venus de Saint-Domingue formaient une part
importante, sinon prépondérante de la population
qui se rassemblait à cet endroit devenu mythique
dans l’histoire de la musique afro-américaine.
Latrobe voit cet instrument, réduit à deux cordes,
comme venu d’Afrique et le dessine :
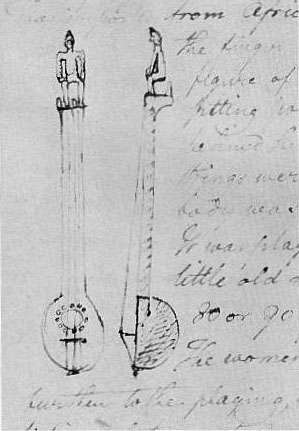
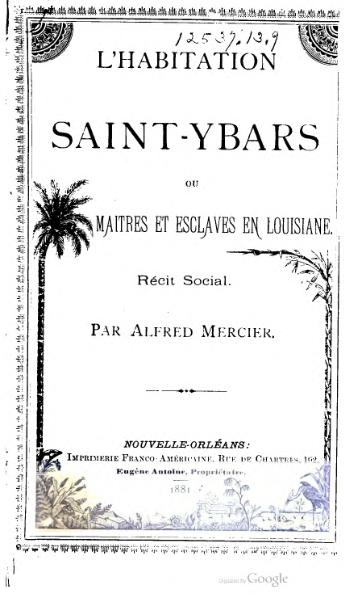
Jusqu’ici nous
avons, à propos de la banza :
- un instrument bien repéré dans les Antilles, en particulier françaises ("On le trouve un peu partout dans (nos) îles", écrit Labat en 1820), puis transporté par des réfugiés de Saint-Domingue en Louisiane. Un instrument à quatre cordes. Toutefois des descriptions mentionnent trois cordes de longueur égale et une corde plus petite, trois cordes plus une pourrait-on-dire...
- une autre apparition dans le Sud états-unien anglophone : en Caroline du Sud comme l'atteste l'illustration atribué à John Rose, antérieure à la chute de la colonie de Saint-Domingue.
- la révélation qu’apporte Hippolyte Daudinot, né à Cuba rappelons-le, de la permanence de cet instrument chez des héritiers des réfugiés de Saint-Domingue à Cuba. Sans qu’il en soit fait de représentation graphique, comme c'était le cas de beaucoup d’instruments populaires et/ou d’origine africaine dans ce siècle. Il semble disparaître avec les incendies de plantation et la fin de l’esclavage dans la deuxième moitié du 19e siècle. Avant que nous rendions public son manuscrit, il n'était repéré qu'une seule mention comportant le nom de l'instrument, mention qui pouvait jusque là être prise comme anecdotique : un joueur de banza "haïtien" nommé Lorenzo, un musicien des rues, se fait arrêter à La Havane en 1808 (DUBOIS. 2016). Ne serait-ce pas en fait un réfugié de Saint-Domingue qui cherchait à gagner sa vie avec son instrument?
Le tres,
consacré aujourd'hui instrument national
cubain, a partié liée avec la famille de la
guitare espagnole, c’est indéniable… Mais dans
les cas où sa caisse de résonnance a été une
calebasse, ce sur quoi nous allons revenir, il
a été proche de la banza (et sa voisine?).
L’origine du cuatro
cubain, instrument minoritaire, est assez
mal connue, même de ceux qui en sont les
actuels virtuoses. Le chiffre de quatre
cordes interroge : et s’il y avait eu un
certain moment des transculturations, pour
reprendre la terminologie de F. Ortiz, entre
tres,
cuatro et banza? Faute du repérage
jusqu'à cet article d'un cordophone à quatre
cordes à Cuba au
19e siècle,
ce sont des influences d'autres îles
hispaniques, sinon du continent, qui ont été
invoquées jusqu'ici pour expliquer sa
présence en ces lieux. Mais le cuatro
cubain ne reproduit pas purement et
simplement le cuatro venu d'ailleurs, ni
dans sa technique instrumentale, ni son
accord. Il y a de multiples façons de
l'accorder, qui ne sont pas celles "de
l'extérieur". Certes Maduro a dit dans une
interview des années '80 avoir appris d'un
porto-ricain dans une centrale sucrière.
Mais le reste du temps il disait n'avoir
jamais reçu d'enseignement, que son don lui
venait... d'un esprit ("un muerto")
familier!
Pour comble de
mystère, du premier des interprètes du tres
connus au 19e siècle, Nené
Manfugás, venu de la zone de Baracoa, qui
apporta l’instrument dans les carnavals de
Santiago de Cuba en 1894, on ne sait que
très peu de choses, mais ont sait au moins
qu’il était d’origine
« haïtienne » (à cette époque la
précision "domingoise" a plus de chance
d'être vraie : l'immigration économique
haïtienne est postérieure) et que son
instrument paraissait étrangement
rustique aux trobadores
(troubadours) urbains coutumiers de la
guitare espagnole. Il pourrait très bien
relever du "tre
de güiro" décrit par Fernando
Ortiz...
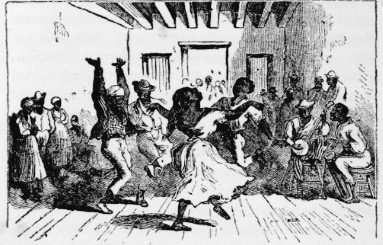
Une dernière mention est décalée géographiquement par rapport aux observations précédentes. Samuel Hazard (1834 - 1876) donne dans Cuba with pen and pencil une description faîte dans les années 1860 (contemporaine de la période où Hippolyte quitte Cuba), qui n'a sans doute pas suscité l'intérêt quelle mérite. Une fête dans un cabildo du quartier Egido, une fête de Noirs donc, près de la muraille de fortification, signale la présence d'un banza mêlée à des tambours, à La Havane. Elle joue un ostinato (qualifié par lui de "tum-tum") et est clairement décrite comme construite à partir d'une demi-calebasse. Sa description est accompagnée de l'illustration ici présente (pp.196-197, vol.1, édition anglaise de 1928). C'est la deuxième mention d'un banza à La Havane, mais ici formant partie "du paysage", d'une tradition. S'agit-il d'un cabildo de "noirs français" comme il y en a eu deux à La Havane? Impossible de le dire (on peut exclure le plus repéré des deux, le cabildo La Francesa, situé dans le quartier de Cayo Hueso). Une alternative serait un cabildo de tradition mandinga (mandingue) avec son cordophone (banya?) et une transmission directement africaine... Hazard appelle l'instrument banjo, selon ses propres références et il lui rappelle ce qu'il a vu dans les plantations du Sud des États-Unis. A cette date et cet endroit, difficile d'imaginer une influence extérieure récente.
Une "idée du banjo" apparaîtra plus tard, à la fin du 19e siècle dans la musique cubaine, une idée et non réellement la chose : la viola qui accompagnait les chants des coros de clave de La Havane avait la silhouette d'un instrument à cordes avec son grand manche enrubanné, mais de cordes il n'y en avait pas, par contre la peau tendue comme sur une banza, oui; c'était une percussion déguisée, propre à échapper aux interdictions de tambours.
Il est possible qu’on ne puisse jamais vérifier s’il y a eu des influences mutuelles entre tres et cuatro d’une part et le banza d’autre part, cet instrument dont tout le monde avait oublié qu’il avait été présent dans des communautés aujourd’hui connues comme haut lieu du changüi et de formes primaires du son, jusqu’à ce qu’apparaisse dans les lignes présentes qu’il faisait partie du paysage culturel d’un planteur de cette zone, élevé par des domingoises attachées à leurs traditions créoles (cf. infra sur les sœurs Brun) et dont le nom de famille, Daudinot, fait partie des noms aujourd’hui courants autour de Guantanamo.
Il y a des relations postérieures entre les musiciens cubains et le banjo. Des soneros tresistes ou guitaristes cubains ont dû se mettre au banjo, afin de gagner leur vie, pour jouer le jazz des années '20 en Europe et aux USA avant que la musique cubaine soit à la mode. A l'inverse, entre autres exemples, un banjoiste noir venu avec les troupes américaines avant l'indépendance à Santiago de Cuba , "Santiago" Smood est mentionné pour transmettre la technique de son instrument, mais aussi se mettre au tres et jouer avec les soneros au début du 20e siècle à La Havane, où il meurt en 1929...(cf page Santiago Smood sur montunocubano.com)

Détail
de The Old Plantation, gouache attribuée à
John Rose, propriétaire de plantation,
Beaufort County, Caroline du Sud, 1785 – 1790
Nous
conseillerons au lecteur la patience dans la
découverte de ces textes, car il lui faudra
attendre le dernier pour une révélation de taille,
qui donne aux vers de l'auteur, qu'il a présenté
sans prétention dans le Piti causement, une
dimension littéraire inattendue...
Blancs
Dada
et langue créole
Les soulignements sont dans l’original.
|
Original |
Créole haïtien contemporain |
Traduction en français |
|
Blancs dada la yo, yo capab di yo drole ! Quand vero[38]
yo v’lé compose en langu’ créole, Ou bien capab jouré, com’ça, Vens (?) la yo va gnoun charabia, Qui pas créole et pas français non pli, Qui pa Congo, qui pas Calabali[39] Pour dir’ ou vuèr, yo
ta di voir Au lieu de nouér, ça
toujours noir Si c’é gnoun homm’, yo
va dir’ ou homme En guise com’, yo va metté comme
Com’ nous jamais yo ta dir’ ou, Ya pincé bouche et y’a dir vous.
Yo di com ça, gnoun rime do garçon, L’aut’ rime faut li femme – qui raison ? L’aut jour mon mandé gnoun Anglais, Di n’en lang’li com’ si en français, Aime tantôt doné mâl, tantôt femelle, Sans quoi jamais vers la yo pas lé belle. Li ni, pi li répond : « nen moune » « N’en toute nachon c’é
français gnoune ». « Qui n’en vero yo metté z’affair pareille ». « Gnoun fois vers la donné( ?) bien n’en z’oreille », « Nous mêm’ pas soucié gnoum piment » « Coté yo prend li, ni comment » En France, gagné gnoum mouché Boileau, (Et d’auts encor- mon pas songé nom yo) Qui toujours cherché piti bête ; Qui bail’ vers français barbouquette Si c’est plaisir yo, yo gagné raison Z’affair cabrit c’é as z’affair mouton. Pour yo « L’Art poëtique Français C’é l’Evangil’ – pour nous jamais ! Nous mém’, créoles, pour l’art poétique Et pour Boileau, nous pas lé fouti[40]
– gnoum chèque ! Anglais yo di, doné tout’ anglais Français, toujours, faut yo Français. Si Pagnols, toujours, c’é Pagnols Pourqui Créols pas lé créols ? |
Blan chwal la yo, yo kapab di yo dwòl Lè veron yo vle kompose an langaj krèyol Oswa ou pral kapab fè sèman tankou sa .........la yo va ke nou no bavardaj Ki pa krèyol e pa franse non pli Ki pa kongo, ki pa Karabali Pou di wè, yo ta di « voir » Olye pou yo di nwè, sa toujou « noir » Si se ke nou no lòm, yo va di w « Homme » Nan plas kòm, yo va mèt « Comme » Kòm nou janmè yo ta di ou Kounye a pinse bouch e kounye nou pral di « vous » Yo di komsa, ke nou rim do gason Lot rim fot li fanm, ki moun ki dwat? Lòt jou a yo te mande m 'nan lang ke nou angle Di l 'nan lang angle kòm si li te an franse Mwen renmen bay gason oswa fi Sinon pa janm la yo pale bèl Li nye, epi li di : « nèn moun » Nan tout nanchon se franse ke nou Ki nan veron yo antre nan zafè yo Ke nou no bay nan sans sa a, ke li vin ansanm byen Nou pa renmen ke nou pran pik Ki kote yo pran li, ni kouman An Frans, ganye ke nou monchè Boileau E toujou lòt yo pa sonje nonm yo Toujou ap chèche pou ti bèt la Ki bay nan franse …....... Si se plèzi yo, yo ganye rezon Zafè kabrit se pa zafè mouton Pou yo, atizay franse powetik Se levanjil la pou nou janmè Nou menm krèyol pou atizay powetik Epi pou Boileau, nou pale fou ti ke nou no tcheke Angle yo di, bay tout angle Franse toujou, ou dwe yo franse Si panyòl toujou se panyòl Poukisa kreyòl pa kreyòl?
|
« Le cheval blanc », ils peuvent dire qu'ils sont drôles...
Quand les bigleux veulent composer en créole
Ou bien se dire capable de le faire à la régalade
Cela peut devenir rapidement du charabia
Ni du créole, ni du français
Ni du congo, ni du carabali
Pour dire wè, on dira « voir » Au lieu de dire nwè, on dira « noir »
Si ce n'est que de nous lòm, on dira « l'homme »
En guise de kòm, on mettra « comme »
Comme nous vous aurions jamais dit
"ou" Désormais on se pince la bouche et l'on dit « vous »
Ils ont tôt fait de dire qu'une rime est masculine
Et l'autre féminine, qui croire ? L'autre jour, c'est en anglais qu'ils m'ont interrogés
Ils m'ont parlé en anglais comme si c'était mon français
En passant du masculin au féminin
Sans jamais parler correctement
I Ils me répondirent : « Petit gars, de toutes les langues, c'est notre français le
meilleur
Seul un ignorant se lançerait dans cette affaire.»
Nous ne somme pas d'accord, cela sonne agréable à l'oreille
Nous même ne nous soucions pas que les gens pimentent (leur langage)
En France, c'est sûr que votre cher Boileau
Et d'autres encore dont je tairais les noms
Seraient toujours à chercher la petite bête
Qui donnerait son créole pour le français, par ma barbichette !
Si tel est leur bon vouloir, alors ils auront raison
Une histoire de cabrette n'est pas une histoire de mouton
Pour eux, « l'Art poétique français »
C'est l'Evangile, pour nous que nenni.
Nous les créoles avons aussi notre poésie
Mais pour Boileau, notre parlé est un peu fou, je vous fiche mon billet
L'anglais pour tout dire, je vous le rend
En français toujours, nous devons parler
Si pour les espagnols, c'est l'espagnol
Pourquoi pour les créoles ne pas parler créole ?
|

Vini
n’en
palène / A Palène nous irons
A première vue, on a une romance de tourtereaux dans un
cadre champêtre, une vision rousseauiste… Mais ceux
qui vont « n’en bois » à cette époque dans
cette île, c’est pour se cacher et sauver leur peau
noire réduite aux brimades de l’esclavage, un monde
où ne sera pas reconnu l’espoir de vivre le couple
de son choix. Le narrateur serait donc un fugitif
(marron) enfui avec sa belle. Il souhaite organiser
des fêtes avec plein de monde, on passerait alors
dans un palenque,
l’équivalent du quilombo[41]
brésilien.
Le paradoxe est qu’un propriétaire d’esclaves, comme
Hippolyte Daudinot, soit en empathie avec les
aspirations à la liberté de fugitifs.
A cet endroit idyllique, d’espoir de libération,
l’auteur donne le nom de Palène : ancien nom de
la plus occidentale des trois presqu'iles de la
Chalcidique (Grèce). L'auteur a une culture
d'helléniste. Il nous l'a déjà prouvé (cf. Hélicon).
Il utilise l'image de ce lieu lointain comme un
éden.
Ce texte est particulièrement évocateur des chants et
danses des Noirs des caféières des Français établis
à Cuba, dont des éléments seront perpétués dans la
tumba francesa : les danse mason et yuba
de cette dernière ont été fondées en réunissant des
éléments au départ séparés tels le baboul /
babúl et grayimá / gragement dont
il est ici question. Le chacha agité,
dit-on au départ sans intention de pulsation
rythmique, s’unit de la même manière aux tambours.
Le bien manger des mets créoles s’unit aux chants,
danses et musique comme indissociable d’un certain
idéal de vie.
De même que dans la préface, Hippolyte Daudinot
mentionne l’instrument banza comme présent dans
cette communauté, ce qu’aucun texte cubain connu
n’avait jusqu’ici mentionné. Le simple fait que ce
poème cite le banza et que celle-ci donne son titre
à l’ensemble du recueil, donne une importance
particulière à ce poème au sein de ce dernier.
Le terme bantou Samba, qui figure ici n’est, lui, pas
habituel pour les chants afro-cubains, il n’a pas
été sélectionné dans l’histoire de la culture
populaire cubaine. Mais il a été connu comme
synonyme de danse, ainsi un informateur de F. Ortiz
nomme à Matanzas un tambour samba ngoma
(danse tambour). (cf Instrumentos
de la música folklórico-popular de Cuba.
CIDMUC. La Havane t. 1 p. 189). Surtout, il se situe
dans la tradition du samba chanteur
soliste de la colonie de Saint-Domingue, continuée
dans la République d’Haïti.
Terminons en remarquant que nous trouvons une
musicalité particulière à ce texte, qui pourrait
induire à le faire fporter sur partition...
|
Créole original |
Transcription en créole haïtien actuel |
Transcription en français |
|
Gardiens moutons gardé z’étoiles Matelots toujours gardé voiles Soldats bonjour, délivre drapeau Source toujours, cherché gros d’eau Mais quant à moué, La sur la terre En haut n’en lair, Et n’en la mer, Mouin crier victoué ! Comment cœur mouin capab content Quand to metté[42]
li n’en tourment ? Pour bonheur nous, vini n’en bois Volontés toué pour mouin va loi Vou vré avec toué N’en piti coin, Là bas, bien loin, Ça m’a besoin, Toué côté moué ? Nou va chasser cochons marrons Et zagoutis bien gras, bien bons Chember cribich’s[43]
pour calalou Planter gombos, bananes et choux Bonheur s’enoué[44] Pa toué bel rose, Et bel quichose Qui ma compose Pour plaisir toué. Et n’en joupa n’a fignoler « Grag’ment », « baboul », nous va danser Rir’, manger, bouér, et fair’ l ‘amour, Ça va travail nous tous les jours ! Yo va conté Chacha roulé Tambour ronflé Banza sonné Samba chanté Pour plaisir toué ! Oui, n’en Palène, vini, vini ! Avec blancs, compte à nous fini ! |
Gadò mouton ou kenbe zetwal yo Maren, ou kenbe vwal yo Sòlda bonjou delivre drapo Sous toujou, t'ap chache gwo dlo Men, pou mwen Gen sou latè Anwo nan lè E nan lanmè Mwen kriye viktwa Kouman kè mwen kapab kontan Lè tò mete li nan touman Pou bonnè nou vini nan bwa Volonte ou pou mwen va lwèn Mwen di vre avek ou Nan piti kwen Laba chay lwen Sa mwen bezwen Jwe w kote m 'yo ? Nou pral ale ak lachas kochon an mawon E zagouti trè grès Chache gribich pou kalalou Plante gonbo, banan e chou Bonnè se mare Pa ou bèl roz E bèl bagay Ki m'a kompose Pou plèzi w E nan joupa nou a fignoler[45]
Grajman, baboul, nou va danse Ri, manje, bwe e fe lanmou Twòp travay nou tou li jou o Yo ale konte Tchatcha woule Tanbou ronfle Banza sonnen Sanba chante Pou plèzi w Wi nan Palènn vini, vini ! Avèk blan yo, nou fèmen kont yo |
Gardiens de moutons, vous gardez les étoiles
Matelots, vous gardez les voiles
Soldats bonjour, délivrez le drapeau
La source grossit toujours en ruisseau Mais pour moi
Là sur la terre
En haut dans l'air
Et dans la mer
Je crie victoire !
Comment mon âme saurait se satisfaire
Quand les adversités la tourmente
Pour notre bonheur, nous sommes venus dans ces bois
Ta confiance en moi est grande
Tu es vraie avec moi
Dans notre petit coin
Là-bas, bien loin
De cela, j'en ai besoin
Veux-tu jouer à mes côtés ?
Nous allons chasser des porcs sauvages
Des agoutis bien gras, bien bons
Chercher des écrevisses pour le calalou
Planter des gombos, des bananes, du chou
Le bonheur s'est noué[47]
Grâce à toi, belle rose
Et la belle chose
Que je viens de composer
C'est à toi que je l'adresse
Et un jour notre cabane nous fignolerons
On dansera le gragement et le baboul De rire, manger, boire et faire l'amour
Le travail, tous les jours,
c’est est
fini.
Ils raconteront
Au son des sonnailles
Aux roulements des tambours
La banza sonnera
Le samba[48]
chantera
Pour ton bon plaisir
Oui, à Palène nous irons, oui nous irons
Avec les blancs, nous en avons finis !
|

Environs
de
la Gran Piedra.
Lui-même divisé en quatre parties
Piti jour (Au petit matin)
Midi (A midi)
Soleil couché (Au crépuscule)
Minuit (A minuit)
Extrait de « Midi » :
Merci
bomghé[49] !
souffrance à moin finie (Merci
mon bon, ma souffrance enfin cesse)
Cœur
mouin content tout plein…
(Mon cœur est si content)
Fin de « Minuit » :
|
Original |
Français |
|
… L’amour, avec jeunesse allé. Com’ça, N’en case à blancs, tout comme n’en joupa Lorsque « filloll[50]
mourri, commér caba » ![51] « Chagrin l’amour Duré touté la vie ; Plaisir l’amour Duré mi gnoun seul jour ! |
… Avec ma jeunesse, l'amour s'en est allé Dans les habitations tout comme dans dans les barraques[52] Comme dit le proverbe : « La mort d'un enfant met fin à toute
polémique » Chagrin d'amour Dure toute la vie Plaisir d'amour Ne dure qu'un seul jour |
Les quatre derniers vers sont une version créole de la
romance « Plaisir
d’amour ». Elle est extraite à l’origine
d'une nouvelle de Jean-Pierre Claris de Florian,
Célestine, qui figure dans son recueil Les
Nouvelles de M. de Florian édité en 1784.
Mise en musique par Jean-Paul-Égide Martini la
même année, elle est initialement connue sous le
titre La Romance du Chevrier. Une chanson-phare du
chansonnier francophone.
Suit un poème peu lisible pour en réaliser la
transcription : Misèr
gâté Vaillant
Beauté
Ibo
Citation de Virgile en exergue, "Vera incessu patuit dea" : Par sa démarche elle révèle une véritable déesse (Incipit du chapitre 3 "La démarche" du livre cinquième).
Nous nous serions bien passé de transcrire et traduire
ce poème, s’il ne témoignait pas de la présence de
diverses danses dans les plantations de Français
dans l’Orient cubain : mason, babul, congo
qu’on devinent policés et élégants qui sont opposés
ici dans leur caractère à ibo et chica
zombi, supposés rustres voire sauvages
quoique gais et érotiques.
Mais l’humour ravageur, « hénaurme » dirait-on aujourd’hui, d’Hippolyte crée un malaise certain dans sa moquerie d’une femme noire rustre adressé à de « belles dames » tournée sous forme de gauloiserie rabelaisienne. Les préjugés raciaux, lui qui est pourtant fils d'une métisse (dans la classification de l'époque il est un octavon), ressortent comme dans aucun autre de ses écrits…
L’association de congo aux danses mason
et babul, qu’on connaîtra par la
tumba francesa, laisse penser qu’il
s’agit de danses cérémonieuses en robes
longues pour les femmes, connues à Cuba
comme celles de « congos
royaux » (congos
reales). A
Santiago, les affinités entre les
danses du cabildo congo, le plus
important de tous, et celles de tumba
francesa on été bien repérées.
|
Dialecte original |
Créole haïtien moderne |
Français |
|
|
Ah mon gagné gnoum bel
dom[53] bou Bel joug'temps li
rend mouin fou Z'yeux li, yo gros
passé(?) z'yeux bèf Tête a li c'é gnoum
giromon[54], Poitrine a li c'é
"dagunate"[58] Pieds li, m'a di deux
belles gnames, Quand li marché, la bel
commère Bras li, mains, li to
toujours prêts, sans gnoun raison, pour fouti (écrit f_) souffets Ou bien semblé voix
vingt taureaux Boundghé conné qui bel
quichose Et quand li lévé gnoun
samba Com li pour fignoler
"mazone", Ha!! quand li bail'
"chica Zombi", Yo di li sott' - pétét
c'é vrai , Gagné des jours li
renfrogné Semblé tout' moun',
quand li dansé Aç'tor, chers z'amis
mouin, mon mandé vous, |
Mwen ganye que moun bèl
fanm bou Zye li, yo gwo pase zye
bèf Tèt a li se ke moun
joumou Tete[61] li se "dagunate" Pye l 'yo, yo sanble de yanm bèl Lè li mache, bèl kòmè mwen Bra l 'yo, men l', yo
toujou pare pa fè anyen men fanatik tèt yo Oswa sanble tankou nan
ven bèf Bondye konnè m'ki bèl
bagay Men, lè samba yo leve Men, asire mason la Ah! Lè yo bay yon chica
zonbi Mwen te di yo sòt, li ka
vre, Kèk jou nou ap zeklè Sanble tout moun kan li
danse |
Si je peux gagner
n'importe quel beau brin de fille Ses yeux sont plus gros
que ceux d'une vache Une tête comme une
citrouille Sa poitrine c’est
"dagunate" Ses pieds, on dirait deux beaux ignames Quand elle marche, ma belle commère Ou ressemble à celle de
vingt taureaux Bondieu, j'en connais un
rayon Et quand se lève le
samba Ah! Quand elles donnent
un chica zombi[64] Je les ai dit sottes,
c'est peut-être vrai, Des jours on est
renfrognés |
|
Compèr
Malice
et compèr Bouqui
Compèr bouqui est un corpus de contes transmis par
les esclaves à Saint-Domingue.
Ces contes, mettant en scènes deux compères, existent
toujours en Haïti. Le compère complétant compère
Bouqui (le bouc) varie : Compèr Malice et
compèr bouqui, comme ici, ou Compère
Bouqui et compère Lapin. Un malicieux
(Malice, Lapin) et un berné (Bouqui).
Pour comparer, on pourra lire un conte de compère
Malice et compère bouqui haïtien : https://www.wattpad.com/295199550-contes-créoles-l%27histoire-de-bouqui-et-malice…
Ils ont été transportés
également à la Nouvelle-Orléans en témoigne la
lettre du musicien louisianais Moreau Gottschalk,
décrivant sa fascination pour les contes de compèr
bouqui racontés par de vieux Noirs venus de
Saint-Domingue avec les descendant français
Moreau) :
« La veillée se terminait ordinairement par les
merveilleuses aventures du compère « Bouqui » (le
Jocrisse des nègres), que nous récitait pour la
centième fois quelque vieux noir de l’habitation.
Une singulière particularité des contes nègres,
c’est qu’ils sont généralement précédés de certaines
formules bizarres, de paroles sacramentelles dont le
sens mystérieux nous échappe, mais dont l’origine
est évidemment africaine. Avant de commencer, le
conteur prononce à haute voix le mot : «
Tim-tim » ; l’un des assistants répond
gravement : « Bois sec ; »--« Bois cassé, tchou
macaque ! » ajoute un troisième, et seulement
alors le conte commence. J’écoutais chaque soir avec
un plaisir et un intérêt toujours nouveaux, les
tribulations de Bouqui, bien que je les susse par
cœur ».[66]
Dans Ainsi parla l’oncle, Jean Price Mars
proposait de réinterpréter le personnage de Bouki
comme le descendant du nègre bossal, fraîchement
débarqué d’Afrique « dont la lourdeur et
la bêtise étaient l’objet de nombreuses brimades et
d’impitoyables railleries, « tandis qu’il voit
chez ti-Malis la personnification du nègre créole
condidéré comme plus adroit et même un peu
finaud ». (Prudent).
Ce conte fait 9 pages et nous remettons à plus tard sa
transcription complète.
Au début :
« Tim tim, bois
chèche,
Piti bois cassé n’en… con macaque
Poule… voté, mal fini
prend »
Il est une fois ponctué de « Zekak ! »
Il y a deux autres protagonistes : serpent et
cheval. L’histoire se termine mal pour Bouqui :
« C’est fin Bouqui, li kikribu »
(c’en est fini de Bouqui, il est mort)
On reconnaît le mot présent dans la très connue et
allègre chanson cubaine « La Negra
Tomasa » (un son)
: « Kiquiribu mandinga », expression qui
signifie « il est mort le
mandingue ».
Dans une première partie, Hippolyte met en parallèle
les contes créoles de compère bouqui avec les
personnages de Robert Macaire et
« compère » Bertrand.
Un vers de fin est détaché du texte, comme une morale,
entre guillemets :
« Faire coquin pas mal, c’é rend’ compt’ qui
mal ! » (C’est mal agir que ne pas punir
un mauvais drôle).
Nous passerons sur les poèmes et contes suivants :
Macaque conné parlé (Un singe qui sait
parler), Vapeur, ‘tricité et femme, Mouché
Barbe bleu, un longue version de Histoire de
Barbe Bleue, La Reine fleurs, le satirique Piti
Breton tête dur (Les Bretons ont la tête
dure, jusqu’à Cuba !). Suit un poème malicieux,
« Non » femmes, souvent c’é
« oui ». Le narrateur fait
effectivement dire un ultime « non » à la
femme qui n’a que cette seule réponse à la bouche
face aux sollicitations succesives du narrateur,
mais la malice de la question fait que ce non lui
fait dire en fait un acquiescement.

C’é
Zombi
Un mort-vivant
(zombi) aux yeux enflammés apparaît à une petite
fille portée par son père dans une chevauchée sous
l’orage. Le zombi l’appelle et l’enfant meurt.
Saisissant drame tropical, non? Mais nous réservons
une belle surprise au lecteur après la reproduction
du texte!
|
Dialecte original |
Créole haïtien moderne |
Français |
|
Qui moun’ qui passé cou
z’éclair, Si tard la nuit, n’en vent, n’en puie ? Tête baissé et queu’ n’en l’air, Cheval la semblé gnoum furie. Papa qui porté pitit li Qui cas li même à faire l’orage ! Piti la di li ouér zombi : La pé crié et fair’ tapage. Papa ! ou(?) pas ouér zombi là ? Z’yeux li clairé semblé chandelle ! Mais non, chérié, à pas rien ça ! Fermé z’yeux toué, t’en pri, ma belle ». « Papa ! Zombi la hélé mouin ! » « Mais non , c’é feuilles la sus tête ». Li v’loppé pitite avec soin. Pauvre papa ! li pas n’en fête !
Enfin, li rivé cas à li. Vite li couri n’en lumière. Mais li trop tard. Piti mouri Seul besoin li, cé gnoun prière ! |
Ki moun ki pase kou zeklè Si na mitan lanwit nan van, nan pli Tèt anba e ke nan lè a Chwal la sanble kòm gran kolè Papa ki pòt pitit li Ki ka li menm fe loraj Pitit la di li ou wè zonbi La pe kriye e fè anpil bri a Papa ou pa wè zonbi la Je yo ki limen li sanble tankou chandèl Men, pa gen cheri, a pa ryen sa ! Fèmen je ou, tanpri manman mwen
Men, pa gen okenn, fèy yo gen sou tèt ou Pral pran swen ou Pov Papa ! Li pa nan fèt !
Finalman li egzamine ka a li Li vit kouri nan limyè a Men twò ta, pitit mouri Tout sa ki rete yo dwe fè, li di yon lapriyè |
Qui va là sous la foudre qui tonne Au milieu de cette nuit venteuse et pluvieuse ? Courbant l'échine et la queue dressée Le cheval semble furieux Le père porte l'enfant Sans faire cas de l'orage L'enfant lui dit : « Père, voyez-vous le zombi ?» « Père, ne voyez-vous pas le zombi ? Ses yeux luisant ressemble à des chandelles » Mais non, ma chérie, ne t'inquiète pas Fermes les yeux, je t'en prie ma belle Papa, le zombi m'appelle ! Mais non, ces feuilles sur ta tête T'envelloppent et te protègent avec soin[68] Pauvre père, ce n'est point sa fête
Quand il peut enfin examiner sa fille Après s'être hâté vers la lumière C'est trop tard, elle est morte Son seul besoin, c'est de lui dire une prière ! |
Qui
chevauche si tard à travers la nuit et le
vent ?
C'est le père avec son enfant.
Il porte l'enfant dans ses bras,
Il le tient ferme, il le réchauffe.
« Mon fils, pourquoi cette peur, pourquoi
te cacher ainsi le visage ?
Père, ne vois-tu pas le roi des Aulnes,
Le roi des Aulnes, avec sa couronne et ses longs
cheveux ?
— Mon fils, c'est un brouillard qui traîne.
(...)
— Mon père, mon père, et tu n'entends pas
Ce que le roi des Aulnes doucement me
promet ?
— Sois tranquille, reste tranquille, mon
enfant :
C'est le vent qui murmure dans les feuilles
sèches.
(...)
— Mon père, mon père, et ne vois-tu pas là-bas
Les filles du roi des aulnes à cette place
sombre ?
— Mon fils, mon fils, je le vois bien :
Ce sont les vieux saules qui paraissent grisâtres.
(...)
Le père frémit, il presse son cheval,
Il tient dans ses bras l'enfant qui gémit ;
Il arrive à sa maison avec peine, avec
angoisse :
L'enfant dans ses bras était mort.
Le début est commun, avec sa forme interrogative pour planter la scène, le final tragique de la découverte de la mort de l'enfant aussi, non expliquée de manière littérale dans les deux cas et entre les deux la même frayeur de l'enfant devant l'apparition surnaturelle que le père ne voit pas pour sa part et ne prend pas au sérieux. Le détail commun des feuilles est sans équivoque sur le lien étroit entre les deux textes, malgré une signification différente de cet élément. Daudinot a simplifié la situation en retirant le rôle des filles du roi des aulnes. Une différence est que Goethe parle d'une relation père-fils (donnant lieu à des interprétations psychanalytiques du texte) et qu'ici la victime est une petite fille.
Il
est possible qu'Hippolyte
Daudinot cumule ici, dans ce texte inédit,
deux premières : l'adaptation en créole de
Goethe (en tout cas en créole véhiculé à
Cuba) et l'adaptation du poète national
allemand par un littérateur de Santiago de
Cuba!
Ce
poème a frappé bien d'autres artistes, des
musiciens dont le plus célèbre n'est rien moins
que Schubert (lied Erlkönig de 1803), Walter Scott
en a fait la traduction anglaise, deux œuvres que
H. D. a été à-même de connaître, y compris dans
ses années d'études aux États-Unis (cf. infra).
Nous ne nous étendrons pas sur les multiples œuvres contemporaines qu'il a inspiré, nous contentant de signaler le roman Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, adapté à l'écran par Volker Schlöndorff.
Nous
n'excluons pas de découvrir d'autres référence à
la littérature classique dans d'autres poèmes
d'Hippolyte Daudinot!
Fin du corpus
choisi.

Photo ancienne d’Arthez de Béarn, lieu d’origine des Daudinot et Dufourcq
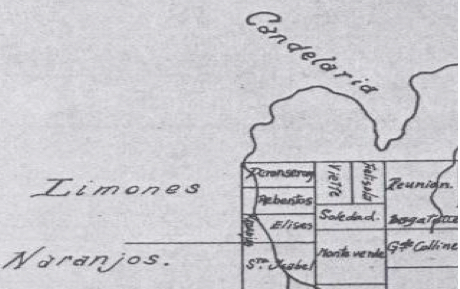
Extrait du plan des lots établis par Casamayor en 1838 où figure La Soledad (la Grande Colline est un nom allusif au massif de La Gran Piedra
4.
NOTES BIOGRAPHIQUES SUR LES DAUDINOT BRUN
ET LEURS FAMILIERS :
|
4.
NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE LOS DAUDINOT
BRUN Y SUS FAMILIARIOS:
|
|
|
|
Nous
sommes partis de presque rien
concernant les auteurs, un nom,
deux intitiales : P. et H.
Puis des mentions éparses de
membres de la famille Daudinot
dans un travail de Marie José
Delrieu sur les archives
paroissiales cubaines ciblé sur
les Heredia Girard, aimablement
communiqué. La lumière a commencé
d’apparaître avec deux courtes
pages sur internet de Jacques de
Cauna et Hugues de Lestapis
centrées sur les Daudinot de Cuba.
C’est finalement une heureuse
correspondance avec Hugues de
Lestapis qui l'ont incité à
rechercher dans les archives de
ses aïeux plus d'éléments sur les
Daudinot et le sœurs Brun, ajoutée
à des recherches de documents
d’Etat-Civil et de presse, qui
nous a permis de comprendre
quelque peu qui étaient ces
auteurs et leurs proches. Et de
raccorder ces éléments au
manuscrit et à nos acquis sur les
Français à Cuba au XIXe
siècle et leur héritage culturel.
De ce fait nous allons être amenés
dans notre synthèse à faire de
longues citations des éléments
généalogiques et biographiques
rassemblés par notre providentiel
correspondant, en y ajoutant des
éléments de contexte.
Les révélations qu'il fait à
cette occasion sur les sœurs
Brun, qui apparaissaient
jusqu'ici dans l'historiographie
locale que par des éléments
ténus ont un intérêt qui déborde
largement le champ de cet
article, la réussite sociale et
économique d'une telle famille
mulâtre n'ayant pas été apprécié
jusqu'ici à son juste
niveau.
Les Daudinot de Cuba forment une famille française qui a des intérêts à la fois en France et sous le règne de la couronne espagnole, d’abord en Espagne puis à Cuba. A Santiago de Cuba, ils sont alliés aux propriétaires français réfugiés de Saint-Domingue, en premier lieu ceux qui se sont naturalisés espagnols pour ne pas être inquiétés lors des tensions issues de l'invasion de l'Espagne par Napoléon et ont ainsi été exemptés des expulsions de Français de 1809. Les investissements à Cuba d’André-Pierre Daudinot commencent d’ailleurs quand la majorité des Français est expulsée (en partie importante vers la Louisiane). Dans cette période, André-Pierre et ses familiers sont les relais d’une famille bordelaise fortunée, les Lestapis, tant ce qui concerne l’investissement absentéiste dans les caféières de ces derniers que dans le financement des investissements des Français naturalisés espagnols. Le premier de la lignée des Daudinot qui nous concerne se lie familialement à une famille de réfugiées métisses de Saint Domingue, les sœurs Brun, d’une telle union sont issus nos deux auteurs. C’est pourquoi nous désignons cette famille dans le titre de cette partie comme les Daudinot Brun, à l’espagnole, en ajoutant le nom maternel. N.B.
: nous avons choisi de
graisser les noms des
personnes qui apparaissent
pour la première fois,
quelle qe que soit leur
importance dans cette
histoire familiale. Le
fondateur de la famille
Daudinot de Cuba est André-Pierre
Daudinot
(Bayonne 1782 – Cuba
1829). On trouve parfois
Pierre-André dans les
archives : c'est bien le
même homme. Il
est lui même fils d’André
Daudinot (Arthez
de Béarn 1724- Bayonne
1792) et Rose
Périssé :
le père, marchand de
gros à Madrid puis
banquier associé revient
en France en 1779 avec
femmes et enfants (mis à
part son fils aîné
qui prend la suite
des affaires à Madrid),
il se fixe à Bayonne,
avec Etienne
Moracin (mari
de Marie Pétronne
"Bernardine" Daudinot )
comme associé. Ce
dernier fera faillite en
1798.[69]
André-Pierre Daudinot, commence comme apprenti à Madrid en 1802, obtient la nationalité espagnole (donc, de fait considéré catholique) et va aux Amériques. Il rencontre à Philadelphie, en 1809 Adrien-Pierre de Lestapis, de Mont, près d’Arthez (cousin béarnais) promis à une haute fonction bancaire au Mexique, puis arrive à Santiago de Cuba en 1809. Ce cousin Lestapis, une fois revenu en France, agent des banques européennes Baring et Hope, va lui fournir des fonds. André-Pierre
conduit son
cousin à faire
de nouveaux
investissements
dans lesquels
il implique
également deux
frères
Lestapis (un alors attaché à la banque Baring à Londres,
l'autre
associé de la
maison de
banque Hope
d'Amsterdam).
Il prospère à
Cuba grâce à
sa nationalité
espagnole
alors que
nombre de
Français ont
été expulsés.
Lestapis
pourrait être
considérée
comme un
recours
bancaire des
émigrés
français dans
l’Est cubain
(reprenant la
fonction
révolue des
corsaires, qui
ont joué ce
rôle avant
d’être mis mis
sur la touche
en 1808).
Adrien-Pierre
de Lestapis
prête de
grosses sommes
au membre le
plus important
et le plus
actif de cette
communauté, Prudent
Casamajor
(naturalisé
Prudencio
Casamayor),
lequel est
lui-même
coutumier des
transactions
bancaires. Et
il fait des
investissements,
qui peuvent
s'avérer
risqués, comme
auprès d'un Eugène
de Ribeaux, que nous mentionnerons à nouveau par
la suite. Ils sont béarnais, cousins de cousins de même que les
Dufourcq
(alliés à la
fois aux
Daudinot et
aux Heredia).
(H. de L.). En
1812 est
attestée son
activité de
prêteur, en
l'occurence
pour un prêt à
la Société
José Garay et
et Eugène de
Ribeaux (CRUZ.
2006). En
1814, il est
comptable dans
la succession
Cordier. Puis
avec l'aide
des Lestapis,
il acquiert La
Soledad ; "Le 18 janvier 1815, Prudencio Casamayor lui vendit une terre,
mitoyenne à une habitation qu’il
possédait déjà. Il s’agissait de
3 chevalées de terre dans la
Sierra Maestra (Limones). Au nord,
elle mesurait 340 pas de
3,5 pieds chacun. A l’est,
500 et au sud 480. A l’ouest, elle
était bordée par le rio Baconao.
Ses voisins étaient à l’ouest
l’habitation de Casamayor
(certainement Los
Naranjos), à l’est celle de
l’acheteur et celle de Don José E.
Maldorno. Au sud, il y avait celle
du lieutenant Don
José Sanchez Griñan. Au nord,
les terrains de Don Francisco
Pascual Rebentos. Le prix
avait été de 450 pesos.
(AHPSC 361f20). (cf
plan supra) Il
possédait une autre habitation à
Limones (voisin de Vincent Dallest
en 1815). En, 1816, il est cité
comme voisin le de Jean Baptiste
Arnaud et Marie Françoise Brun à
la Armonía de Limones (de
même en 1829). Le 1er juin 1827,
Pierre André hypothéqua sa
caféière qu’il avait appelé Soledad
de la Armonía de Limones pour
garantir ses dettes envers Adrien
Pierre Lestapis de Bordeaux. A
cette époque, il y avait au nord
les héritiers de Juan Felisola et
Mme Brisonau, au sud une caféière
de don Maldonado et don Carbonell,
à l’est Jean Baptiste Lafargue et
Jean Baptiste Arnaud, à l’ouest le
lieutenant don Griñan et Charles
Osenne. AHPSC,
Anotaduria
de hipotecas tomo 31: libro de
gravámenes fincas rurales
1823-1830, f102." (Communication
d'Agnès Renault) Il s'associe avec son neveu Jean-Pierre Moracin sur une terre à San Luis, district de l'Amistad (RENAULT. 2012) André-Pierre Daudinot est "l’un des rares Français (certes naturalisé) à obtenir un poste dans l’administration espagnole de l’île, comme « capitan de Santa Armonia » de Limones, privilège qu’il partage avec l’autrement célèbre Casamayor". (H. de L.). La maison de vins de Bordeaux Lestapis frères, fondée en 1818 à la suite d’activités de commerce atlantique, devient par étapes propriétaire absentéiste de six caféières (et de leurs esclaves) ; cette maison acquerra une notoriété dans les grands vins de Bordeaux et sera dirigée par des Lestapis jusqu'en 1990 (les descendants ne sont plus actuellement plus partie prenante de cette maison, dont la marque perdure). Les intérêts économiques des Daudinot, Moracin à Cuba et des Lestapis de Bordeaux resteront constamment liés, entraînant des relations avec un caractère familial accentué entre eux. Daudinot
et Casamayor entretiennent chacun
une relation avec une sœur Brun,
des réfugiées quarteronnes[70]
de Saint-Domingue, avec qui ils
ont des enfants. L’un est
exécuteur testamentaire de
l’autre, ils appartiennent à la
même loge maçonnique (loge
L’Humanité). La tradition
maçonnique sera transmise à la
génération suivante, on le sait
dans l'exemple d'Hippolyte. Ce
sont les planteurs français qui
ont diffusé largement les loges
maçonniques dans cette partie de
l’île. En cela, ils ne faisaient
que reprendre l’héritage de
Saint-Domingue, où le réseau des
loges était associé à la
prospérité de l’ex-colonie. Comme
à Saint-Domingue, où une moitié
des propriétaires provenaient du
Béarn et de Gascogne, il y a une
articulation entre les réseaux
familiaux (cousinages…) et le
réseau de soutien franc-maçon.
Réseaux qui seront déterminants
pour faire venir et intégrer de
nouveaux-venus à cette communauté. Les sœurs Brun étaient au nombre de six : 1. Marie-Françoise dite Françoise, épouse de Jean-Baptiste Arnaud, avec une descendance à Santiago, Bordeaux, Paris et New-York 2.
Madeleine,
mère des quatre derniers
enfants de Casamayor. Tous
légitimés. 3. Thérèse, épouse Noblet. 4.
Marguerite, née en
1782, qui donne cinq enfants à
Daudinot. 5.
Marianne (ou
Marie-Anne) Félicité. 6.
Olympie Marguerite
Luce, Olympe ou Olympia dans
l'usage, mariée à Félix Doutre
ou Dautré, orfèvre lapidaire
et planteur. Ces
sœurs sont enfants de Jean-Baptiste
Brun et de Luce
Chaulet,
propriétaires à Saint-Domingue
dans la deuxième moitié du 18e siècle.
Précisément à Petit-Goave.
Soit le Sud qui a été le fief
du mulâtre Rigaux en guerre
contre Toussaint-Louverture
(nous en avons parlé dans les
notes). Elles sont héritières
de trois habitations
familiales concernant les
paroisses d'Anse à Veau et
Fond-des-Nègres selon les
registres d'indemnisation. Et,
selon la même source d'une
quatrième ayant appartenu à un
Lavau dont nous ignorons tout.
« Elles
appartenaient (…) à la
frange privilégiée des gens
de couleur, libres (par
rapport aux esclaves), qui
vivait et prospérait
(presque) comme les colons
blancs. Au point, c’est
presque paradoxal, de
préférer fuir la révolte des
esclaves et le pouvoir noir
à Saint-Domingue, pour
s’établir dans l’île voisine
de Cuba, dépendant de la
couronne espagnole. Où il
n’est d’ailleurs pas
question d’égalité entre les
hommes, a fortiori entre
blancs et noirs. Elles
y arrivent dans la même
période que Casamayor (lui
au terme d'une étape à la
Nouvelle-Orléans), en
1802-03, avec une jolie
réputation de fortune,
accompagnées de leur mère.
Elles déclarent posséder
ensemble deux habitations de
café dans la paroisse
Saint-Michel à
Saint-Domingue, succession
de leurs parents. Madeleine,
la future mère des enfants
(du second lit) du célèbre
Prudent Casamayor, a même pu
racheter les parts de ses
sœurs de La Cascade, la
troisième habitation de
l’héritage paternel. Elles
ont un frère prénommé François,
il est resté à
Saint-Domingue et a échappé
aux exactions des révoltés
de 1791. Il a pu conserver
sa caféterie (estimée plus
tard à 100 000 francs). »
(H. de L., correspondance
personnelle). A
Cuba, une partie d'entre elles
obtiennent, grâce à leur rang
social, la naturalisation par
le gouverneur Kindelan (le
même qui avait protégé
Casamayor, arrivé dés 1798 et
avait favorisé l’essor des
caféières des Français, dans
son projet de développement
économique de sa juridiction).
À contre-courant de la volonté
du moment d’éradiquer les gens
de couleur. Elles achètent
préalablement une propriété
dans la zone côtière de
Baconao : "A
Cuba, les sœurs Brun
commencent par acheter un
terrain (1804), condition
préalable à la
naturalisation espagnole,
qu’elles obtiennent dès
1805. Elles s’intègrent avec
une facilité étonnante dans
la société coloniale locale,
en dépit de leur ascendance
« bancale ». Agnès Renault a
noté qu’un des fils de
Madeleine Brun et de Prudent
Casamayor, baptisé le
21 décembre 1805 à la
cathédrale de Santiago,
avait été inscrit dans le
livre des Blancs. La
renommée du père et la
fortune de la mère ont sans
doute aidé. Cet Henri devait
avoir la peau qu’il fallait,
de moins en moins brune… En
1809, lorsque les autorités
espagnoles chassent de l’île
les réfugiés français de
Saint-Domingue (à cause du
coup de force de Napoléon en
Espagne), les sœurs Brun
partent pour la
Nouvelle-Orléans. Elles
reviennent dès que possible
et retrouvent leurs
propriétés" (id). Ce
retour à Cuba s'inscrit dans
un flux de retour de Louisiane
des expulsés, à partir de
1812, qui entraîne d'autres
Français de la grande
Louisiane. Les
sœurs Brun sont souvent
"présentées comme des femmes
d’affaires, propriétaires
dans les districts de
Baconao en 1804, puis dans
celui (réputé) de la
Candaleria, où elles ont
pour voisins Laurent
Mousnier et l’incontournable
Casamayor. " (id.) "Elles
achètent, empruntent,
hypothèquent, remboursent,
achètent à nouveau. Elles
épaulent leurs compatriotes
dans le besoin, comme ce sieur
Lescaille qui
a perdu tous ses biens-fonds à
Saint-Domingue, dont elles
font un économe et un tuteur.
Agnès Renault, qui a eu accès
à de nombreux documents sur
place, indique que leur
maîtrise de l’écrit est
« assez sommaire ». Elles
savaient au moins compter."
(id.) En
1807, selon les relevés
d’Adriana Chira, les sœurs
Brun possèdent la quatrième
plus grande plantation de café
du village de Limones, une des
régions caféières qui
connaissent alors la plus
forte croissance. Au
moment de l'expulsion des
Français de 1809,
correspondant à l'invasion
napoléonienne de l'Espagne, au
moins une partie des sœurs
Brun doit quitter le
territoire, ce qui est le cas
d'Olympe, pourtant mariée à un
naturalisé. Qu'elle soit
considérées de couleur,
fût-elle métissée, ne jouent
pas en sa faveur à ce moment,
malgré la qualité de ses
relations. Si
Marguerite Brun a fait partie
de cette expulsion, la durée
en aurait été brève. Le
naturalisé André-Pierre
Daudinot, proche du puissant
Casamayor a dû faire joué ses
relations, de niveau supérieur
au mari d'Olympe. Elle met au
monde le premier des enfants
Daudinot dans la province
orientale dès 1812. Le
mari d'Olympia, l'horloger
Félix Dautré adresse en 1815
une requête au Capitaine
Général de l'île pour le
retour de son épouse, afin de
s'établir dans une caféière
dans le partido de
Damajayabo (à proximité de la
Gran Piedra). (CRUZ. 2006). Ce
qu'il obtient, car c'est très
exactement le type de colon,
terrien, que veut à
ce moment la
région pour son développement.
Nous n'avons pas connaissance
du processus de retour pour
les autres sœurs Brun. A Candelaria, avant 1825, elles ont quinzaine d’esclaves, abrités dans cinq cases (RENAULT. 2012). En 1830, grâce aux fonds provenant de l’indemnisation des colons expropriés de Saint-Domingue par Charles X (elles étaient ayants droit de leur père et frère), les sœurs Brun disposent de liquidités, qu’elles injectent dans leurs entreprises cubaines. Il existe un plan de 1838 de Casamayor rendant compte de la revente des terres, délimitées au cordeau, qu'il avait achetées à la Gran Piedra à un nombre de colons qui dépassent allègrement la centaine. Là où des familles établies comme les Girard ou les Heredia ne possédent qu'un lot, Madeleine Brun en possède trois contigüs, dans les derniers attribués, ce dans la partie dominant ma rivère Baconao. Lescaille, qui a pris de l'aisance à la suite de l'aide des sœurs dont il a bénéficié, possède un lot voisin (et un autre de surcroît). Autre voisin, le consul anglais Wright, par ailleurs actionnaire principal de la société qui domine les activités minière d'El Cobre. Les
quatre derniers enfants de
Casamayor, dont Madeleine
est la mère, sont légitimés.
Dans son testament de 1823,
le plus puissant des
propriétaires de la région
désigne comme héritier ses
fils et Madeleine Brun. Elle
est de plus désignée tutrice
des enfants Casamayor encore
mineurs.
(RENAULT.
2012). A la fin des années 1830, Marguerite Brun, elle, tenue comme « la plus entreprenante des sœurs », possède 84 esclaves et deux plantations, et vit sur sa propriété à Limones. Dans les années 1850, elle a commencé à se diversifier dans le sucre et à étendre ses plantations dans la région de Santa Catalina, qui a été intégrée à une juridiction distincte dans les années 1840 (Saltadero / Guantanamo). Dans cette période, d'autres femmes de la communauté française sont déjà propriétaires exploitantes de sucrières, comme l'a remarqué Laura Cruz. Avec 157 esclaves, Marguerite Brun demeure longtemps le troisième plus grand propriétaire d’esclaves dans cette province. Intimement
liées à Casamayor et à
Daudinot, partenaires depuis
au moins 1814, les sœurs
Brun ont pu bénéficier de
leurs soutiens respectifs.
« Comme
Hilario Sillègue,
explique Adriana Chira,
elles avaient depuis
longtemps compris que pour
rejoindre l’élite, il est
essentiel de trouver des
mécènes qui puissent les
protéger économiquement et
politiquement. Les liens
de parenté ont constitué
une ressource utile pour
l’expansion de leurs
affaires ». On
connaît ces familles « en
réseau» : Casamayor,
Dufourcq, Heredia, Daudinot,
Moracin… tous ces gens-là,
plus ou moins apparentés,
sur place ou depuis la
métropole française, ont des
liens avec l’une ou l’autre
des sœurs Brun. "Comme
les autres propriétaires
de couleur (...), les
sœurs Brun apparaissent
comme marraines de très
nombreux enfants
d’esclaves nés dans leurs
propriétés. 32 fois entre
1814 et 1821. Pour les
bénéficiaires de cette
marque d’attention, il
pouvait en résulter des
avantages sur le plan de
la hiérarchie basée sur la
couleur et le statut. De manière générale, accueillies à Cuba comme des gens
de couleur, les sœurs Brun
vont acquérir tous les
privilèges associés à la
blancheur de peau. En
1842, à sa mort, Félicité
Brun a droit à sa mention
dans le registre
paroissial réservé aux
Blancs. Depuis le début
des années 1830,
Marguerite Brun était
appelée « Doña Brun » par
les fonctionnaires locaux.
Un « titre » de courtoisie
qu’elle veillera à
conserver dans tous les
documents officiels à
partir de cette date. Vers
1850, c’est une
propriétaire importante de
la région de
Tiguabos-Gantanamo. On la
traite comme telle, avec
déférence." (id) Thérèse
Brun a fait un beau
mariage avec Edouard
Noblet
(lequel vient
d'une famille de
corsaires). En
tant que veuve de ce dernier
elle prit sa belle-sœur
Luisa Noblet (elle-même
veuve de Jean-Baptiste
Chibas) comme fondée de
pouvoir pour vendre la
caféière
Los Naranjos,
de 15 caballerías
et 40
esclaves pour
15.200 pesos,
à Edouard
Chibás.
Les Chibás
sont les
descendants
cubains du
Béarnais
Jean-Baptiste
Chibas-Lassalle,
1748-1833.
Cette
propriété,
base d'une
prospérité qui
amènera les
Chibás à être
rivaux
économiques à
Santiago des
prospères
négociants
Bacardi
Moreau,
est
toujours un
des plus beaux
vestiges des
caféières de
la région de
Guantanamo. Un
Chibás devint
un leader
politique
national
important au
moment de la
lutte contre
le dictateur
Machado, avant
de se
suicider. André-Pierre apparaît ensuite comme témoin du premier mariage de Domingo de Heredia (planteur venu de Santo Domingo), le 2 mai 1817 à El Caney avec Geneviève Yvonnet, future mère des quatre premiers enfants de Domingo. |
Partimos
de casi nada referente a los
autores, un apellido, dos letras por
el nombre : P. y H. Luego, menciones
dispersas de miembros de la familia
Daudinot en una obra de Marie José
Delrieu sobre los archivos
parroquiales cubanos dirigidos al
Heredia Girard, amablemente
comunicados. La luz empezó a
aparecer con dos breves páginas en
Internet de Jacques de Cauna y
Hugues de Lestapis centradas en los
Daudinot de Cuba. Finalmente fue una
feliz correspondencia con Hugues de
Lestapis quien le animó a buscar en
los archivos de sus antepasados
más elementos sobre las Daudinot y
las hermanas Brun, sumados a las
búsquedas de estado civil y
documentos de prensa que permitieron
de entender quién fueron estos
autores y sus familiares. Y conectar
estos elementos con el manuscrito y
con nuestro conocimiento de los
franceses en Cuba en el siglo XIX y
su herencia cultural. Por tanto,
seremos llevados en nuestra síntesis
a realizar largas citas de elementos
genealógicos y biográficos recogidos
por nuestro correspondiente
providencial, añadiendo elementos de
contexto. Las revelaciones hechas en
esta ocasión sobre las hermanas
Brun, que hasta ahora aparecían en
la historiografía local sólo a
través de elementos tenues, tienen
un interés que va mucho más allá del
alcance de este artículo, no
habiendo sido el éxito social y
económico de esta familia mulata
apreciado hasta ahora en su nivel
adecuado.
Los Daudinot de Cuba son una familia francesa con intereses tanto en Francia como bajo el dominio de la corona española, primero en España y luego en Cuba. En Santiago de Cuba se alían con los propietarios franceses que se han refugiado en Santo Domingo, en primer lugar los que se han naturalizado españoles para no preocuparse por las tensiones derivadas de la invasión de España por Napoleón y así han escapados a las expulsiones francesas en 1809. Es cuando la mayoría de los franceses fueron expulsados (en gran parte a Luisiana) que empiezan las inversiones de André-Pierre Daudinot en Cuba. Durante este período, el y sus familiares fueron los intermediarios de una rica familia de Burdeos, los Lestapis, tanto en términos de inversión ausente en las plantaciones de café de estos últimos como en la financiación de las inversiones de los Francés naturalizados españoles. La primera de la línea Daudinot que nos concierne es la familia ligada a una familia de refugiados métis de Saint Domingue, las hermanas Brun, de tal unión proceden nuestros dos autores. Es por eso que nos referimos a esta familia en el título de esta sección como Daudinot Brun, al estilo español, agregando el nombre materno. N.B.: hemos optado por engrasar los nombres de las personas que aparecen por primera vez, sea cual sea su importancia en esta historia familiar. El fundador de la familia Daudinot de Cuba es André-Pierre Daudinot (Bayona 1782 - Cuba 1829). A veces se puede encontrar a Pierre-André en los archivos: de hecho, es el mismo hombre. Él mismo es hijo de André Daudinot (Arthez de Béarn 1724- Bayona 1792) y Rose Périssé: el padre, comerciante mayorista en Madrid y luego banquero asociado regresó a Francia en 1779 con esposas e hijos (aparte de su hijo mayor que se hace cargo de la negocio en Madrid), se instala en Bayona, con Etienne Moracin (marido de Marie Pétronne "Bernardine" Daudinot) como socio. Este último quebró en 1798. [69] André-Pierre Daudinot, se inició como aprendiz en Madrid en 1802, obtuvo la nacionalidad española (por tanto, de hecho considerado católico) y se fue a las Américas. Conoció en Filadelfia, en 1809, a Adrien-Pierre de Lestapis, de Mont, cerca de Arthez (primo Béarnais) prometido a una alta función bancaria en México, luego llegó a Santiago de Cuba en 1809. Este primo Lestapis, una vez de regresado en Francia, agente de los bancos europeos Baring y Hope, le proporcionará fondos: están asociados en 1812 en la plantación La Soledad (La Soledad). (...) André-Pierre lleva a su primo a realizar nuevas inversiones en las que también involucra a dos hermanos Lestapis (uno entonces adscrito al banco Baring en Londres, el otro socio de la casa bancaria Hope en Ámsterdam). Prospera en Cuba gracias a su nacionalidad española, mientras que muchos franceses han sido expulsados. Lestapis podría verse como un recurso bancario para los emigrantes franceses en el este de Cuba (asumiendo la función pasada de corsarios, que desempeñaron este papel antes de ser marginados en 1808). Adrien-Pierre de Lestapis presta grandes sumas al miembro más grande y activo de esta comunidad, Prudent Casamajor (naturalizado Prudencio Casamayor ), que tiene ya habilidad en las transacciones bancarias. Y hace inversiones, a veces arriesgadas, como con Eugène de Ribeaux que mencionaremos de nuevo después. Son de la provicia de Béarn, primos de primos y también de los Dufourcq (estos ultimos aliados tanto de Daudinot como de Heredia). (H. de L.). En 1812 se certifica su actividad como prestamista, en este caso por un préstamo a la Société José Garay y Eugène de Ribeaux (CRUZ. 2006). En 1814, fue contador en la finca Cordier. Luego con la ayuda de los Lestapis, adquirió La Soledad; "El 18 de enero de 1815, Prudencio Casamayor le vendió un terreno, contiguo a una casa que ya poseía. Eran 3 solares en la Sierra Maestra (Limones). Hacia el norte medía 340 escalones de 3,5 pies cada una, al este 500 y al sur 480. Al oeste limitaba con el río Baconao, sus vecinos al oeste eran la habitación de Casamayor (ciertamente Los Naranjos), al este la del comprador y la de don José E. Maldorno Al sur estaba el del teniente don José Sánchez Griñan Al norte las tierras de don Francisco Pascual Rebentos El precio había sido de 450 pesos AHPSC 361f20. (cf plan supra) Poseía otra casa en Limones (vecino de Vincent Dallest en 1815). En, 1816, es citado como vecino de Jean Baptiste Arnaud y Marie Françoise Brun en la Armonía de Limones (también en 1829). El 1 de junio de 1827, Pierre André hipotecó su cafetal al que había llamado Soledad de la Armonía de Limones para garantizar sus deudas con Adrien Pierre Lestapis de Burdeos. Estaban entonces por el norte los herederos de Juan Felisola y doña Brisonau, por el sur un cafetal de don Maldonado y don Carbonell, por el este Jean Baptiste Lafargue y Jean Baptiste Arnaud, por el oeste el teniente don Griñan y Charles Osenne. AHPSC, Anotaduria de hipotecas tomo 31: libro de gravámenes fincas rurales 1823-1830, f102." (Comunicación de Agnès Renault) En 1815 es dueño de un cafetal que amplía con terrenos comprados en Casamayor. En 1828 volvió a comprarle un terreno en El Ramón. Unió fuerzas con su sobrino Jean-Pierre Moracin en tierra en San Luis (RENAULT. 2012). André-Pierre Daudinot es "uno de los pocos franceses (naturalizados) que obtuvo un puesto en la administración española de la isla, como" capitán de Santa Armonia ", privilegio que comparte con el famoso Casamayor". (H. de L.). Jacques de Cauna muestra el entrelazamiento de los intereses de las familias que se podría llamar la red Casamajor: “Así nos encontramos en los primeros años del siglo XIX en Cuba junto a Prudent (Casamajor), los Dufourcq, en compañía de sus familiares cercanos. y aliados de la región bearnesa de Casamajor, Sillègue, Lestapis, Majendie, Daudinot (d'Arthez)…, la mayoría refugiados de Saint-Domingue, a los que podemos añadir su cuñado, el criollo burdeos Jean Despaigne y su amigo gascón de Labastide d'Armagnac, José Delisle. Muy cercano a Prudent de Casamajor, a quien tenía sus cartas dirigidas a Santiago al inicio de su aventura cubana, masón como él y su albacea designado con su pariente Jean de Sillègue, José Delisle se mantuvo tras la gran ola de expulsiones anti-napoleónicas de 1809 y se convirtió en una de las cuatro grandes fortunas de los cafetales franceses en el Oriente cubano, con Casamajor, su gerente Despaigne, quien se asoció con él en la fundación de Santa-Catalina y primo hermano de Bearn, también naturalizado, Don José Dufourcq… ” Un Dufourcq, comerciante en Burdeos estaba a cargo de la importación de café del este de Cuba, particularmente los de la más alta calidad de Taurus. La casa de vinos de Burdeos Lestapis frères, fundada en 1818 como resultado de las actividades comerciales del Atlántico, se convirtió gradualmente en el propietario ausente de seis plantaciones de café (y sus esclavos); esta casa adquirirá notoriedad en los grandes vinos de Burdeos y será gestionada por Lestapis hasta 1990 (los descendientes ya no participan en esta casa, cuya marca continúa). Los intereses económicos de los Daudinot, Moracin en Cuba y Lestapis en Burdeos permanecerán constantemente ligados, dando lugar a relaciones de acentuado carácter familiar entre ellos. Daudinot y Casamayor mantienen cada uno una relación con una hermana Brun, refugiada quarteronne [70] de Saint-Domingue, con quien tienen hijos. Uno es el albacea del otro, pertenecen a la misma Logia Masónica (Lodge L’Humanité). La tradición masónica se transmitirá a la siguiente generación, como sabemos por el ejemplo de Hipólito. Fueron los plantadores franceses quienes difundieron ampliamente las logias masónicas en esta parte de la isla. En esto, simplemente se estaban apoderando del patrimonio de Saint-Domingue, donde la red de las logias se asoció con la prosperidad de la ex-colonia. Como en Saint-Domingue, donde la mitad de los propietarios procedían de Bearn y Gascuña, existe una articulación entre las redes familiares (primos, etc.) y la red de apoyo masón. Redes que serán decisivas para atraer e integrar a los recién llegados a esta comunidad. Las Hermanas Brun deran seis: 1. Marie-Françoise conocida como Françoise, esposa de Jean-Baptiste Arnaud (con descendientes en Santiago, Burdeos, París y Nueva York). 2. Madeleine, madre de los últimos cuatro hijos de Casamayor. Todos legitimados. 3. Thérèse, esposa Noblet. 4. Marguerite, nacida en 1782, que le dio cinco hijos a Daudinot. 5. Marianne (o Marie-Anne) Félicité. 6. Olympie Marguerite Luce, Olympe o Olympia en uso, casada con Félix Doutre o Dautré, platero lapidario y plantacionista. Estas hermanas son hijas de Jean-Baptiste Brun y Luce Chaulet, propietarios en Saint Domingue en la segunda mitad del siglo XVIII. Precisamente en Petit-Goave. Es a decir el Sur, que fue el baluarte del mulato Rigaux en guerra contra Toussaint-Louverture (de eso hablamos en las notas). Son herederos de tres casas familiares en las parroquias de Anse à Veau y Fond-des-Nègres según los registros de compensación. Y, según la misma fuente, de un cuarto que pertenecía inicialmente a un Lavau del que no sabemos nada. “Pertenecían (…) a la franja privilegiada de las personas de color, libres (en comparación con los esclavos), que vivían y prosperaban (casi) como los colonos blancos. Hasta el punto, es casi paradójico, preferir huir de la revuelta esclavista y del poder negro en Santo Domingo, para instalarse en la vecina isla de Cuba, dependiente de la corona española. Donde, además, no se trata de igualdad entre hombres, y mucho menos entre blancos y negros. Llegaron allí en la misma época que Casamayor, en 1802-03, con una bonita fama de fortuna, acompañados de su madre. Declaran ser propietarios juntos de dos cafeterías en la parroquia de Saint-Michel en Santo Domingo, herencia de sus padres. Madeleine, la futura madre de los hijos (desde la segunda cama) del famoso Prudent Casamayor, incluso pudo comprar las acciones de sus hermanas en La Cascade, la tercera casa de la herencia paterna. Tienen un hermano llamado François, permaneció en Saint-Domingue y escapó de las exacciones de los rebeldes de 1791. Pudo mantener su cafetal (estimado más tarde en 100.000 francos). »(H. de L., correspondencia personal). En Cuba, algunos de ellos obtuvieron, gracias a su rango social, la naturalización por parte del gobernador Kindelan (el mismo que había protegido a Casamayor, llegó en Oriente en 1798 y había favorecido el desarrollo de los cafetales franceses, en su proyecto de desarrollo de su jurisdicción). Contra la voluntad oficial de erradicar a las personas de color. Primero compran una propiedad en la zona costera de Baconao: "En Cuba, las hermanas Brun comenzaron comprando tierras (1804), requisito previo para la naturalización española, que obtuvieron en 1805. Se integraron con sorprendente facilidad en la sociedad colonial local, a pesar de su ascendencia" tambaleante ". Agnès Renault señaló que uno de los hijos de Madeleine Brun y Prudent Casamayor, bautizados el 21 de diciembre de 1805 en la catedral de Santiago, había sido inscrito en el libro de los blancos.La fama del padre y la fortuna de la madre sin duda ayudaron. Tenía la piel adecuada, cada vez menos morena ... En 1809, cuando las autoridades españolas expulsaron a los refugiados franceses de Saint-Domingue de la isla (debido al golpe de fuerza de Napoleón en España), las hermanas Brun partieron hacia Nueva Orleans. Regresar lo antes posible y recuperar sus propiedades "(id). Este regreso a Cuba es parte de un flujo de retorno de deportados de Luisiana, desde 1812, que involucra a otros franceses del gran Luisiana. Las hermanas Brun a menudo son "presentadas como empresarias, propietarias en los distritos de Baconao en 1804, luego en el (reputado) de Candaleria, donde sus vecinos son Laurent Mousnier y el inevitable Casamayor" (Id.). “Compran, piden prestado, hipotecan, devuelven, compran de nuevo. Apoyan a sus compatriotas necesitados, como este Sieur Lescaille que perdió todos sus bienes en Santo Domingo, al que hacen ahorrador y guardián. Agnès Renault, que tuvo acceso a muchos documentos sobre el terreno, indica que su dominio de la palabra escrita es "bastante básico". Sabían al menos cómo contar ". (id.) En 1807, según los registros de Adriana Chira, las hermanas Brun eran dueñas de la cuarta plantación de café más grande en el pueblo de Limones, una de las regiones cafetaleras de más rápido crecimiento en ese momento. En el momento de la expulsión de los franceses en 1809, correspondiente a la invasión napoleónica de España, al menos una parte de las hermanas Brun tuvo que abandonar el territorio, como fue el caso de Olympe, que sin embargo estaba casada con una persona naturalizada. Si se la considera de color, incluso si es de raza mixta, no funciona a su favor en este momento, a pesar de la calidad de sus relaciones. Si expulsaban a Marguerite Brun sería por poco tiempo. Se puede imaginar que el naturalizado André-Pierre Daudinot, cercano al poderoso Casamayor, tuvo que jugar con sus parientes, de un nivel superior al marido de Olympe. Ella dio a luz al primero de los niños Daudinot en la provincia oriental ya en 1812. El esposo de Olympia, el relojero Félix Dautré, en 1815 envió una solicitud al Capitán General de la isla para el regreso de su esposa, con el fin de instalarse en un cafetal en el partido de Damajayabo (cerca de la Gran Piedra). (CRUZ. 2006). Lo que consigue, porque es muy exactamente el tipo de colono, terrateniente, que la región quiere en este momento para su desarrollo. No conocemos el proceso de regrso en Oriente de las otras hermanas Brun. En Candelaria, antes de 1825, tenían quince esclavos, alojados en cinco chozas (RENAULT. 2012). En 1830, gracias a los fondos obtenidos de la indemnización de los colonos expropiados de Santo Domingo por el soberano francés Carlos X (eran beneficiarios de su padre y hermano), las hermanas Brun disponían de dinero en efectivo, que inyectaban en sus negocios cubanos. Hay un plano de 1838 de Casamayor que da cuenta de la reventa de las tierras, delimitadas por una línea, que había comprado en la Gran Piedra a un número de colonos que alegremente supera el centenar. Donde familias establecidas como los Girard o los Heredia tienen un solo lote, Madeleine Brun tiene tres contiguos, en el último asignado, en la parte que domina el rio Baconao. Lescaille, que se sintió más cómodo con la ayuda de las hermanas de las que se benefició, tiene un lote vecino (y otro más). Otro vecino, el cónsul inglés Wright, también principal accionista de la empresa que domina las actividades mineras de El Cobre. Los últimos cuatro hijos de Casamayor, de los que Madeleine es madre, están legitimados. En su testamento de 1823, el terrateniente más poderoso de la región designa a sus hijos y a Madeleine Brun como herederos. También es nombrada tutora de los niños Casamayor que aún son menores de edad. (RENAULT. 2012). A finales de la década de 1830, Marguerite Brun, considerada "la más emprendedora de las hermanas", poseía 84 esclavos y dos plantaciones, y vivía en su propiedad en Limones. En la década de 1850 comenzó a diversificarse hacia el azúcar y expandir sus plantaciones en la región de Santa Catalina, que se incorporó a una jurisdicción separada en la década de 1840 (Saltadero / Guantánamo). Durante este período, otras mujeres de la comunidad francesa ya eran propietarias y operaban plantas de azúcar, como señaló Laura Cruz. Con 157 esclavos, Marguerite Brun fue durante mucho tiempo la tercera propietaria de esclavos en esta provincia. Estrechamente ligadas a Casamayor y Daudinot, socias desde al menos 1814, las hermanas Brun pudieron beneficiarse de su respectivo apoyo. “Como Hilario Sillègue”, explica Adriana Chira, “ellos entendían desde hacía tiempo que para unirse a la élite es fundamental encontrar mecenas que puedan protegerlos económica y políticamente. Los lazos familiares han sido un recurso útil para expandir su negocio ". Conocemos a estas familias “en red”: Casamayor, Dufourcq, Heredia, Daudinot, Moracin, ... todas estas personas, más o menos emparentadas, in situ o de la metrópoli francesa, tienen vínculos con una u otra de las Hermanas Brun. "Como las demás propietarias de color (...), las hermanas Brun aparecen como madrinas de muchos hijos de esclavos nacidos en sus propiedades. 32 veces entre 1814 y 1821. Para los beneficiarios de esta marca de atención, podría resultar en ventajas de jerarquía. según el color y el estado. Generalmente acogidas en Cuba como personas de color, las hermanas Brun adquirirán todos los privilegios asociados con la blancura de la piel. En 1842, a su muerte, Félicité Brun tenía derecho a ser mencionada en el registro parroquial reservado a los blancos. Desde principios de la década de 1830, los funcionarios locales llamaban a Marguerite Brun "Doña Brun". Un "título" de cortesía que se asegurará de conservar en todos los documentos oficiales a partir de esa fecha. Alrededor de 1850, ella era una importante terrateniente en el área de Tiguabos-Gantánamo. La trataban como tal, con deferencia ". (Id) Thérèse Brun tuvo un hermoso matrimonio con Edouard Noblet (el cual proviene de una familia de corsarios). Como viuda de esta, última tomó a su cuñada Luisa Noblet (ella misma viuda de Jean-Baptiste Chibas) como representante autorizada para vender la planta de café Los Naranjos, de 15 caballerías y 40 esclavos por 15.200 pesos, a Edouard Chibás. Los Chibás son los descendientes cubanos del bearnés Jean-Baptiste Chibas-Lassalle, 1748-1833. Esta propiedad, base de una prosperidad que llevará a los Chibás a ser rivales económicos en Santiago de los prósperos comerciantes Bacardí Moreau, sigue siendo uno de los vestigios más bellos de los cafetales del país. Un Chibás se convirtió en un importante líder político nacional durante la lucha contra el dictador Machado, antes de suicidarse. "Además de la gestión de las plantaciones de sus primos en Béarn, André-Pierre Daudinot desarrolló sus propias actividades. El 24 de junio de 1815, una carta de Henri Fournier, comerciante y cónsul francés en Filadelfia, informaba a su amigo Lestapis que la explotación de Daudinot está floreciendo y que vale entre 35 y 37 000 dólares. Se ocupó de traer a Cuba a todos sus sobrinos Moracin, cinco chicos, hijos de su hermana Bernardine Daudinot y Etienne Moracin ”. (id.). En la primera fila de estos, Jean-Paul Moracin, socio de André-Pierre Daudinot tuvo un hijo con "Marie Elisabeth Brun" (¿Seria Marie Anne Félicité?), El nombre de este hijo es Henry Brun. André-Pierre aparece entonces como testigo del primer matrimonio de Domingo de Heredia (plantador de Santo Domingo), el 2 de mayo de 1817 en El Caney con Geneviève Yvonnet, futura madre de los primeros cuatro hijos de Domingo. |

| |
|
| Carte 2. El Caney et quartiers de Limones, Candelaria, La Guira (Est de Santiago de Cuba) : caféières en 1813. Limones : proximités des plantations de Daudinot père, des sœurs Brun, Casamayor... La Güira : première propriété de Domingo de Heredia, celle des aparentés Yvonnet (ici Ibonet). La Gran Piedra en bas à droite (Sierra Maestra Est). Dominent encore à ce moment chez les Français les naturalisés espagnols, les effet du retour des expulsés n'ont pas encore donnés toute leur mesure. | Mapa 2. El Caney y Limones, Candelaria, La Guira (Est de Santiago de Cuba): cafetales en 1813. Limones : proximidad de Daudinot padre, de Las hermanas Brun, de Casamayor... La Güira : primera propriedad de Domingo de Heredia y de su primera esposa Yvonnet (ici Ibonet). La Gran Piedra abajo a la derecha (Sierra Maestra Este). Predominan todavia en los Francese los naturalizados les naturalisés espagnoles, los efectos del regreso de los expulsados no son todavia muy presentes. |
Marguerite Brun (Saint-Domingue 1782 — Bordeaux 1874), mère des enfants d’André-Pierre Daudinot (Prudent, Adrien, Sévère, Hippolyte et Luce) ne s’est jamais marié avec son conjoint « craignant peut-être que la demande de mariage soit rejetée en raison de l’ascendance africaine connue des sœurs Brun » dit Adriana Chiara. Plus vraisemblablement, « Marguerite Brun voulait-elle garder le contrôle de ses propres affaires entreprises qu’un mariage aurait mis en péril, les femmes mariées devant alors obtenir la permission de leur mari pour conclure un contrat », suggère Hugues de Lestapis. Elle donne sa propre version dans une lettre. Malgré cette absence de mariage, le certificat de décès de Marguerite Brun à Bordeau, retrouvé par Hugues de Lestapis la fait apparaître comme épouse d'André-Pierre! Cette situation nous justifie à désigner les enfants d'André-Pierre et Marguerite sous la double appellation Daudinot Brun, selon l'usage espagnol pour les noms de famille.
A partir de 1823, André-Pierre confie ses deux aînés à son cousin, cadet des Lestapis à Bordeaux pour qu’ils y fassent de bonnes études, en l'occurence dans l’établissement réputé de Sorèze, avec de solides bases classique et l’aprentissage du latin. Ils y resteront jusqu’en 1830. À cette occasion, dans ans un courrier du 23 septembre 1832, elle écrit au bienfaiteur Lestapis et donne sa propre version sur l'absence de mariage : "Il m'est doux de voir que malgré les préjugés de votre pays contre l'irrégularité de leur naissance, vous n'avez pas repoussé mes enfants. Ce n'est pas parce qu'il ne me trouvait pas digne de porter son nom qu'il (Daudinot) ne m'a pas épousée, c'était délicatesse de ma part".
Mais André-Pierre meurt brutalement en 1829 à 47 ans, dans des circonstances non complètements élucidées. Cette mort intervient dans un contexte de crise des prix des cafés et de l'acroissement de la concurrence brésilienne. Selon une publication traduite en français de Rafael Duharte (1990), André-Pierre, propriétaire de la Amistad se serait fortement endetté, ce qui l'aurait conduit au suicide. Cependant un suicide pour raisons économiques cadre mal avec l'entourage d'André Pierre, la fortune des sœurs Brun, le réseau des propriétaires béarnais proches, sinon le recours possible aux Lestapis. Toujours est-il que la plantation La Soledad est récupérée à bon prix par la Veuve Brun.
Les quatre fils Daudinot, Prudent, Adrien, Sévère et Hippolyte étaient nés entre 1812 et 1820. Le cadet est Emile Hippolyte Daudinot, à l’état-civil, il sera toute sa vie nommé par son second prénom. Il est probable que la fratrie ait vécu ses premières années à La Soledad.
Prudent,
l’aîné, avait reçu son prénom en hommage à Casamayor.
Les frères avaient entre 17 et 9 ans à la mort de leur
père, une partie d’entre eux faisant
leurs études en France à ce moment.
Luce Daudinot (qui apparaît aussi comme Lucie) épouse un Louis-Michel Dufourcq au Caney en 1852. El Caney, très proche de Santiago de Cuba, est le lieu de naissance du mari. Il y a d'autre part un lien familial entre les Dufourcq et la famille Girard par le mariage entre Jean-Joseph Dufourcq et Sophie Girard y Rey (1839). Ainsi les Daudinot sont liés à Casamayor d'une part et sont proches d’autre part des Heredia Girard. Les écrits d'Hippolyte citent Louise, la seconde épouse de Domingo de Heredia et, parmi leurs enfants, Léocadie, la fille aînée. Elle et ses sœurs ont pour frère le futur poète français José Maria de Heredia, Pepillo, tôt parti étudier en France.
Les Dufourcq viennent d’une famille noble d’Arthez, qui
a abandonné (en principe) sa particule à la Révolution
française. Dans plusieurs des familles de ce réseau
béarnais à Cuba nous sommes proches de la petite
noblesse du Béarn (la même évoquée dans les Quatre
Mousquetaires du quarteron domingois Alexandre Dumas,
en provient en particulier Athos)...
La fratrie Daudinot née à Cuba est ainsi française et
béarnaise, mais civilement espagnole du côté du père,
française domingoise métissée du côté de la mère, qui
a hérité de l'usage du créole de Saint-Domingue.
Prudent et Hyppolyte manifestent leur maîtrise de ce
créole appris dès la petite enfance et leurs
connaissances des contes domingois (Compère Bouqui…)
et autres traditions créoles (conjuration de mauvais
sort nommé « ouanga »). Ils le lient à leurs
connaissance intime de la culture classique européenne
(fables de La Fontaine, Virgile, auteurs prestigieux
anglais et allemands…) et aux règles de la
versification du français. En cela leurs références
sont les mêmes que celles de la destinataire du
manuscrit d’Hippolyte, Léocadie « veuve
Raoulx ».
Si peu lettrée aurait-elle été, Marguerite Brun
entretient une correspondance régulière avec les
Lestapis et leur confie, à sont tour, au moins un
autre fils. Nous avons affaire à une propriétaire
mulâtre enrichie et active. Mais c’est la même
personne qui transmet les traditions orales
domingoises à ses enfants, la proximité de ses sœurs
créant une petite communauté propre à entretenir cet
héritage culturel commun.
L’étude inédite de la correspondance de la Cie Lestapis
avec les Daudinot-Brun faîte très récemment par Hugue
de Lestapis, (en fait uniquement les lettres
« sortantes »)
donne de nouvelles informations sur la fratrie
Daudinot :
Février 1832, Sévère Daudinot, le troisième par ordre
de naissance de la fratrie (né en 1818), est à
Bordeaux, mais pas collégien à Sorèze contrairement à
ses aînés, « il est
pensionnaire à Bordeaux chez un certain
M. Worms dans les années 1830. Hébergé le
reste du temps chez Pierre-Sévère Lestapis, 10 pavé
des Chartrons. Le 15 novembre 1836, ce dernier
fait pour lui une demande de passeport pour « aller
à Santiago de Cuba rejoindre ses parents ».
Sévère est présenté comme étudiant, natif de Santiago,
et son portrait signale un « teint brun ». Des
documents postérieurs décrivent le cadet Hippolyte
comme blanc. Les différences de couleurs ayant leur
importance dans cette société, les différences
d’aspect physique entre les frères ont pu jouer leur
rôle dans leur destin respectif, même si la fortune
gommait bien des différences.
Début 1834, Adrien et Hippolyte sont aux États-Unis.
Hippolyte n’a que quatorze ans. En 1835, il reçoit un
prix d'excellence au collège, catholique, Mount
Saint-Mary, dans le Maryland, des études financées par
sa mère. Notre Hippolyte brille en latin, en
mathématiques, en histoire et en géographie. Par
ailleurs, ses
écrits montrent qu’il a
acquis une solide culture
classique, française et
latine, étendue aux grands
auteurs de langue anglaise
et allemande. Adrien,
qui a gâché son temps d’études bordelaises, est alors
employé chez BC & N. Lestapis écrit à Mme Brun
qu’il souhaite à Adrien du succès, « après
tout le temps qu’il a mal employé en France ».
A ce moment l'aîné, Prudent est employé dans une
maison de négoce à Santiago de Cuba, peut-être Brooks,
peut être Lestapis.
Début 1837, Sévère est à Cuba après deux ans passés en
France. En juin 1837, il semble que les Daudinot
présents à Cuba caressent le projet « de
venir s’établir en France dès que possible ».
(C’est le moment où José Dufourcq, déjà cité, organise
pour sa part un pareil projet, qu'il va
réaliser). Peut-être
y a-t-il un rapport avec le décret d'abolition de
l'esclavage décrété dans la voisine Jamaïque en 1833
(mais appliqué seulement en 1838). Ce contexte, qui
montre la fragilité des économies basées sur
l'esclavage peut jouer dans la décision de ces colons
de rapatrier leurs dividendes. Pour ce qui le
concerne, Hippolyte, 17 ans, est fraîchement revenu à
Cuba. Il est certes question d’un séjour pour lui de
deux ans en France, pour continuer ses études.
Pourtant, à 18 ans il est employé dans les bureaux des
mines d’El Cobre.
Dans ce premier emploi, il est tentant d’imaginer la
main secourable de Casamayor, qui avait relancé les
activités minières sur place. C'est un moment
particulier pour cette mine dont l'exploitation a été
confiée à une société anglaise, ce dont profite des
militants abolitionnistes anglophones de diverses
mouvances protestantes pour s'y introduire. La
nationalité des capitaux de la compagnie n'empêche pas
que des hauts cadres y soient français, comme en a
témoigné Samuel Hazard dans son récit de voyage.
L'épisode États-unien d'Hyppolyte, bonnes références
et maîtrise de la langue anglaise a dû aussi lui
servir pour accéder dans cette entreprise. De plus, si
on parle à nouveau de main secourable, le voisin
terrien d'une tante Brun n'est autre que le consul
anglais Wright, principal actionnaire de la mine
principale.
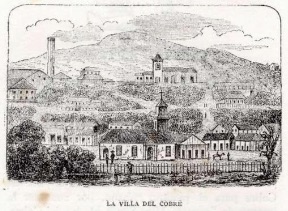 |
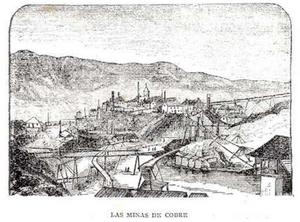 |
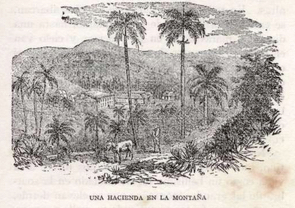 |
Illustrations : Samuel Hazard "Cuba a pluma y lapiz" (édition en español), années 1860. 1. El Cobre, 2. Les mines d'El Cobre, 3. Hacienda en montagne (Yateras)
Adrien, rentré à Cuba auprès des siens, s’établit comme
planteur de café. Vers 1840, il s’occupe
des propriétés de ses cousins Casamayor.
Les propriétés de Casamayor qui
apparaissent dans le document consulaire
de 1843 sont la caféière de Bellevue,
Bellavista pour les Espagnols (140
carreaux, 98 esclaves) et la plantation
sucrière de La Folie (190 carreaux, 100
esclaves).
Au début des années 1840, Prudent gère avec sa
mère la caféterie familiale la Soledad
et Sévère gère la caféterie Sainte-Luce.
Cette exploitation de belle taille (210
carreaux, 93 esclaves) est désignée sous
le nom de Luce
(Luce comme Luce Brun la
grand-mère dont Luce Daudinot porte le
prénom?) dans l’inventaire français de
1843. La Soledad des sœurs Brun est-elle
restée dans le giron familial ?
Peut-être pas.
Dans ce même inventaire une propriété La Soledad est
enregistrée au consulat de France, elle
est aux mains d’un J.
B. Manet de 400 carreaux et
120 esclaves, à ce moment une
cotonnerie. Aucun rapport avec la
Soledad des Daudinot. Elle concerne la
zone du Monte Libano (aujourd'hui
province de Guantánamo), a été crée
postérieurement, vers 1821. Elle passera
par héritage à la famille Malletá
(famille d'origine hongroise appelée
initialement Copaitich arrivée à
Santiago en 1805, ensuite propriétaire
dans la même zone de La Folie), par
l'intermédiaire d'une nièce Petit Manet
nous dit Jacques de Lestapis. Les Brooks
rachètent cette propriété, probablement
endommagée par la guerre vers 1871 (Voir
légende de la carte 5, infra)
Le père Daudinot est de nationalité espagnole, ses
enfants nés à Cuba aussi. Ainsi les
Daudinot ne figurent pas à cette date
dans les propriétaires ruraux français
déclarés au consulat de La Havane ...
contrairement aux sœurs Brun.
Après la mine, Hippolyte va s’occuper d’une petite
exploitation, où il réside au moins
jusqu’à ses 41 ans. (H. de L.). Petit
propriétaire? un peu plus que ça
verrons-nous plus avant. En juin 1846,
le poète Hyppolite apparait dans les Crónicas
de Santiago de Cuba d'Emilio Bacardí
Moreau. Ce dernier oppose chez ce natif
de Cuba son français correct à une
langue espagnole qu'il parle
"extrêmement mal ". Et reproduit le seul
poème en français d'Hyppolite qui nous
soit connu, de nature lyrique "Mon
regard". Bacardí connaît sa situation de
plantacioniste, "éduqué" ("ilustrado")
et note qu'il sera ingénieur civil
diplômé ultérieurement
La France abolit définitivement l’esclavage dans ses
îles en 1848. Les Français qui
continuent à pratiquer
le système de la plantation assis
sur l’esclavage sur d’autres territoires
riquent en principe de perdre leur
nationalité. Dans la pratique, il n’y
aura aucun zèle à ce sujet.
Au milieu des années 1850, "Adrien
Daudinot supervise ce qu’il reste des
propriétés de café Lestapis autour de
Santiago et de Guantanamo. Elles
étaient au nombre de six vers 1850. Il
en sera le dernier « gérant »,
quarante ans après son père
André-Pierre Daudinot." (H. de
L.). Parmi les propriétés
« Lestapis et Cie », le
document consulaire de 1843, certe
incomplet à notre avis sur la propriété
des Français ou considérés tels,
n’enregistre qu’une propriété : La
Caroline, (120 carreaux, 79 esclaves).
Il y a toute chance que le « et
Cie » comprenne au moins un des
Daudinot, sans préjudice d’un de leurs
cousins. Très curieusement, selon la
coutume cubaine de nommer les esclaves
d’après le nom de leurs maître, le nom
de Lestapis sera transmis à certains de
ceux-ci, alors que rien n'indique dans
les archives familiales qu'un Lestapis a
fait le voyage à Cuba! Un composé
de tumba francesa « Lestapí »
est repéré pour avoir composé un chant
relatant la répression sanglante
contre les Indépendants de
couleur (la transformation du nom est
bien légère, puisque dans l'habitude
locale on ne prononce pas le "s" final).
En ce qui concerne les nombreux
"Lestapié" ou "Lestapier" de la province
de Guantanamo, ils portent le patronyme
de deux réfugiés de Saint-Domingue
naturalisés de 1808 et n'ont semblent-il
rien à voir avec les Lestapis.
La richesse produite par les caféières des Français
favorisent l’émergence d’une nouvelle
ville dans les années 1830 et 1840. La
juridiction de Saltadero (Guantanamo)
devient autonome par rapport à celle de
Santiago en 1943. Le premier maire de la
ville en 1847 sera un Français Laurent
/Lorenzo
Jay (il possédait à cette
époque une sucrerie de 300 cavaleries et
140 esclaves). Mais il y a une
répartition de fait à ce moment :
les Français participent aux assemblées
tout en restant établis le reste du
temps dans leur montagne, tandis que les
Catalans régissent les commerces dans le
ville et que le reste de la population
urbaine est espagnole ou créole cubaine.
On parle encore d'une population urbaine
inférieure à mille habitants : 290 blancs, 498 libres de
couleur et 125 esclaves. En 1867, Jules
Raoulx, mari de Léocadie
Heredia appellera
encore la nouvelle cité « le
bourg » (celui où se fait le
commerce de la production, par
l’intermédiaire des Brooks). Mais une
véritable ville se formera rapidement,
où des investissements de Français dans
les lieux sructurants (église, places
etc) joueront leur rôle.
Théodore Moracin
(Michel Théodore à l'état-civil) est
associé à Domingo de Heredia et Eugène
de Ribeaux pour la fondation
d’une plantation nommé Cuzco sur les
pentes de la montagne nommée Mont Rouge
par les premiers propriétaires français
pour ses floraisons spectaculaires, puis
Monte Rus [71],
nom transformé selon les locuteurs et le
passage du temps. Une appelletion
concurente est Taurus, de référence
moyen-orientale mais rejoignant le nom
espagnol de la montagne : Toro. A l'est
de Monte Rus, les hauteurs de Monte
Libano sont également investies, comme
l'ont été les hauteurs de Yateras,
encore plus à l'Est au Nord de
Guantanamo. Le rapide épuisement des
terres des premières caféières
conduisait les planteurs à chercher de
nouvelles terres vierges à déboiser,
immédiatement fertiles, dans les sierras
du Sud-Est cubain qui n'avaient guère
connues qu'un élevage très extensif. Une
étape est la conquête des terres autour
de la Gran Piedra, suivie de celle plus
au Nord de Ramón de Las Yaguas (La
Fraternidad...), puis du Mont Taurus au
Nord-Ouest de Saltadero (future
Guantanamo) où la famille Heredia Girard
est pionnière et motrice. Le dernier
effort, vers 1860 pour sauvegarder le
taux de profit, sera la mise en valeur
de la zone de Bayate à proximité du
Taurus, à l’Ouest de celui-ci.
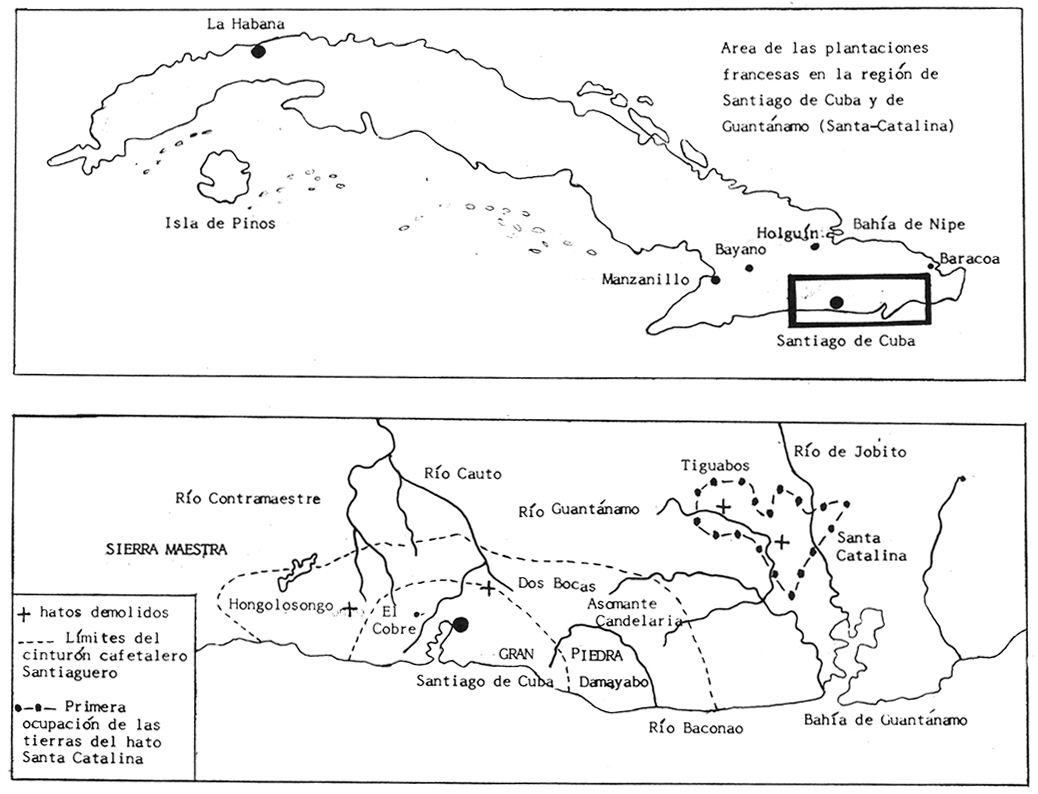
Cartes 3 et 4 établies par Alain Yacou, avec deux extensions
successives des caféières de Santiago et
la première extension des cafèières dans
le démembrement du hato de Santa
Catalina.
« À partir de
1858, Adrien est le nouveau
responsable de la surveillance de la
dernière habitation Lestapis à Cuba,
la Marie-Louise située sur le Mont
Taurus. Il a succédé à un sieur Lavergne,
neveu de Théodore Moracin, qui
lui-même avait endossé le rôle en
1847, succédant aux deux frères
Dufourcq et plus lointainement à…
André-Pierre Daudinot, son
père. » (H. de L.,
inédit).
En 1856, Hypolite vendit une caféière de 10 chevalées,
La Carolina, à Antonio Carbonell pour
800 pesos. Elle était dans le district
de la Amistad. AHPSC 106f208 : 10 août.
(correspondance
A. Renault). Cette vente
prépare son instalation sur le Monte
Taurus.
A la fin de la mise en valeur du Mont Toro ou Taurus, chaque membre de la fratrie Daudinot a réussi à être propriétaire, ce qui lui permet la fréquentation amicale de Léocadie Heredia Girard et son mari Jules Raoulx, l’administrateur de talent, chef de file des planteurs des flancs de cette montagne depuis El Potosi achetée par Domingo de Heredia. Ce n’est pas pour rien qu’il y ait des allusions a ce lieu Monte bèf, soit Monte Toro dans son « Piti causement »…
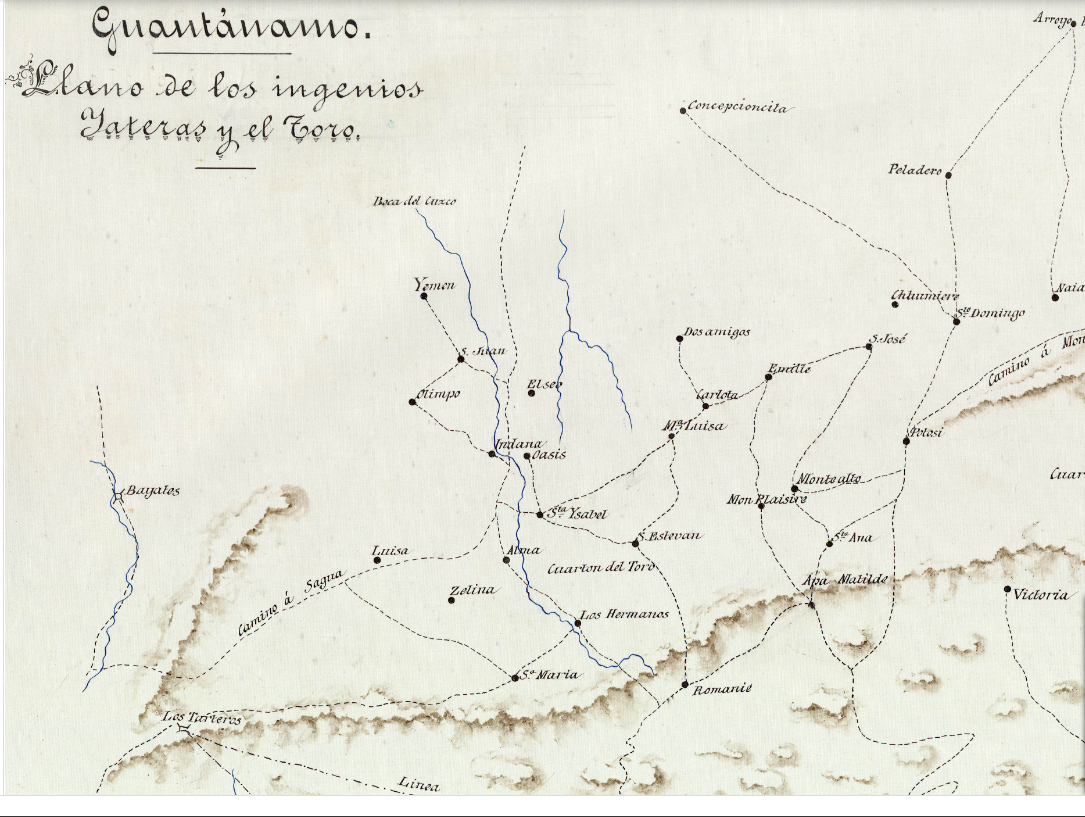
Cette prospérité facilite les voyages : « en
1859, Sévère et Hippolyte Daudinot
sont en Béarn, à Mont chez
Joseph Dufourcq. Juste un
passage car en 1860 Hippolyte est à
Santiago » (H. de L.).
Cette année là, Hippolyte correspond
avec la
Cie Lestapis à propos de deux de leurs
possessions de terres et une possibilité
d’extension sur des terres appartenant à
Ch.
Speecht (Specht pour
l’ambassade, nom qui deviendra
localement Speck par la suite). Nous
avons aussi la mention de la venue en
France d’Adrien trente ans après son
retour à Cuba. Mais
la Cie Lestapis revient sur ce
projet de nouvelle acquisition pour
agrandir La Mathilde du fait des
événements américains (la guerre de
Sécession), qui commencent à faire
douter sur des investissements basés sur
la main d’œuvre esclave : « Ce
qui se passe maintenant aux États-Unis
étant de nature à donner à réfléchir
avant d’engager de nouveaux fonds dans
votre île ». Pour autant
la plantation Marie Louise continue
d’avoir des revenus confortables pour
l’année en question. Hippolyte est
toujours à Cuba en 1861, année où
s’interrompt sa correspondance avec
Pierre-Sévère de Lestapis, lequel meurt
l’année suivante.
Prudent paraît dans une situation prospère dans ces années 50, mais il ne récupère pas sa santé. L'aîné de la fratrie, le premier à écrire en créole, ne fait pas de vieux os et meurt vers 1860.
En 1863, les autres frères ont des encore des projets
prometteurs en tant que planteurs, ce
qui transparaît dans une lettre de Jules
Raoulx à sa belle-mère Louise Girard en
1863 (écrite en français, mais ici
retraduite de l'espagnol) :
"J'ai
une
très bonne affaire en vue; il s'agit
des terres de Bayate qui sont vendues
et que les habitants du Taurus
[c'est-à-dire lui et ses voisins] sont
déterminés à acheter comme dernier
recours des plantations de café.
Nombreux sont déjà ceux qui pensent à
y établir de nouveaux établissements.
Il semble que ce soit une magnifique
vallée de terres aptes pour toutes
sortes de cultures. Les Daudinot sont
très excités ... " ("Cafetales y vida
criolla: la familia Heredia-Girard en el
oriente cubano" HERNÁN VENEGAS DELGADO.
Catauro n°18. 2008. La Havane). Jules
Raoulx n'a finalement pas acheté la
terre de Bayate (au nom des Heredia
Girard) et les Daudinot, privés de ce
soutien essentiel, non plus. Cependant
Bayate est toujours aujourd’hui connue
pour ses cultures de café, et d'autres
français y ont investi (dont au début du
XXe siècle une branche des
béarnais Bénégui, cf Laurent Bénégui
"Retour à Cuba" éd. Julliard, 2021).
De fait, la même année, Hippolyte participe à l'achat de terre le plus important de Tiguabos : les sœurs Candelaria et Maria Castellanos vendent 186 caballerías " d'une propriété et "trois quart d'une autre" (?) à la société formée par lui et ses frères ainsi que Pablo Lamothe, Augusto Thomas, Eduardo Chivas, Félix Armand, la société Casamayor, et la succession Juan B. Mégret (7 fils). "Les Daudinot" prennent la part relative la plus grande : 60 cabalerias. (ALONSO COMA. 2014).
La première guerre d’indépendance cubaine déclenchée en
1868 aura de lourdes conséquences chez
les propriétaires des plantations de
café déjà mises à mal par la concurrence
brésilienne. Elle intervient à la fin
d’un processus de remise en cause
internationale de la plantation
esclavagiste. En principe ces
propriétaires sont hors-la-loi vis-à-vis
de la France depuis l’abolition de 1848.
La guerre civile aux États-Unis avec l’enjeu de
l’abolition de l’esclavage dans les
États du Sud avait déjà annoncé la fin
du système de la plantation reposant sur
l’esclavage. Les Français et leurs
descendants ont des relations anciennes
avec un de ces États, la Louisiane.
Celle-ci doit mettre fin à l’esclavage
par une loi en 1865. Des planteurs
francophones quittent cet Etat, sinon le
continent. La correspondance de Jules
Raoulx, montre son inquiétude sur ce que
signifie ces événements sur l’avenir des
caféières cubaines. Inquiétude qui a
toutes les chances d’être représentative
de ses alliés en affaire. Lettre à Félix
Dufourcq
(à Bordeaux), 16 mai
1865 : « Les
événements qui se succèdent aux
États-Unis nous tiennent ici dans une
grande inquiétude, nous sentons que
notre avenir est très compromis, tout
est cependant bien tranquille ici, le
mal ne peut venir que de l’extérieur ».
Depuis le 27 décembre 1968 s’applique sur les
territoires gagnés par les insurgés le
décret d’abolition de l’esclavage de
Carlos Manuel de Cespedes. Les troupes
espagnoles défendent les plantations,
que ce soit pour des raisons tactiques
ou la demande des propriétaires qui ont
fait le choix du maintien de ce système
dans le cadre de leur alliance avec la
monarchie espagnole depuis sept
décennies. Les caféières montagnardes
défendues par des troupes espagnole
deviennent des cibles militaires des
insurgés. En mai 1969 une quinzaine de
caféières sont incendiées autour d’El
Cobre et cette zone passe aux mains des
insurgés fin novembre. Au même moment,
une caféière est incendiée à Ramón de
Las Yaguas (de Mme Vve de Durade).
L’incendie de Bayamo par ses propres
habitants pour éviter qu’elle soit prise
par les Espagnols en janvier 1969,
marque fortement les esprits. En
décembre 1870, l’attaque des rebelles
sur Tiguabos se solde, selon les dires
du lider
Maximo Gomez par l’incendie de 200
maisons (il se peut qu’il exagère) et
aussi celui de la sucrerie Santa Ana de
Griñan et les caféières Reconpensa, San
Alejandro et Candelaria. Soit, sauf
erreur, la caféière historique des sœurs
Brun et des fils Daudinot. A la suite,
décrit un journal havanais, beaucoup de
propriétaires de cette zone « pacifique …
ont abandonné leurs fermes et viennent
se mettre à l’abri dans la ville (de
Santiago)
avec le petit nombre d’esclaves de
leurs dotations qu’ils ont pu
sauver ». [72]
De plus, la zone du Taurus devient in théâtre important de la guerre entre indépendantistes et le pouvoir espagnol. Précisément elle devient la base d’opération de Maximo Gomez et Antonio Maceo. « Le 1er février 1871, on évoque dans le Boletin mercantil de Puerto Rico les ravages de la guerre entre les insurgés cubains et le pouvoir colonial espagnol. Il y est question de la cafetal de D. Adriano Dandinot (pour Daudinot), qui a été brûlée par les « rebelles » (H. de L.). C'est la propriété de notre Adrien. Le 11 mars 1871 Jules Raoulx écrit de France aux Brooks, négociants de sa production : « …toutes les nouvelles qui nous viennnent de Cuba nous portent à croire que l’insurrection est terminée, je vous en félicite pour vos intérêts. Quant à nous pauvres caféiers, je ne me fais aucune illusion, tout est bien fini pour nous ; nous végèterons encore quelque temps avant de nous éteindre tout à fait ». Brooks fait le point sur les ventes des denrées du Potosi le 23 août 1871 et écrit à Jules Raoulx que « vers le 4 courant, les insurgés ont fait une descente sur le bas Taurus et voici la liste des habitations que l’on suppose avoir été détruite par eux : Indiana, Oasis, Buena Vista, Olimpo, Elisée, Santa Maria del Cuzco, Eldorado, Luisa, Ste Isabelle, Los Hermanos, Ave Maria, Zephire, Alma, La Soledad, El sitio, St Etienne, Dos Amigos et Romanie. Les habitations qui n’ont pas été détruites sinon abandonnées en conséquence du sinistre précédent sont « Monte Alto », Potosi, Emilie, Ana Matilde et Mon Plaisir ». La Soledad livrée aux flammes est-elle bien la propriété qui fait la continuité du destin des frères Daudinot ? Brooks ajoute que la situation n’étant plus tenable, Potosi a été évacué et demande à son interlocuteur présent en France « Que faire des nègres ? ». Il lui sera répondu : « Vendez nègres sans exception, Chaumière aussi » (Chaumière : une propriété secondaire par rapport à l’imposante Potosi ; en 1843 cette encore cotonnerie était encore au nom d'Isidore Bayeux et y travaillaient dix esclaves).
L'Ana Matilde citée dans le précédent paragraphe doit être "la Matilde" qui a été attaquée postérieurement et est une des prises dans lequel s'est illustré l'indépendantiste descendant de Français Flor Crombet (V. notre page sur Flor Crombet), cf carte 5.
Par
parenthèse, le lecteur pourra s'étonner de
la confiance absolue manifestée par ces
planteurs Français au négociant et
banquier anglais Brooks. En fait, les
Brooks, qui correspondent par écrit en
français, sont familialement intégrés à
cette communauté. En effet Thomas
Brooks épouse vers 1824 Marie-Louise
Despaigne. On a déjà rencontré
ces Despaigne originaires de Bordeaux,
liés aux Heredia Girard (cf.
plus bas).
Entre
1825 et 1841, ils
ont ensemble huit enfants vivants
investis dans des maisons de commerce et
une banque. L'une des filles épousera
Léonce Heredia Yvonnet, un enfant du
premier lit de Domingo de Heredia (une
fois veuf, Léonce se remaria à une
Thérèse... Despaigne). Cette famille finit
par quitter Cuba pour la France (cf. plus
bas). Dans la correspondance à laquelle
nous avons eu accès, alternent les
dénominations "les Brooks", "la maison
Brooks", une famille d'affaires où
l'individuation importe peu. Le bateau qui
faisait la navette entre Santiago et
Guantanamo au milieu du 19e
siècle portait le nom du fondateur de
cette famille, le "Thomas Brooks".

Hippolyte Daudinot a
probablement connu le confort de ces
chaises à bascules (localement nommées
du galicisme "balances") autant
élégantes qu'originales ramenées de Cuba
par Jules Raoux et son épouse Léocadie
Heredia Girard (Remerciements à Marie
José Delrieu pour m'avoir autorisé à
prendre la photo).
En 1871, Hippolyte
prépare un repli hors de Cuba.
Indice : il vend 9 esclaves à
José Baró de Matanzas (ALONSO
COMA. 2014). Au moins une de
ses deux plantations, Los
Hermanos a été incendiée par
les rebelles.
Mais
il s'agit de financer des études pour
une reconversion d'activité : c'est aux
USA que nous le retrouvons d'abord, au Pennsylvania
College Dental Surgery, dont
ilressort diplômé en 1972. (Document
rencontré par H. de L.). De là, il part
pour Bordeaux (un
autre
document,
sorte de fiche
très
succincte,
confirme bien
un Hippolyte
Daudinot
« docteur » et
surtout membre
de loges
maçonniques à
Bordeaux dans
les
années 1872-73).
Ainsi, l'ex- planteur Hippolyte devient
en 1874 « dentiste rue du Champ de
mars » à Bordeaux (actuellement rue du
professeur-Demons).
Hugues
de Lestapis a récemment découvert que la
mère de la fratrie, Marguerite Brun est
également venue en Fance, elle qui n’y
avait jamais vécu. Hippolyte doit être
son soutien familial. Elle s’éteint le 4
mai 1874 à Bordeaux à l’âge de 92 ans,
l'acte de décès faisant foi.
Hippolyte a récupèré et sauve de l’oubli une petite
dizaine des fables et poèmes en créole
en piteux état dans les papiers hérités
de son frère aîné, écrits qui avaient
divertis la gent féminine de la famille
Heredia : Léocadie, ses sœurs et
leur mère Louise. La recherche de ces
écrits à été motivée par la demande
qu’elles en avaient faites. Il puise
dans cet intérêt le ressort pour écrire
à sont tour en créole, le « langage
naïf qui charma mon enfance »,
dit-il à la destinataire du manuscrit.
Il se décrit à ce moment comme un homme
âgé, aux cheveux blanchis. Ce qui laisse
croire qu’il a écrit ses vers créoles
une fois installé en France, à la
différence de son frère qui a écrit les
siens à Cuba, où il est mort
(d’ailleurs, la façon dont le cadet
parle des biens abandonnés de l’aîné
laisse penser que Prudent n’avait pas
d’héritier).
Cette relation révèle à la fois que les deux frères ont
acquis dans leur histoire familiale la
maîtrise du créole et le fait qu’elle
était comprise aussi (voire
employée ?) par cette famille
blanche de pater
familias aristocratique, venue
des deux parties de l'île d'Hispaniola
(espagnole et française) que sont les
Heredia.
Cette écriture du créole assortie de choix spécifiques
(la versification française) atteste
l’emploi oral du créole comme langue de
communication dans la plantation, entre
esclaves, Noirs libres et maîtres blancs
ou métissés. Une langue de travail qui
n’exclut pas, loin de là, des usages
culturels (contes moraux, veillées…)
dans des lieux retirés pauvres en
divertissements.
Ainsi, les écrits en créole d'Hippolyte, inspirés par
le précédent de son frère,
sont très probablement
postérieurs à son retour en France,
comme l’est, sûrement cette fois, la
dédicace à Mme Veuve Raoulx, autrement
dit Léocadie de Heredia (1834-1918).
Celle-ci est retournée définitivement en
France depuis 1868, suivie sa mère
Louise Girard en 1869, retour anticipant
la fin inévitable du règne de
l’esclavage à Cuba et la ruine de
nombres de plantations (cf ci-dessous).
« Le 14 décembre 1875, il obtient un
passeport pour aller au Guatemala.
Dans la colonne « signes
particuliers », les autorités relèvent
une brèche dans sa dentition et aussi
une boiterie de la jambe droite »
(H. de L., id.). Le thème du danger des
chevauchées dans le décor montagneux de
l’Est de Cuba, revient dans ses écrits
poétiques. Y a-t-il un lien? Fût-il
victime d’un accident de cheval?
Ce handicap a peut être nui à un mariage de cet homme
resté célibataire. Il se pense pourtant
plutôt séduisant : « je
peux gagner n'importe quel beau brin
de fille / Le jour où il m'en prend
l'envie » nous dit-il dans
Beauté Ibo. Dans son poème en français
"Mon regard", paraît une confiance sur
le pouvoir de séduction de celui-ci, de
même qu'on devine un beau parleur. En
tout cas, sa boîterie ne l’empêche pas
de voyager. « Un
autre passeport, du 14 juillet
1877, le dit partant pour l’Espagne,
« accompagné de ses deux nièces », Jeanne
et Marie,
filles
de sa sœur, épouse Dufourcq. Celles-ci
vivent en France, ainsi que leur frère
Louis-Adrien
Dufourcq, officier de marine.
Hippolyte a le « teint ordinaire »,
précise le document, et il est
« citoyen français ». Depuis quand ?
Né à Cuba, en terre espagnole, fils
d’un Français naturalisé espagnol, il
devait être administrativement
Espagnol. (…)
Le
13 mai 1880, Adrien Daudinot
passe par Bordeaux pour se rendre en
Espagne, un passeport conservé aux
archives de la Gironde en atteste (H.
de L).
Parmi
les caféières démolies dans lles
années 1880, apparaît La Sidra
appartenant à ce grand-frère
d'Hippolyte, vendue pour une bouchée
de pain pour être sans production,
mettant très probablement fin à sa
qualité de propriétaire à Cuba.
(ALONSO COMA. 2014)
En
1887, Hippolyte bouge encore. Cette
fois, c’est l’Italie et tout seul
« (H.
de L). L’Italie
chère à cet un homme pétri de culture
classique.

Rue du Palais Gallien à Bordeaux, où Hippolyte Daudinot vécut ses dernières années et mourut
Jacques de Cauna a permis de connaître la fin
d’Hippolyte : il se suicide d’un
coup de revolver dans la bouche le
5 octobre 1894 en son domicile de
la rue du Palais-Gallien de Bordeaux,
atteint d’une maladie incurable[73].
Il
avait,
avant de se donner la mort, disposé sur
une table, bien en évidence, un billet
portant ces mots : «
Adieu bon frère ! Adieu nièces,
neveux, parents et bons amis ! La
lutte est inégale, je cède ! »
(H. de L.).
C’est la fin du « délicat poète romantique
béarnais né à Santiago » nous dit
Jacques de Cauna. En effet, avant
d'écrire en créole en France, avait
écrit en Français à Cuba. Un de ses
poèmes édité dans la presse locale sous
la signature HD, "Mon regard" a été
reproduit intégralement par Emilio
Bacardi dans ses célèbres Crónicas de
Santiago de Cuba (pp. 388-389). Délicat
poème en effet qui prend le point de vue
féminin dans les jeux de l'amour.
Il
va
faire de sa nièce Jeanne
Puncet née Dufourcq, celle qui,
entre les deux filles de Luce, a
été abandonnée avec ses enfants, sa
légataire universelle. Il s’ensuit une
brouille des deux sœurs, face à
l’incompréhension de Marie concernant
cet héritage, d’ailleurs assez modeste,
sans propriété terrienne. Le conflit
devra être réglé par M. Edmond de
Lestapis.
En septembre 1895, Adrien échange des courriers avec
Edmond de Lestapis, il est apparemment
du côté de Guantanamo. Il est resté à
Cuba malgré les adversités concernant sa
propriété un quart de siècle auparavant.
C’est le moment d’une deuxième guerre
d’indépendance.
A ce moment tous les esclaves ont été libérés à Cuba (les derniers en 1886). Outre une éventuelle descendance directe encore à établir, la descendance des ex-esclaves des propriétés Daudinot, devenus libres à divers moment, suffit pour faire de ce nom un patronyme caractéristique de la province de Guantanamo. Un nom qui décline des musiciens liés aux traditions caractéristiques de cette province (de tumba francesa ou de changüi...), des figures sportives, des universitaires ou des héros.[74]
Il y a eu au moins un Daudinot de la troisième génération à Cuba, qui a connu la Cuba insépendante :
Daudinot Epiphane : Il était né à
Santiago de Cuba le 6
février 1838. Il fut
immatriculé au consulat
français de cette ville le
20 septembre 1912 (il
l’avait déjà été dans le
registre 3), registre 4
n°2658. Il était dit
propriétaire. Il se maria au
Caney en 1867 avec Eléonor
Vernhes. Il vivait à
la Soledad (Alto Songo) (correspondance
d'Agnès Renault).
Soit une propriété des
Daudinot depuis 1815. Épiphane
pourrait être
fils d'Adrien
ou de Sévère.
A
ce moment, nous ne savons
pas s'il a eu des
descendants. De cette
question dépend apparemment
la possibilité d'existence
aujourd'ui dans l'île d'une
descendance légitime du
patronyme Daudinot introduit
par André-Pierre Daudinot à
Cuba.
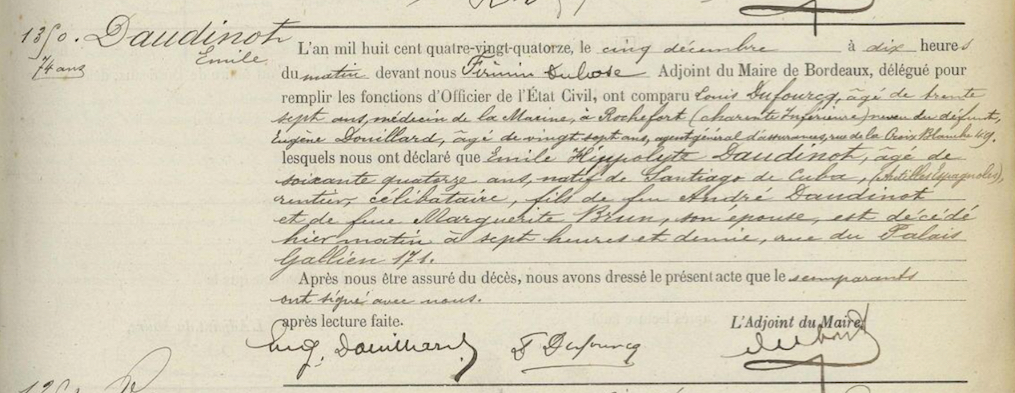
Sur
la
destinataire du recueil :
Domingo
de Heredia (Santo Domingo 1783 –
mort en mer[75]
1849) et Louise
Girard d’Ouville (Cuba
1806 -
France 1877) fondent la
famille des Heredia Girard. Pour
que se rencontrent, pour sa
seconde noce, le descendant des
Heredia de la partie espagnole
de Saint-Domingue réfugié à Cuba
et
Louise/Luisa
Girard, il
aura fallu le
retour de
Louisiane des
Girard Rey une
dizaine
d'années après
les évictions
de Français
(en ce cas
réfugiés
domingois) de
Cuba suivant
l'invasion de
l'Espagne par
Napoléon. Les
mariages de
deux sœurs de
Louise
révèlent des
alliances avec
des familles
fortunées des
Français
d'Oriente, les
Dufourcq et
les de
Ribeaux.
Louise-Sophie
"Euphémie"
Girard a
épousé
Jean-Joseph
"José" de
Dufourcq (venu
d'Arthez de
Béarn, fils
d'une
Casamajor) et
Jeanne Louise
"Helmina"
Girard se
marie à Eugène
de Ribeaux
(d'Orthez).
Léocadie
de
Heredia Girard
(1834-1918),
aînée de la
fratrie née de
cette union et
destinataire
du manuscrit
Daudinot s'est
mariée en 1856 à Tiguabos[76]
avec Jules-Vincent Raoulx
(Saint-Georges d’Oléron 1819 -
Saint-Georges d’Oléron 1883),
ancien administrateur de
caféières d'abord de la famille
Girard (Monti-Bello dite aussi
Montebello), puis Heredia
Girard, après être arrivé à 13
ans à Cuba avec son père en
1832. Le père de Jules Raoulx
avait suivi le chemin d'un
cousin Oléronais venu lui aussi
chercher fortune à l'Est de
Cuba, François Benjamin
Moreau (lui arrivé en
1821), mais il meurt de la
fièvre jaune deux ans après son
arrivée et son installation
comme administrateur d'une
caféière. Le jeune frère de
Jules, Paul Raoulx,
rejoindra l'aîné, à 17 ans, en
1839 et le secondera, il se
mariera à une héritière du futur
premier maire, français, de
Guantanamo Laurent Jay : Laure
Jay.
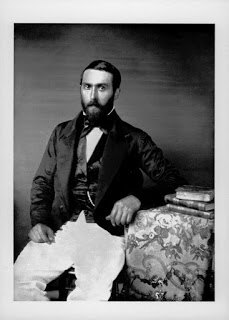
Léocadie naît dans la cafière La Fortune, lieu où le
voyageur Rosemond de Beauvalon
décrit une propriété et un tableau
de famille idyllique. Il n’est pas
indifférent que le fondateur de La
Fortune, Domingo, joue un rôle
moteur dans les changements de
localisation des caféières, selon
l’épuisement des sols et les
nouvelles opportunités, entre les
premières occupations proches du
port de Santiago puis de la zone
de la Gran Piedra (à partir de sa
caféière d'origine à La Güira :
Monti-Bello, dite aussi
Montebello, La Fortune, La
Sympathie, La Candelaria...) vers
la mise en exploitation de terres
plus distantes, La Fraternidad
(avec les associés et beaux-frères
Ribeaux et Dufourcq), jusque dans
les hauteurs surmontant l’actuelle
ville de Guantanamo (ex. Le Potosi
en 1844, El Cuzco, puis La Naïade
(aussi Nayade), La Chaumière,
Santo Domingo), cf carte.
Elle est l’aînée d’une fratrie de six enfants
dont :
- l’académicien José Maria de Heredia (Cuba 1842 - Paris 1905), « Pepillo » pour la famille, marié à Louise Despaigne Dutocq (Cuba 1844 - France 1897). Le benjamin et seul garçon survivant. Il est naturalisé français en 1893 et rentre à l'académie en 1895.
- María Dolorés de
Heredia (1839-1925),
laquelle s'est mariée en 1858 à Louis
Henri Despaigne
(petit-fils du premier Despaigne à
Cuba : Jean). Nous supposons
qu’elle a vécu dans une des deux
propriétés des Despaigne près d’El
Cobre[77].
- María Josefa Antonia (Helmina ou Minette) (1837-1918).
S’y ajoute la fratrie née du premier mariage de Domingo
de Heredia avec une autre
descendante de Français de
Saint-Domingue, Geneviève Yvonnet
: il était à ce moment établi dans
la première de ses habitations, La
Güira (ces Heredia s'appellent
Manuel, Gabriel, José Francisco,
Gustave, Isabel "Elisa", Gabriel,
Léonce).
La propriété familiale des Heredia Girard est La
Fortune, que Luisa n'aurait jamais
voulu quitter. Ses affaires
prospérant, Domingo de Heredia
achète au fil du temps neuf
caféières. Une des propriétés est
la Nouvelle-Fortune (Nueva
Fortuna), la seule consacrée
principalement au rhum. Mais la
possession familiale la plus
importante économiquement est
celle du Potosi administrée par
Jules Raoulx. Luisa Girard finit
par rejoindre Jules et Léocadie au
Potosi en 1957. Auparavant, la
correspondance entre les deux
établit que Jules défend les
intérêts de Louise Girard par
rapport à l'ingratitude ou
comportement dispendieux de tel ou
tel héritier Heredia Yvonnet.
C'est dans cette période qu'une vie de famille des
Heredia Girard se reconstitue au
Potosi, alors qu'Hippolyte
Daudinot est devenu propriétaire
dans le même "cuartón" de la
montagne comme ses frères, qu'il y
a le plus de fréquentation entre
ces familles, renouvelant la
fréquentation qui existait du
temps de Adrien-Pierre Daudinot et
Domingo de Heredia.
Tous les Heredia Girard ont rejoint la France autour du déclenchement de la guerre des dix ans. La mère Luisa vivait aux côtés de Pepillo dans son domicile parisien, avant de rejoindre Saint-Georges d'Oléron au moment de la Commune de Paris.
Du fait de l’appeler « Veuve », le
manuscrit serait adressé à
Léocadie après 1883, quand elle
vit dans l’île d’Oléron (dont
est originaire son mari) et que
Hippolyte Daudinot vit à
Bordeaux, soit au minimum une
dizaine d’années après le retour
en France d’Hippolyte.
Postérieurement
à la mort d'Hippolyte, Marie
Régnier, la fille de José Marie
de Heredia Girard, née à Paris,
attestera de l'utilisation du
créole conservé dans la mémoire
de la vie à Cuba de sa famille.
Sous son nom de plume, masculin,
Gérard d'Houville, elle évoque
dans un livre situé au temps de
ses ancêtres dans les cafèières
de la Gran Piedra, le Séducteur
(1913), une esclave domestique,
Indalencia, qui dormait
recroquevillée à l'entrée de la
chambre de sa maîtresse "comme
un chien fidèle" (sic) et qui
conversait avec elle en créole.
Elle confirme ainsi les propos
d'Hippolyte sur le bon accueil
fait à ses vers créoles par les
femmes de cette famille, qui
supposait leur bon entendement.
La même autrice, dans le poème
"Stance aux dames créoles" dédié
à ses aïeules "mortes et
jadis des ingénues" donne
par moment comme un écho des
vers des frères Daudinot sur les
caractéristiques des Noirs des
plantations des Français :
"Les
bons nègres rieurs dansaient
des nuits entières
Leurs bamboulas
Ou bien chantaient des
chants parmi les caféyères"
(Gérard d'Houville,
Les poésies)
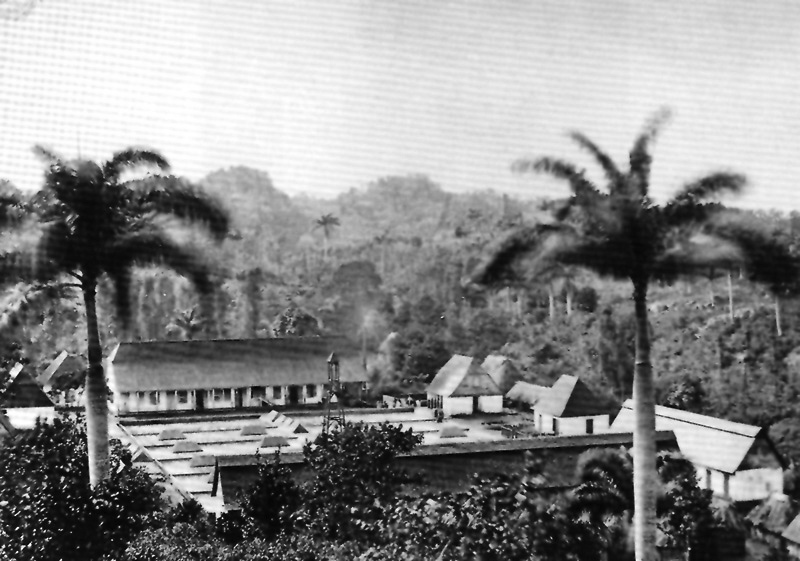
Les deux frères Daudinot, ont une relation semblable à
la langue créole et la double
culture créole et française,
incluant une approche littéraire.
Des motivations de l’aîné des deux, Prudent Daudinot à
faire des vers en créole après
avoir appris à en faire en
français, nous ne savons rien
directement. Ce qui est parvenu de
lui se résume à quelques fables
sur le modèle de La Fontaine et
une lyrique de l’amour.
En ce qui concerne les fables, une morale sur le danger
pour un esclave de changer de
maître va dans le sens d’inclure
comme auditoire à ses vers les
esclaves de l’habitation dans des
moments de repos.
Hippolyte
Daudinot s’exprime, lui, sur ce
cheminement d’écrire en créole,
qui vient du modèle de son
frère : « C'est
à mon frère, paix à son âme, que
je le dois. Depuis son jeune
âge, il connaissait quelques
vers en français. Un jour,
l'idée lui a pris d'en écrire en
créole.
Ces vers, je les
trouvais pas mal troussés. Après
sa mort, de bonnes amies m'ont
priées de redonner vie à ses
poésies créoles qu'il aimait
tant écrire. »[78]
Il insiste sur le long délais entre la mort de son
frère et la découverte de
fragments d’écriture de celui-ci,
pour leur redonner une existence
et
suivre ce modèle : « Bien
des années sont passées jusqu'à
aujourd'hui. En fouillant, j'ai
découvert au milieu de vieux
papiers crasseux, quelques
brouillons de vers en créole. Il
s'agissait de l'écriture de mon
frère, couchée à la mine de
crayon et passablement
embrouillée. Quel travail se fût
pour en déchiffer le contenu!
Beaucoup de fragments
manquaient. Je me suis fait
violence à tenter de les
reconstituer. Des heures à me
gratter la tête, à
frapper du pied, lever les yeux
au ciel, suer sang et eau, pour
arriver tant bien que mal au
résultat présent. »
Après avoir achevé le travail de transcription des
poèmes de son frère, une idée a
germé dans son esprit :
« Mesdames,
chères
belles amies, vous qui
affectionnez les vers en créole,
pourquoi je n'essaierais pas
d'en écrire moi-même ? Ne
serait-ce pas le moment de vous
les écrire ? ».
Ce qui le soutient dans ce projet, c’est plus sa bonne
connaissance de la langue créole
que ses talents de
versificateurs : « Certes,
de poète je n'ai point le
métier ; mais pour ce qui
est de la langue créole,
personne ne saurait être plus
compétent ! Depuis mon plus
jeune âge, lorsque je prenais
encore la têtée, puis courant la
campagne en chemise blanche,
j'ai eu coutume de fredonner
ceci : « Chers amis,
je ne suis point fini, la nation
créole, c’est la nation de ma
mère . C’est ma nation et,
sacredieu, pourquoi diable je
n'écrirais pas dans ma
langue ? »
C’est bien du côté maternel qu’il tient cette
connaissance, de la quarteronne de
Saint-Domingue qui l’a mise au
monde et apparemment élevé sans
qu’il y ait indice de forte
présence paternelle avant qu’il
soit envoyé en France. Aux côtés
de la mère : des tantes et
une grand-mère de même histoire.
Une mention reste énigmatique : « Ce que j'ai
appris de mon frère, comme des
autres qui écrivent en créole
… ». Hippolyte Daudinot
a-t-il eu accès à des précédents
dominguois ou autre île antillaise
de faire passer le créole à
l’écriture (cf ci-dessous) ?
Ou y a-t-il eu d’autres tentatives
locales oubliées depuis? Nous ne
le savons pas). Mais le modèle du
frère n’est pas l’unique. Il est
même possible qu’il ait eu
connaissance de précédents
antillais ou louisianais à l’âge
mûr, une fois rentré en France.
Mais ces tentatives, il les décrit lui-même comme
exceptionnelles : « Le
français est une langue polie et
repolie par les siècles, alors que
le créole, pauvre diable, est né
hier. Il babille encore, c'est une
langue jeune qui ni se lit ni
s'écrit. »
Le créole de Hippolyte Daudinot n’est pas mature,
détaché de son évolution à Haïti
après l’indépendance de 1804. Une
fois dit ceci, intervient un autre
élément : le choix même
d’écrire en vers l’amène à mettre
du français dans ce créole et à le
modifier : « Fort bien !
On va mettre des genres également
dans les rimes créoles. Pour y
parvenir, il va nous falloir les
priver d'une partie de leur
beauté. On est contraint parfois
d'adjoindre quelques mots de
français. C'est une licence
compréhensible, mais nous ne
sommes donc plus dans le vrai
créole. Cela ressemble alors à une
sorte de parler où l'on essaie
d'imiter le français. C'est ce que
nous qualifions de « parler
pointu ». On voit qu’avec
cette contrainte de versification
qu’il s’impose, la plupart des
mots qui terminent les vers sont
du « bon » français…
Hippolyte Daudinot ne s’inscrit pas dans une dynamique
d’écrire le créole pour lui-même,
dans une dynamique de l’expression
populaire. C’est l’écriture d’une
langue souvenir. Mais pour
l’écrire il n’oublie pas les
règles orthographiques françaises
apprises dans une bonne école,
quelle qu’elle soit, par exemple
les doublements de consonnes (mm,
nn), la conservation des m devant
un b ou p
pour le son
« on », respect des
terminaisons en « x »,
consonnes muettes :
« vingt »,
« fond »,
« chaud » ;
présence scrupuleuse du
« ç » :
« garçons ». Un bel
exemple de respect
orthographique du français :
« naseaux »… Très
souvent la seule différence avec
le mot français est l’apostrophe
qui remplace un e final, comme
pour ne pas faire oublier que les
mots doivent « chanter »
créole.
Pour autant une vivacité de l’oral créole est encore
présente, conforme à son
vœu : « pour ma part je
revendique la liberté que ma
langue courre la campagne à
l'envi, en compagnie de mes vieux
amis et animaux ».
Il est intéressant de remarquer que jamais Daudinot
n’emploie, pour désigner le
créole, le mot patois (ou patuá en
écriture castillane) pour désigner
cette forme linguistique, alors
que ce second mot s’imposera
localement pour la distinguer dans
l’usage populaire local au XXe
siècle.
Le créole de Daudinot a très peu de perméabilité avec le castillan de Cuba (d'autant plus facilement qu'il maîtrisait mieux d'autres langues que le castillan si nous nous appuyons sur ce qu'en dit Emilio Bacardí Moreau (cf supra). La dégradation linguistique par transculturation n'a visiblement pas encore commencée. La recréolisation castillane n'est que très peu affleurante[79]. Elle le sera beaucoup plus dans la littérature orale des chansons parvenues jusqu'à nous des chants des sociétés de tumba francesa (de même que dans un second temps que dans celle de la communauté haïtiennne de Cuba). L’explication en est probablement sociale : d’un côté un créole de lettré avec une excellente connaissance de l'écrit de la langue française de propriétaire français, qui aura tendance à revenir au Français qu’il maîtrise par nature lorsque lui manque un élément dans l’expression au créole, de l’autre des personnes du peuple, anciens esclaves de ces derniers, n’ayant pas de référence écrite et environnés de semblables parlant espagnol, contrôlés par une administration en espagnol ; et pour leurs descendants l’alphabétisation en español.

Caféière La Fraternidad rénovée
(plateau de Santa María de
Loreto). Photo René Silveira
Toledo. Elle a été fondée en
1835 par une société comprenant
Domingo de Heredia et les
familles Dufourcq et de Ribeaux.
En 1844, elle reste aux mains
des seuls Ribeaux, qui oublient
leur particule à la troisième
génération.
D’après Alain Yacou, des inventaires de 1808-1809, à la
fin de la vague des réfugiés de
Sant-Domingue dans l’Oriente
cubain, « nous révèlent
l’existence de véritables isolats
et à tout le moins d’oasis de
culture ». Il qualifie cette
culture de
« franco-domingoise »,
s’agissant tout
particulièrement des habitations
cafeières établies dans les
hauteurs
qui entourent Santiago de
Cuba et même déjà dans les
établissements qui commençaient à
occuper les alentours de la baie
de Guantanamo.
La présence française s’y renforcera considérablement
au demeurant après la chute de
l’Empire. En particulier grâce au
retour venant de Louisiane d’une
partie des expulsés au moment de
l’invasion napoléonienne de
l’Espagne, retour grossi de
nouveaux louisianais[80],
puis de nouveaux arrivants de la
métropole française.
Aussi, continue Yacou, « l’un
des traits distinctifs de ce
qu’il faut bien appeler la
civilisation des caféières
françaises fut-il l’utilisation
constante qui y était faite
comme en Saint-Domingue de la
langue créole entre maîtres et
esclaves et parfois entre
personnes réputées blanches
elles-mêmes, fussent-elles le
propriétaire, l’habitant comme
on disait, et ses proches. Il
est juste d’ajouter que l’emploi
de ce créole à base lexicale
française déborda largement
l’aire des plantations pour
pénétrer le monde urbain où l’on
retrouvait également des
réfugiés français dits de
couleur. Il n’est pas au
demeurant jusqu’aux fameux
refuges – les palenques
— des nègres marrons où ledit
créole n’ait eu droit de cité au
siècle dernier ».
Le musicien louisianais, fugitif de Saint-Domingue,
Louis Moreau Gottschalk témoigne
en 1857, sans distinguer entre
français et créole : « Mon
grand-père et la plupart des
colons émigrèrent à la
Nouvelle-Orléans ; un grand
nombre se réfugia aussi à
Santiago de Cuba, où il se
consacra à la culture du café.
Aujourd’hui, l’aristocratie de
la Louisiane et de Santiago sont
presque exclusivement d’origine
dominicaine (sic),
et les nègres de la province
orientale de Cuba parlent encore
le français des colonies de
préférence à l’espagnol. »[81].
Selon F. Boytel Jambú « Les propriétaire de plantation de café bien qu’ils parlaient un français correct (…) l’employèrent très peu avec les esclaves et préférèrent leur enseigner et utiliser en pratique le Patois ».
Au cours de son voyage quadrillant Cuba, Samuel Hazard, l'auteur états-unien de Cuba with feather and pencil part de Guantanamo, est accueilli chez les Brooks pour rejoindre les plus hautes caféières de Yateras. Il est enchanté des paysages, du climat plus doux et stable que sur la côte et de l'affabilités de ses guides et de ses hôtes de la communauté française, c'est visiblement le meilleur souvenir de Cuba qu'il emportera. A propos de son hôte, il nous dit : "...mon futur amphytrion, de même que beaucoup d'habitants de la région, est un descendant des premiers colons français qui cherchèrent refuge à Cuba, fuyant les terribles massacres de Haïti, et qui, une fois ici, se sont installés de la meilleure manière possible, se consacrant a leurs anciennes occupations de culture de la canne à sucre et du café. Français d'origine, éduqué aux Etats-Unis depuis l'enfance et vivant constamment parmi les espagnols, il avait la capacité de parler aussi parfaitement que si c'était sa langue natale autant le français que l'anglais et l'espagnol, et de plus il possédait l'espèce de jargon que parlent les créoles, un mélange corrompu de français avec quelque chose d'espagnol, qui est le langage habituel des noirs des plantation.(souligné par nous, notre traduction). Il nous décrit des Français de Cuba plus polyglotes que ceux de la métropole mais aussi créolisants (même si son analyse de la nature du créole laisse à désirer). Peut-être d'ailleurs le trilinguisme d'enfance français/créole/espagnol formait-il un socle fécond pour l'élargir en un multilinguisme. Par contraste, les riches propriétaires de Louisiane étaient renommés au début du 19e siècles pour dédaigner absolument un usage quelconque de l'anglais!
Quant au milieu urbain, Boytel Jambú indique que le créole fut parlé « jusque dans la classe moyenne », laquelle était amenée à préciser quand elle s’exprimait en français correct (« francés fino ») ou en « Français de la rue du Coq » (de la rue Gallo de Santiago de Cuba, principal noyau initial de cette population en concurrence avec le quartier qu’elle créa et baptisa comme « Tivoli »). Cette expression de "Français de la rue du Coq" est reprise à son compte, par expérience directe, par un précurseur, de l’anthropologie cubaine, le marxiste Romulo La Chatagnerais, publiquement Lachatañere, lorsqu’il analyse les contradictions « au sein du peuple » est-on tenté de dire entre mulâtres de deux traditiios linguistiques et entre mulâtres et noirs (cf notre article sur Flor Crombet et Romulo Lachatañeré).
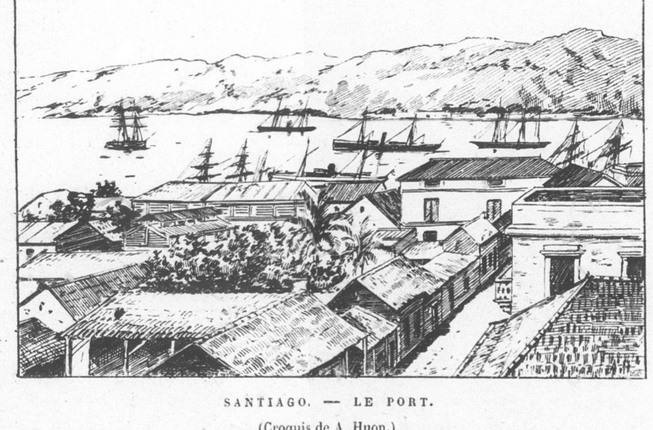 |
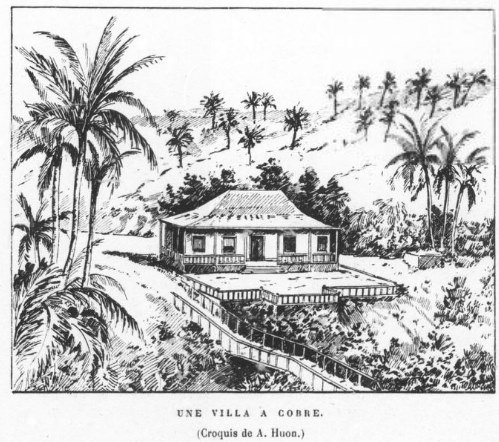
|
Une mention de cet usage du créole, nous la retrouvons
dans un roman historique du
combattant indépendantiste puis
premier maire de Santiago à
l’indépendance Emilio
Bacardi Moreau : le
personnage dans Via Crucis, roman
historique, de Paul Delamour,
propriétaire français descendant
direct d’un émigré de Saint
Domingue devise fréquemment avec
ses esclaves en « francés
criollo », le milieu du
siècle approchant. Bacardi, qui
s’est fait aussi historien de sa
province dans ses
« chroniques de Santiago de
Cuba » était bien placé pour
en connaître l’héritage
français : si son père était
de ces commerçants catalans qui
ont également contribué à
l’identité locale, sa mère, Lucia
Victoria Moreau était de la
communauté des Français (les
grands parents Moreau et Gogué
étaient originaire de Jérémie) et
il eut l’occasion d’amplifier ces
connaissances par les familles de
ces deux épouses successives,
elles mêmes apparentées et
appartenant à cette communauté
(Maria Lay Berlucheau puis Elvira
Cape Lombard, celle-ci née dans la
zone cafière de Ti Arriba et
apparentée à la première). Il
n’est pas si anecdotique qu’il a
écrit Via Crucis, une saga
familiale tragique de caficulteurs
d’Oriente, dans la caféière de son
beau-frère Armando Lay, La
Sympathie.
Dans ses chronique Bacardi relève que les esclaves de
cette communauté
s’auto-désignaient ainsi :
« Mué Fransé ». A cet
égard, il faut rappeler que cette
communauté n’était pas constituée
seulement des descendants des
réfugiés de Saint-Domingue,
considérés comme blancs, métis ou
Noirs, libres ou esclaves, ou des
ralliés de Louisiane. Les plus
nombreux des esclaves des
caféières vinrent directement
d’Afrique et la pratique du créole
dans les caféières fut un ciment
entre plusieurs composantes qui
comprenait à la fois la
domesticité esclave ou libre et
les esclaves de plantation, les
plus anciens se faisant vecteurs
de la transmission du créole des
nouveaux venus, en supplément des
commandements du contremaître et
du maître. Par ailleurs la
descendance illégitime n’y était
pas rare entre le maître et les
différentes catégories (ce qui
était en principe mal
considéré par les possédants
espagnols), élément propre à
renforcer un sentiment d'identité
particulière.
Emilio Bacardi cite ce chant satirique dans une fête
d’esclaves dans une
caféières :
Blan
la yo qui sorti en Frans, oh
jelé...!
Yo pren madam yo servi sorelle!...
Pu yo caresé neguès...!
(Ces blancs qui viennent
de France, il faut le dire!
Prennent leurs dames pour servir d'oreiller
Pour mieux caresser les
négresses...)
Ainsi certains héritiers actuel de la tradition créole
considèrent qu’ils ont des
ancêtres africains et français,
mais pas d’ancêtre haïtiens, ce
qui se réfère dans leur esprit
aussi bien à la population de
couleur de la colonie de
Saint-Domingue (les maîtres étant
considérés français, qu’ils soient
héritiers de Saint-Domingue ou
pas) que de l'immigration
haïtienne postérieure. Cela
ressort en particulier des
diverses interviews des deux
dernières présidentes et composés
de la société La
Caridad
de Oriente de Santiago de Cuba (famille Venet
Danger).
On pourra saisir l’importance du créole comme langue de
communication, « lengua
franca »,
à travers les éléments
analysés par Marial Iglesias Utset
sur la propriété La Lisse des
Despaigne : « A
la mort de Jean Despaigne en
1849, l’inventaire de ses biens
éclaire l’origine ethnique de
ses esclaves , parmi les 63
esclaves de sexe masculin de la
caféière La Lisse, 32 étaient
venus d’Afrique, une majorité
« congos »,
dénomination ethnique qui
désigne de manière générale une
culture d’origine batoue et une
provenance géographique
localisée dans l’estuaire du
fleuve Congo, mais aussi
« ibo » et Bibi
(ibibio), deux des ethnies de
l’arrière-pays de la baie du
Biafra, dans le delta du Niger.
Ainsi que, dans l’espace réduit
de La Lisse, coexistaient
diverses langues : le
français, langue des maîtres
européens, peut-être aussi le
castillan, nécessaire pour la
communication externe; les
langues venues d’Afrique parlées
par les esclaves de plantation,
probablement une langue bantoue
comme le kikongo, en commun avec
la langue ibo, l’ibibio ou
peut-être l’efik et pour
terminer une
langue hybride, le créole,
importé de Saint-Domingue,
était utilisée comme langue
franche dans la vie
quotidienne. Cette
extraordinaire polyphonie
linguistique dans les limites
d’une seule caféière permet de
toucher du doigt la matrice
complexe de l’intense processus
de mise en écho culturel qui
caractérisait l’expérience de
l’esclavage de plantation dans
les Caraïbes »
(notre traduction).[82]
A. Yacou regrettait que la « transplantation
réussi du créole de Saint-Domingue
dans l’un des plus vieux
territoires hispanophones de
l’Amérique » n’ait pas
intéressé les nombreux
spécialistes du créole de par le
monde.
Mais certaines études historiques du créole vont nous
permettre de situer la tentative
d’écriture des Daudinot.
Jusque récemment les traces écrites du créole de
Saint-Domingue les plus anciennes
étaient tenues pour être celles de
Moreau de Saint-Méry. Lui-même
s’auto-définissait comme créole.
En l’occurence né en Martinique et
en poste à Saint-Domingue :
sa citation de la chanson
« comme Lissette quitté la
plaine » (de Duvivier de La
Mahotière, 1757) est la mieux
repérée de ses transcriptions de
créole. Il s’agit de textes
courts, comme cette chanson.
Est autrement plus long le manuscrit religieux La
passion de Notre Seigneur selon
St Jean en Langage Nègre,
attribué à Pierre Boutin. Cette
découverte de la linguiste
Marie-Christine
Hazaël-Massieux lui permet
de repérer un créole déjà formé
dans la première moitié du 18e
siècle.
L’histoire postérieure d’Haïti pourrait faire oublier
que le créole a eu une première
existence officielle avant
l’indépendance de ce pays :
en 1793 il est utilisé comme
langue officielle dans les décrets
et proclamations des Commissaires
Civils Sonthonnax & Polverel
parallèlement au français.
En Martinique, c'est un commissaire de la marine,
François-Achille Marbot
(1817-1866), qui écrit les
premières fables créoles,
intitulées : Les
Bambous, fables de La Fontaine
travesties en patois créole par
un vieux commandeur, ce
recueil rassemble pas moins de
cinquante fables traduites en
créoles. Il aurait été publié vers
1826 dit Prudent (réédité en
1946).
Le premier utilisateur littéraire du créole pourrait
cependant être l’auteur anonyme d’Idylles
et
Chansons ou essais de Poésie
Créole par un Colon de
Saint-Domingue (1804),
signalé par Marie-Christine
Hazaël-Massieux mais dont ne
savons pas grand’chose.
Lambert Félix Prudent observe que
les premiers créateurs blancs de
chanson créoles au 18e
s. considèrent comme un thème
émouvant les amours esclaves. Ils
affectionnent les sujets mièvres
et de peu d’envergure. (Prudent.
1982).
Les frères Daudinot peuvent être situés dans cette
tradition, qu’ils aient eu
connaissance ou pas de précédents.
En ce qui concerne les archétypes,
c’est toutefois plus complexe que
dans la dernière citation, si on
veut aller au delà du malheureux
poème « Beauté Ibo »
d’Hippolyte. Leur créole contient
des marques du contexte où il est
écrit, plus au niveau géographique
qu’une peu présente imprégnation
de la langue espagnole. Il
acquiert des caractéristiques
propres, qui concernent à la fois
la transmission de la tradition
orale et l’écrit, d’autant plus
facilement qu’il ne semble pas
avoir de modèle d’écriture
antérieur évident. Dans
l’utilisation prolongée de ce
créole par la population noire, à
l’époque ou Hippolyte Daudinot
écrit, comme postérieurement, les
marques du contexte hispano-cubain
seront renforcées.
La littérature créole des autres îles ont continué une évolution, connu d’autres phases, alors que Hippolyte Daudinot témoigne d’un créole qui s’éteint au moment où il le transmet.
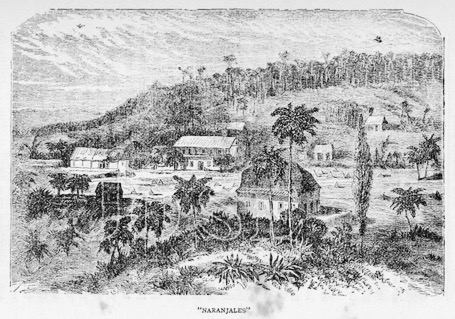
A Cuba, dès 1850 les guerres successives d’indépendance
mettent fin aux isolats des
Français des caféières, déjà
affaibli par
la concurrence
du café
brésilien,
puis se
terminant par la torche
incendiaire d’une lutte sans merci
entre les indépendantistes et les
Espagnols, la pratique de la terre
brûlée. Une partie des
propriétaires et intendants voient
venir la fin de leur monde, savent
que leur système, dont ils ne sont
pas forcément fiers mais dont ils
dépendent, est condamné. A la
suite de la fin de l’esclavage en
France en 1848 et la victoire
contre les Sudistes aux
Etats-Unis, certains rallient la
France à temps, vendant comme il
se peut esclaves et terres, en
s’appuyant sur leurs réseaux
métropolitains[83],
tandis que des Noirs et métis aux
noms de familles de maîtres
français ou quelquefois des fils
de propriétaires (Crombet,
Coureau, Lacret Morlot, Duboys,
Duverger Lafargue…) s’investissent
dans la lutte indépendantiste.[84]
Des dotations entières d’esclaves
libérés rejoignent les camps et
champs de bataille des
indépendantistes, les mambis.
Le créole et les
chants et danses qui le porte
furent ainsi utilisés à différents
moment de la lutte pour
l’indépendance cubaine. Quand
Carlos Manuel de Cespedes libère
ses esclaves à la Demajagua
(actuelle province de Granma)
ceux-ci font une grande fête de
tumba francesa ; des vieux
informateurs rapportent dans les
années ’70 qu’il y eut des danses
de Français dans le camp insurgé
de la Gran Piedra et que ce fut
aussi le cas d’autres de ces
camps. Un des premiers faits
d’armes de la première guerre
d’indépendance, en 1868, est la
prise de la ville d’El Cobre par
un Simon Despaigne, à coup sûr
parent des 664 esclaves, dénombrés
en 1866 sur les plantations de la
lignée de Jean et Pierre
Despaigne, réfugiés venus
autrefois de Jérémie et installés
à Cuba grâce à Casamayor (IGLESIAS
USTET. 2011). Cette auteure
ajoute : "Beaucoup
d’esclaves de la zone, libérés
par les troupes indépendantistes
étaient africains, ou fils ou
petit-fils d’Africains et
parlaient créoles
en lieu et place de
l’espagnol"[85].
L’entrée postérieure de Carlos
Manuel de Cespedes dans El Cobre
est ainsi décrite par l’historien
Antonio Pirala : « On procéda à l’alistement de ceux qui étaient libres de service, on
appela tous les Noirs de la
population, des mines[86] et des fermes, pour qu’ils se disposent aux accès, en recommandant aux
conremaïtres d’arborer des
drapeaux cubains et qu’à
l’arrivée du leader qu’ils
lancent des vivas à la
République, à Carlos Manuel et à
la Liberté ; on ordonna de
décorer les rues et de les
illuminer, et quand Cespédes
s’approcha, le gouverneur vint
l’accueillir avec son nombreux
personnel, tous à cheval, (…) et
au passage des files de soldats
et des Noirs , ces derniers
battirent des mains, lancèrent
des vivas étourdissants, agitant
les drapeaux et
il entonnérent leurs chants en
jargon français »[87]
Face à la destruction des plantations et l’abolition
cubaine, beaucoup d’ex-esclaves
les quittent pour le villes,
petites ou plus grandes : à
Bayamo, Santiago ou Guantanamo. Le
créole devient un signe de
ralliement et reconnaissance de
libres et anciens esclaves qui se
constituent en associations où cet
héritage culturel survit dans les
tahonas et tumbas francesas, en
proximité avec les anciens
cabildos congos et carabalis. Dans
le cas cas de Bejuco, des esclaves
enfuis d’une plantation au moment
de la lutte indépendantiste, mais
restés isolés en montagne,
fonderont une tradition rurale de
tumba francesa parvenue jusqu’à
nous.
Boytel Jambú (Palmarito del Cauto, 1914), de
descendance française locale,
s'est livré à des recherches sur
une soixantaine des ruines des
propriétés française et nous a
livré un lexique tenant sur 21
pages du vocabulaire du
« patois cubain »,
classé à partir de la traduction
espagnole et contenant aussi la
traduction française. Selon ses
dires, c’est un travail qu’il
avait commencé dès sa jeunesse, au
contact avec la population rurale
concernée, bien avant de
participer à la transformation de
la cafetal La Isabelica de la Gran
Piedra en musée. Il n’a pas daté
lui même son manuscrit. On sent
chez lui une tentative de
sauvegarde de la mémoire d’une
tradition menacée de disparition,
d’autant relève-t-il que cette
langue « sans
écriture », dans cette
nouvelle donne d’après abolition
et indépendance a contre elle
« d’être considérée comme
langue d’esclave » :
distance entre le regard et le
réalité. Mais les locuteurs du
côté des maîtres, avec leur
pouvoir organisateur de cette
pratique, avaient disparu du
paysage…
Au bout de deux générations après le fracas de ce
système, dit F. Boytel Jambú dans
le manuscrit publié par I.
Martínez Gordo, il n’y avait
pratiquement personne pour parler
le « Patois cubain ».
Néanmoins un informateur de I. Martinez Gordo, nommé
Duvergel signale encore vers 1980,
la superposition dans la région de
Guantanamo de deux formes
linguistiques toute deux appelées
patois : le patois haïtien
des travailleurs agricoles
immigrés et leurs descendants
d'une part et le « patois
cubain » d'autre part.
Ce patois cubain nous a été transmis sous une forme
résiduelle par la tradition de la
tumba francesa. Exclusivement
orale au départ, l’accès à la
scolarité sous la république
naissante cubaine des populations
noires et métisses concernées a
entraîné le phénomène des cahiers
(libretas)
consignant les chants des
composés, soit leur propre
création, soit des chants
antérieurs. Tant qu’a survécu la
tradition de joutes de composés
masculins, reposant sur
l’improvisation, au départ très
importante, ces libretas
ne pouvaient d’ailleurs
constituer qu’une minorité de la
performance de ces chants.
Les thèses successives d’Elisa Tamamés et Olavo Alén
ont permis à certains de ces
textes des libretas
d’accéder à la publication
académique et à l’édition dans le
dernier cas (1986).
La thèse des années ‘50 d’Elisa Tamamés donne une
répartition des anciennes sociétés
de tumba francesa et permet de se
faire une idée de l’extension de
l’usage du « patois
cubain » à travers celles
ci : elle « tente de
recenser les sociétés et
groupement qui se réunissaient
dans des fêtes de tumbas francesa,
sont cités 47 foyers de cette
activités : 24 à Santiago de
Cuba et autour (dont les
municipios actuels El Caney, Songo
La Maya, Dos Palmas, El Cobre, San
Luis, El Cauto etc), 17 à
Guantanamo et autour (5 dans la
ville de Guantanamo, 7 à Yateras,
2 à Jamaica, une dans le central
San Antonio, une à La Sidra, une à
Sempré), avec même un groupement
dans la province de La Villas et
un autre à La Havane. Pour s'en
tenir à la capitale de l'ancienne
province d'Oriente, Santiago avait
la société El Cocoyé, La Caridad
(les deux dans le quartier de Los
Hoyos),
le Tivoli, Los Papiantes,
Le Tiveré… La liste de E. Tamamés
n'est en fait pas exhaustive
puisque d'autres sources citent
par exemple les centrales
sucrières La Esperanza ou Cecilia
(actuelle province de
Guantanamo) » (CHATELAIN ET
MIRABEAU. 2017). Il faudrait aussi
considérer de ce point de vue la
tumba rurale de Bejuco (actuelle
province d’Holguín), longtemps
ignorée, mais aussi les tahonas
urbaines liées au carnaval de
Santiago préalables aux congas de
défilé actuelles (quartiers du
Tivoli et de Los Hoyos…) et les
anciennes tahonas rurales comme
celle d’El Caney, qui ont laissées
fort peu de traces (contrairement
à la tahona de Songo-La Maya qui a
perduré).
Nous avons déjà eu l’occasion de signaler que la
répression meurtrière de la
révolte des Indépendants de
couleur de 1912 d’Ivonet et
Estenoz, leaders et vétérans aux
noms caractéristiques, avait
particulièrement décimé les
populations liées aux tumbas
francesas et tahonas des petites
villes de cette province et
entravé leur dynamique (op. cit.).
La linguiste et analyste du manuscrit de Boytel Jambú
(conservé dans la caféière La
Isabelica devenu musée), Isabel
Martínez Gordo, a signalé avoir eu
accès, à l’académie des Sciences
de Cuba, autour de 1980, à quatre
libretas
de composés qui dateraient, si
nous la comprenons bien, du 19e
siècle. Ce serait, sous réserve de
confirmation de la datation et par
rapport aux Daudinot, le seul
autre élément répertorié d’une
écriture directe par un
créolophone de cette forme
linguistique de ce siècle.
Très nombreuses sont les libretas qui ont disparues, souvent à la suite de l’extinction des
sociétés et des composés
concernés, y compris par
conséquence des intempéries :
dans un cas que nous connaissons
de la société El Cocoyé au cours
de déménagements successifs et des
conséquences des pluies
cycloniques…
Après la révolution cubaine, les deux sociétés urbaines
survivantes ont été confrontées à
un vieillissement marqué de leurs
participants. Un remède utilisé
dans le cas de la société de
Guantanamó, a été un moment le
recours à des cours de
« patois » pour mieux
intégrer culturellement des
membres plus jeunes (cf ALÉN.
1986). Cette même société a eu la
particularité d’être en contact de
voisinage avec des créolophones
d’origine haïtienne.
Le corpus actuel des chants de tumba francesa que nous
avons étudié par enquête de
terrain, reposant le plus souvent
sur des libretas,
est une faible partie de ce qui a
pu exister (CHATELAIN &
MIRABEAU. 2017). Nous y avons
réunis soixante quinze chants
créés ou recueillis dans les trois
sociétés subsistantes, sans avoir
essayé pour autant reprendre
systématiquement les chants
publiés dans des travaux
antérieurs (O. Alén a pour sa part
transcrit une dizaine de chants,
neuf en créole et un alternant
espagnol et créole, provenant de
ses enquêtes de terrain entre 1974
et 1978). On constate dans ce
corpus que la proportion de la
langue espagnole est de plus en
plus prégnante au fil de temps.
Pour en revenir aux caféières, les filières
d’immigration que nous avons
constatées concernant spécialement
les Béarnais, n’ont pas totalement
disparu après l’esclavage et
l’indépendance cubaine. Nous avons
rencontré en 1989 le dernier
couple de planteurs français de
Cuba, comme par hasard issus du
même canton que… Casamayor près de
deux siècles après, très
précisément de l'historique canton
de Sauveterre de Béarn. Ces
Bénégui (il y aurait eu deux
autres branches locales de cette
famille), occupaient une caféière
dans les hauteurs de Yateras,
comme d’autres Français avant eux
au XIXe s. et comme
l’avaient fait avant eux le père
de René Bénégui[88]
et son mentor Pierre Belón[89].
Il n’est pas indifférent qu’avant
les années ’50 du XXe
siècle, selon le témoignage de
René Bénégui, la langue de travail
de cette caféière, L’Ermitaño,
était le créole. Mais il
s’agissait cette fois de
travailleurs salariés et ce créole
était celui des Haïtiens venus
louer leurs bras, certains entre
deux récoltes de canne à sucre
dans la plaine. Dans les années
’50, René Bénégui reconstruisit à
l’Ermitaño une maison moderne,
mais avec des caractéristiques
françaises et de sa région, se
démarquant des architectures
locales, comme avant lui les
bâtisseurs de caféières cent ou
cent cinquante ans avant lui.
Du temps de l’oncle
et du père Bénégui, au début du XXe
siècle, il y avait encore un agent
consulaire français à Guantanamo,
un agriculteur qui répondait à la
condition nécessaire d’une
certaine fortune pour cette
fonction, et gérait les liens avec
la mère-patrie auprès des autres
français et descendants, en
général issus de l’économie
caféière. Cet officier français,
Félix Bégué, avait une relation
assez puissante avec la France et
la communauté des descendants pour
que ce lien se transmette à ses
filles (issues d’un mariage avec
une dame Bellon) alors qu’elles
n’avaient que quatre et six ans à
la mort du père et qu’elles
n’avaient pas eu accès à un
enseignement de sa langue. A tel
point que les filles Bégué Bellon
organisèrent à Guantanamo un
réseau local d’aide à la France
Libre, grâce aux liens créés avec
les descendants français par le
père, réseau consistant à coudre
et envoyer à Londres des uniformes
et autres vêtements, et obtinrent
reconnaissance du Comité de
soutien cubain à la France Libre
pour ces faits après la seconde
guerre mondiale (cf article de D.
Chatelain
Fragments
mémoriels sur les descendants
des planteurs français à Cuba.).
Daniel Chatelain, juillet 2020 (Dernière
révision 24/10/2021)
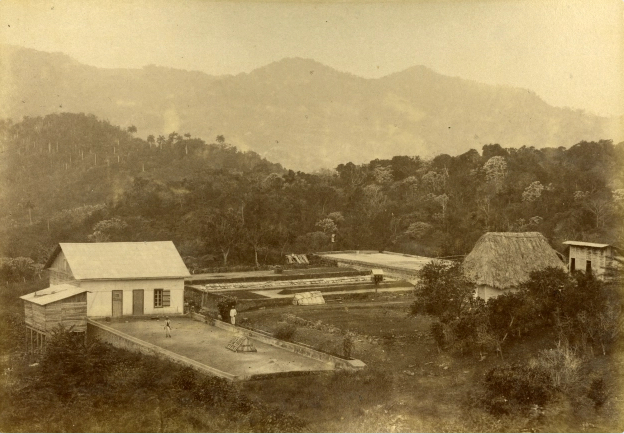
N.
B. :
- mention E. : espagnol
- mention H. : orthographe créole haïtien actuel
- mention F.B.J. : orthographe employée dans le lexique de Fernando Boytel Jambú in « Ensayo patois cubain ».
- mention Fr : français
- mention T.F. : tumba francesa
Agnén :
rien (E. nada). Anyen (orthographe
créole haïtien actuel)
Banza. Cordophone créole de quatre
cordes connu dans la colonie de
Saint-Domingue Martinique et la
Louisiane (anciennement). Comparé
à la lyre des poètes dans ce
manuscrit. C’est à notre
connaissance la première fois
qu’il est signalé à Cuba. Proche
de la viola connue dans l’Ouest de
Cuba (utilisée sans cordes dans
les coros
de clave). Le nom est
l’instrument ont un lien avec la
création du banjo. (voir le
développement à ce sujet). Voir
3.3 et illustration.
Bamboula. (polysémique, ici tambour).
Un texte de Moreau de Saint Méry
(Description l'île de Saint
Domingue, 1796) nous parle de la
danse calenda, «
accompagnée de deux tambours de
bois creux recouverts d'une peau
de mouton ou de chèvre. Le plus
court porte le nom de bamboula
(…) Sur chaque tambour un nègre en
califourchon qui le frappe du
poignet et des doigts, mias avec
lenteur sur l'un et rapidement sur
l'autre ».
Baboul. Danse
spécifique.
Béf
(F.B.J. : id.). Taureau,
bœuf. Bèf (H.)
Bundá
(F.B.J. : id). Figure ainsi
dans le texte original :
« b___á ». Cul, fesses.
Bounda (H.), m’bunda
(afro-brésilien), origine bantou.
Bondié, bonghié.
Bon Dieu. H. : Bondye
Bouér. Boire
Bouqui. Bouc.
Il est à noter que le nom Bouki a
survécu par les contes haïtiens.
Par contre, on ne l'utilise plus
pour désigner un bouc. Dans le
champ sémantique du vodou, on
utilisera volontiers le mot bèlye.
Cabrite.
Chèvre. Kabrit (H.)
Calabali.
Carabali (esp.), terme
méta-ethnique se référant à la
Côte des Calabars.
Calalou. Plat
en sauce. Puerto Rico : calalú.
Haïti : kalalou
.
En créole : à la fois le
gombo, légume (hibiscus
esculentus) et le plat qui
le contient.
En fongbe :
idem que créole.
En ewe :
sauce, ou plat en sauce par
extension.
Calenda. Danse
spécifique, décrite dans la
colonie de Saint-Domingue. Kalenda
(H).
Charré. Chare
(H.). Origine en français :
attacher à un char ou une
charrette.
Chica zombi.
Danse vodou.
Chien marron.
Chien sauvage, employé comme un
équivalent du loup vis-à-vis des
enfants.
Choual. Chwal
(H.). Cheval
Cochon marron.
Sanglier (en fait porc retourné à
l’état sauvage). L’équivalent
hispanique est cimarrón, employé par extension pour les esclaves fugitifs.
Chacha.
Idiophone secoué (hochet). Dans la
tumba francesa : chachá.
H. : Tchatcha.
Cribich’. (F.
B. J. : Cribich). Kribich
(H.) Ecrevisse.
Frète. Frais,
froid. Semble correspondre à un
prononciation française ancienne
(présent au Québec)
Fronter. Affronter. Forme nominale dans la T.F. : fronté (origine de la danse): joute entre le danseur et le tamborinaire à cheval sur son instrument, devenu habituellement aujourd’hui frente, prononcé selon les critères du castillan)
Gnoum. Pas de mot équivalent en créole moderne; nous le prenons comme une contraction de "ke moun" (H.) : que les gens.
Gombos. Esp.
Quibombo. Légume tropical. Cf
calalou.
Grosse Roche :
Gran Piedra (toponyme), point
culminant à l’Est de la ville de
Santiago. Gwo Wòch (H.)
Grag’ment / Gragement.
H. : grajman. Danse
. Autres formes : grayement,
grayé, grayimá. Origine
domingoise. Antécédent du masón
(source : Elisa Tamamés). La
grage est à cette époque un
appareil servant à ôter l’écorce
des grains de café. Cf « mon
frère qui est ici pour changer la
plaque de la grage »
(correspondance inédite de Jules
Raoulx, 1850). La grage connue
aujourd’hui est une râpe à manioc
ou tayo, taro (malanga en
español). Mais c’est le grand
gragement de la plantation qui a
donné son nom à une danse
disparue, grayimá, fusionnée au
yuba de la tumba francesa.
Guanabaco :
poignard. (dans Barbe bleue)
Gname :
igname. Esp. : ñame
Hélé, jele : pleurer
/ geindre / appeler).
H. : jele. Signification
proche de l'anglais "to wail" (ex.
: The Wailers en jamaïque)
Joupa :
cabane, paillote, abri léger
(attesté en Guadeloupe et Haïti)
Kikribou. Il
est mort. Variante de
« Quiquiribu », issu
d’une langue africaine (ex.,
l’expression « Quiquiribu
mandinga », présente dans le
son
Cubain « La Negra
Tomasa » : « il est
mort le mandingue »).
Lamer. Lanmè
(H.). La mer
Li. Lui ou Elle
Li yo. Les
Mambo. Sorcier,
dans le texte, associé à la
vieillesse. H. : Manbo
(précision : en haïtien
moderne désigne l'occurrence
féminine uniquement : une
prêtresse du vaudou ;
l'occurence masculine est hougan.
Manchette.
(F.B.J. : machet). Esp.
Machete (mot ancien en castillan).
H : machèt
Mapou.
(F.B.J. : mapú
« cotonnier »). Arbre à
pain, fromager ou gommier (ceiba
pentadra).
Marron (F.B.J. :
marón), esp. cimarrón (intégré
dans le créole de Saint-Domingue
dès sa formation). Sauvage
(animal), fugitif (esclave)
Mazone. Danse
spécifique. Orthographe
dominguoise. Masón dans la T. F.
Mitan.
Ici : moitié,
également : milieu
Mon.
Je, moi. Les Daudinot
utilisent parfois mon ou
mouin, sans marquer de
différence probante.
Mordé. mordre
Mouin. Mwen
(H.). Moi, je
Morne.
(F.B.J. : morn). Montagne,
colline, tertre
Mouché.
H. : monchè. « Mon
cher ». par extension
Monsieur
Moune. Un, une
(pour un être vivant).
Nachon.
H. : Nanchon. Nation.
Ouanga. (F. B.
J : Uangá). H. : Wanga,
mais anciennement ouanga .
Sorcellerie ou artefact pour jeter
les sorts. « Wanga
negès » : colibri (
litt.
« colibri-chérie » ;
le double mot vient du fait que
les sorciers se servaient de la
chair du colibri dans la
préparation du philtre d'amour).
Pagnols.
Espagnols
Pli. H. :
Lapli. La pluie.
Pipirit. Pipiri
(H.). Nom vulgaire du tyranneau,
oiseau des Antilles. Nom donné par
onomatopée caractérisant son chant
Piti. H. :
pitit. Petit.
Sen, lesen
(F.B.J. : id. ). H. :
Lèsen. Saint
Tendé. Ecouter,
entendre. Tande (H.)
Sué (F.B.J. :
id.). Suer
Tichien.
H. : ti chyen. Petit chien,
chiot
Tom tom. Purée
de féculent, banane plantain par
exemple, propre à compléter un
plat en sauce. Le terme
correspondant dans l’espagnol de
Cuba est fufú
(origine africaine) .
‘Tricité.
Electricité[90]
Yo. Ils, elles
Zagoutis.
agouti (Fr.,du tupi guarani),
Cuba : jutia, mammifère rongeur fructivore ) d'une taille entre lapin
et écureuil, endogène.
Z’animaux.
Animaux
Z’éperon
(F.B.J. : zeprón). Éperon
Z’étoile
(F.B.J : zetual). H. :
zetwal. FR : Étoile
Zicak :
une interjection
Z’oreill’.
Zorey (H.) les oreilles
Zombi. Repris
en français du créole de
Saint-Domingue / Haïti avec le
même sens.
Z’os. H. : Zo.
Les os

Jardin de caféière. Photo Ko Hon Chiu Vincent, UNESCO.
Sur
les accents dans le
manuscrit : indistinction
accents aigus accents graves sur
les a ; quand
apparaît un accent sur un e, on
lit en général l’accent aigu,
donc le son « é »,
tandis qu’apparaissent quelques
notations « ê », la
notation « è » est
curieusement inexistante dans
les textes en créole (alors
qu’elle existe dans le créole
haïtien moderne), tandis que
l’auteur la fait apparaître dans
la dédicace en français
(ex. : frère). La
prédominance quasi absolue du
son « é », fermé, para
rapport à un son ouvert (« è »)
serait, selon cette observation,
une caractéristique de ce
créole, en contraste avec
l’usage français.
Des difficulté de lecture sont constatées : possibilité de confusion « m » et « n », « n » et « u », hésitation fréquente entre lire « mon » et « nou ».
- Une exergue commence le manuscrit : citation en latin de Virgile (non déchiffrée).
- les tirets dans un mot signalent les syllabes non déchiffrées.
N. B. : pagination du manuscrit
original et non de la transcription.
- Pièces de « P. D. » (Prudent Daudinot)
Corneille avec Renard
p. 1
Crapaud avec taureau
p. 2
Mulet qui vanté famille li
p. 5
Lapin avec crapaud
p. 6
Youn chien marron et youn mouton p.
8
Bouton rose
p. 10
Non, ça pas belle
p. 11
Désespoir
p. 11
Chagrin
p. 12
C’est ouanga !
p. 13
Elégie
p. 14
- Pièces de « H. E. D. »
(Hippolyte E. Daudinot)
Dédicace (« à Madame Vve Jules Raoulx »)
I
Préface (Piti causement)
II à VIII
Blancs Dada et langue créole
p. 1
Vini n’en Palène
p. 3
Soleil l’amour
p. 5
Misèr gâté Vaillant
p.
11 (peu lisible)
Beauté Ibo p.
14
Compèr Malice et compèr Bouqui
p. 17
Macaque conné parlé
p. 26
Vapeur, ‘tricité et femme
p. 27
Mouché Barbe bleu
p. 29
La Reine fleurs
p. 42
Piti Breton tête dur
p. 45
« Non » femmes, souvent c’é « oui »
p. 50
C’é Zombi
p. 52
Bibliographie
Olavo Alén, dir. Instrumentos de la música folklórico-popular de Cuba. 2 t. CIDMUC. La Havane. 1997.
Pierre
Anglade, Inventaire
étymologique des termes
créoles des Caraïbes d'origine
africaine, L'Harmattan.
Paris.1998.
Emilio
Bacardí Moreau. Crónicas de
Santiago de Cuba.
Banjology Project, Laurent
Dubois, David Garner, and Mary
Caton Lingold, « The
Haitian Banza » Duke
university. https://leflambeau-foundation.org/2013/09/the-haitian-banza/
Banjology
(Site). https://sites.duke.edu/banjology/
Nathalie
Belrose. Les
Colonies
Françaises de
Cuba
(1887-1914).
Master II de
Recherche. 2012.
Benjamin Henry Boneval Latrobe, Impressions Respecting New Orleans, Diary and Sketches, 1818-1820. New York: Columbia University Press, 1951.
Bulletin
Généalogie et
Histoire de la
Caraïbe.
Fernando
Boytel Jambú « Ensayo
Patois cubain », reproduit
in Isabel Martínez Gordo Algunas
consideraciones sobre Patois
cubain de F. Boytel Jambú. Ed.
Academia, La Havane.1989.
Jacques
de Cauna. http://jdecauna.over-blog.com
Jacques
de Cauna. Des
Pyrénées à la Sierra
Maestra : aux origines du
modèle caféier cubain,
Casamajor et les Béarnais dans
l’Oriente. https://books.openedition.org/cths/5727?lang=fr
Jacques
de Cauna.
Prudent de
Casamajor et
sa famille.
Revue Partir,
Archives et
mémoires de
l'émigration
pyrénéenne,
N°15. AME,
Pau. Mars
2017.
José Cuenca "Nengón & Changüí ", site Ritmacuba.
Daniel
Chatelain. La
tumba francesa. Revue
Percussions, 1996 : http://www.ritmacuba.com/La-tumba-francesa-D_Chatelain.pdf
Daniel
Chatelain Du « petit français »
fils d’esclave et de colon, le
général indépendantiste Flor
Crombet...à son petit fils, Romulo
Lachatañere, pionnier des études
afro-cubaines http://www.ritmacuba.com/De%20Flor%20Crombet%20a%CC%80%20Romulo%20Lachatan%CC%83ere.html
Daniel
Chatelain & Daniel
Mirabeau : Les
chants de tumba francesa, les
différentes facettes sensibles
d'une tradition communautaire
cubaine, 126 p. http://www.ritmacuba.com/Chants-de-tumba-francesa.html
Adriana
Chira. Uneasy
Intimacies : Race,
Family, and Property in
Santiago de Cuba, 1803-1868,
thèse de doctorat, Michigan
University. https://pdfs.semanticscholar.org/ae07/dfa8c95e0398b1caa1c73347fdfdee8a69c1.pdf?_ga=2.202820881.1220818707.1588714080-1787267154.1588714080
Laura
Cruz Ríos. Flujos inmigratorios
francese a Santiago de Cuba
(1800-1868). Ed. Oriente, Santiago
de Cuba. 2006)
Laurent
Dubois. The
banjo. Harvard
University Press. 2016.
Rafael
Duharte :
"L'influence de la
Révolution Française
dans la région
orientale de Cuba"
(1789-1896) in Esclavage,
colonisation,
libérations
nationales.
Ed. L'Harmattan,
Paris 1990.
Samuel Hazard : Cuba with pen and pencil, d'après l'édition en espagnol Cuba a pluma y lapiz. T 1 & 3. La Habana, 1928.
Marial Iglesias Utset. Los Despaigne en Saint-Domingue y Cuba: narrativa microhistórica de una
experiencia
atlántica.
Revista de Indias,
2011, vol. LXXI, núm.
251 p. 77-108.
Lambert Félix Prudent. « L'émergence d'une
littérature créole aux
Antilles et en
Guyane ».
Présence Africaine.
Nouvelle série, No.
121/122, Présence
antillaise: Guadeloupe
- Guyane Martinique
(1er et 2e trimestres
1982),
Hugues de Lestapis
« Daudinot,
un Arthézien aux
Amériques » http://jdecauna.over-blog.com/2020/01/daudinot-d-arthez-de-bearn-a-cuba.html
Hugues de Lestapis : communications personnelles.
Santiago
Moreaux Jardines "Notes
sur le Changüí -
Le Roi du XXIe
siècle"
Fernando Ortiz, Los
instrumentos de la
música afrocubana,
5 t., La Havane
1952-55.
Jean Price Mars, Ainsi
parla l'oncle.
Port-au-Prince.
Agnès Renault. D’une île rebelle à une île fidèle, Les Français de Santiago de Cuba (1791-1825). PURH. Le Havre-Rouen. 2012.
Agnès Renault : communications personnelles
Richard
de Tussac, Cri
Des Colons,
Contre Un
Ouvrage De M.
L’Evêque Et
Sénateur
Grégoire. Paris.
Les Marchands
de Nouveautés,
1810
Hernan Venegas Delgado. « Cafetales y vida
criolla: la familia
Heredia-Girard en el
oriente
cubano ».
Revista Catauro n°
28. La Havane.
Alain Yacou « Destinées des parler nègres à
Cuba » in
Langues et cultures
en Amérique
espagnole coloniale
: colloque
international
Joseph Prophète, Dictionnaire Français / Haïtien, éd. Konbit, Port au Prince, Haïti. 1999.
Dictionnaire
guadeloupéen en
ligne :
Wabap.com
[1] Nous pensons que le mot a été oublié dans l’original et l’avons rétabli.
[2]
Mot
non
reconnu :
moin
--( ?) :
moin
sormé ?
soroné ?
[3]
Cette phrase ne figure pas dans la poésie de La Fontaine. Daudinot la
rajoute ici à
des fins
explicatives,
le renard
étant inconnu
sur les terres
caribéennes
[4]
Le fromager est un arbre de la Caraïbe. Daudinot
rapproche ici
fromager et
fromage à des
fins comiques
[5]
Oiseau caribéen de la famille des tyrannidés. Réputé
chanter au
lever du jour
[6]
Le créole moderne préfère l'utilisation de l'angliscisme peni (penny) pour
désigner
la petite
monnaie
[7]
Un créole plus moderne préfèrerait: Nan moman sa a nan lagè a....
[8] Guerre qui oppose Toussaint-Louverture et Rigaud.
François-Dominique
Toussaint
Louverture,
à l'origine Toussaint
de Bréda,
(vers
1743-1803, est
un général
français
né à
Saint-Domingue.
Descendant
d'esclaves
noirs,
lui-même
affranchi, il
joue un rôle
historique de
premier plan
en tant que
chef de la
Révolution
haïtienne
(1791-1802).
André Rigaud (1761-1811), est un général français ayant
participé à la
révolution
haïtienne, et
chef du parti
mulâtre opposé
à Toussaint
Louverture. Il
devient
éphémère chef
de l'État du
sud, après
l'indépendance
d'Haïti.
En juin 1799, Toussaint entre en guerre contre Rigaud.
C'est la
guerre des
Couteaux ou
« guerre
du Sud »,
vue comme un
conflit entre
la
« caste »
des Noirs
(représentés
par Toussaint)
et la
« caste »
des Mulâtres
(terme qui
désignent les
métis,
représentés
par Rigaud).
Le conflit
entre les deux
hommes n’est
pourtant pas
une question
de couleur,
mais une
véritable
lutte pour le
pouvoir et le
contrôle du
territoire. De
lourdes pertes
sont infligées
aux mulâtres
du Sud ;
en juillet
1800 Toussaint
sort
vainqueur.
[9]
Au sens de docile
[10] Prêtre ou prêtresse vodou. Acception du XIXe s. Mot de racine
congo. Les lwa
kanga
sont associés
à la guérison
et au rite
kaplaw. Le
mot kapoulata
est de cette
racine congo
de
« guérisseur ».
Un proverbe
dit : Le
kapoulata te
donne ses
sorts, mais il
ne te demande
pas de maudire
Dieu.
[11] Dans la version originale, l'auteur préfère le mot français
« voeu »
plutôt que
souhait (swè).
Il n'y a pas
d'équivalent
homophonique à
« vœu »
en créole
haïtien
moderne
[12] Adieu ne s’utilise pas en créole à notre connaissance, ou alors avec une
référence
religieuse (à
Dieu, a
Dye). Le
premier vers
est du
français.
[13] Naïade grecque capable
de donner
l'inspiration
poétique à
celui qui
buvait de ses
eaux ou
écoutait son
murmure
tranquille.
[14] La montagne où vivent les muses.
[15] Peut être allusion au poème de José Maria de Heredia sur les conquistadors
comparés à des
grands
rapaces, les
gerfauts. Les
Heredia sont
une famille de
conquistadors
installé
primitivement
dans la partie
espagnole de
l’île
Hispaniola /
Haïti.
[16] Sancho Pança le fidèle serviteur de Don Quichotte (Panza en espagnol,
« panse »).
[17] Au sens « je m'en tiens aux chansons créoles ». H. Sanba : chanteur
soliste
d'une
cérémonie
vodou.
[18] Dans le sens de vieux
sorcier. Dans
le vaudou
actuel, ce
serait hougan
au masculin, manbo,
étant utilisé
uniquement au
féminin
[19] Au sens littéral en français,
« tenir
sous le
joug ».
Concernant un
chien, le
tenir en
laisse ou avec
une muselière.
[20] Forme créole propre au XIXe s.,
contraction :
« comme
moun »
(comme à un).
[21] L'accent est inversé en créole moderne « lè » (l'heure).
[22] H. : Chèlbè : élégant. Le prendre ici au sens de « Mes
beaux
Messieurs »
[23] L’humour grinçant sur les
académiciens
est sur le fil
si on
considère que
les femmes
première
lectrices du
texte sont
proches
parentes de
l’académicien
José Maria de
Heredia.
[24] Ya : Barbarisme castillan a sens de déjà, désormais
[25] Dérivé de fandanman H. (fondement): qui dégage une odeur
terreuse, par
extension qui
sent le caca.
[26] Allusion amusée à Pégase.
[27] Bien qu’il n’y ait pas de majuscule dans l’original, doit correspondre au
Pic Mogote,
deuxième
montagne pour
l’altitude de
cette partie
de la Sierra
Maestra, après
la Gran
Piedra,
légèrement
plus haut que
le pic
Kentucky, venu
du nom d’une
caféière
fondée par des
propriétaires
de la grande
Louisiane.
[28] Peut-être un jeu de mot avec le Mont Taurus / Taureau, hauteur de
Guantanamo où
les Français,
y compris des
familles
alliées de
l’auteur, ont
créé des
plantations
(actuellement
Monte Rus,
Municipio El
Salvador) ;
cf partie
finale.
[29] Analogue au zékric, zékrac des contes antillais entre le locuteur et la
réponse
instantanée de
l’assistance.
Voir aussi
Louis Moreau
Gottschalk,
avec deux
réactions
successives :
« tim
tim »…
« Bois
cassé »… « tchou
macaque »
(lettre à M.
Escudier,
1857).
[30] Le mot « composé » est resté dans la tradition de tumba
francesa, à la
fois comme
auteur et
compositeur.
Signature en
enluminure.
[31] Fait peut-être référence à
« L'art
poétique »
de Nicolas
Boileau,
traité de
1674. H.
Daudinot cite
plusieurs fois
ce poète dans
le manuscrit.
[32] L’auteur s’amuse à feindre l’ignorance du mot savant qu’il connaît
parfaitement :
l’hémicycle.
[33] Plat à base de gombo ou
quimbombo
(voir
lexique).
[34] Le tom tom est une purée de féculent,
banane
plantain par
exemple,
propre à
compléter la
sauce. Le
terme
correspondant,
d’origine
africaine,
dans
l’espagnol de
Cuba est fufú.
Refrain
[36] Le commerce local était le plus souvent l’apanage des Catalans.
[37]
Instrumentos de la música folklórico-popular de Cuba. CIDMUC. La Havane. 1997.
[38] Au sens premier : bigleux (Veron : vairons). Sous-entend
ici
l’ignorance.
[39] Version hispanique : carabali, de la côte des Calabars. Calqué sur
l’expression
courante à
Cuba « El
que
no tiene de
congo tiene de
carabalí ». Littéralement « celui qui ne descend pas d’un Congo
descend d’un
Carabali »
pour exprimer
que
l’ascendance
africaine est
ce qui est le
mieux partagé.
[40] « F » suivi d’un trait, le mot « incorrect »
fouti
est
plusieurs fois
écrit ainsi de
manière non
explicite, à
dessein.
[41] Lieu de regroupement autonome
d’esclaves
fugitifs.
[42] To : Tôt ou déjà. Ou tort.
[43] écrevisses (attesté dans le créole haïtien).
[44] L'acception créole serait mare (marrer), même sous forme ancienne. L'auteur préfère un mot de français, comme c'est aussi le cas en « patuá » dans les chants de tumba francesa
[48] Chanteur soliste dans la tradition créole des musiques populaires
[49] Traduction littérale : Mon bon gars.
[50] Filleul, au sens littéral
[51] La version contemporaine et toujours employée de ce proverbe : Pitit
mouri, kòmè
kaba »
[52] Le texte oppose les demeures des blancs aux barraques d’esclaves.
[53] Litt. D'homme. Dans la phrase: bel dom bou: beau brin de fille
[54] En vieux français: giraumont. Aux Antilles, désigne encore l'espèce de
courge la plus
couramment
cultivée (cucurbita
moschata)
[55] Barbarisme castillan: pues (donc)
[56] Barbarisme castillan: avec
[57] Barbarisme castillan de Cuba: type de coquillage marin, utilisé à des fins
décoratives ou
dans les
artefacts
religieux
[58] Mot peu lisible, pouvant prêter à erreur de lecture et de signification
non reconnue.
[59]
Ecrit « b-da »
par pudeur. Cul, derrière. Une charade haïtienne: Le bounda kote
fache i chita?
A tè! Où
est ce qu'un
derrière se
met quand il a
faim ? A
terre!
[60] Arbre à pain, fromager
[61] Autre possibilité: pòtray; sens plus éloigné en créole moderne
(poitrail)
[62] Litt. "son regard ne peut étancher ma soif"
[63] Structures géomorphiques caribéennes en forme de dôme, présentes à Cuba
dans la vallée
de Viñales.
[64] Danse vodou du XIXe s. Le chica est déjà décrit dans
l'ouvrage du
père Labat (Voyage
aux Isles,
Chronique
aventureuse
des Caraïbes
1693-1705,
J.-B. Labat)
[65] La grammaire créole ne précise pas le genre entre "ils" ou "elles".
L'ensemble
du recueil
s'adressant à
la gente
féminine de
son entourage,
le genre est
supposé ici
féminin.
[66] Lettre à M. Escudier de la France Musicale
http://www.gottschalk.fr/Ecrits/LettrePortoRico.pdf
[67] Réponse du père
[68] Il doit s'agir d'un cataplasme de plantes pour faire baisser la fièvre
[69] Mais il semble exister un lien de cette famille avec les îles Caraïbes
plus ancien
que
l’installation
à Cuba
d’Anfré-Pierre,
car est
mentionné un
Israël
Daudinot,
négociant à St
Pierre
(Martinique)
en 1759. Il
est né vers
1700 « à
Orthez »
(signalons que
les sources
confondent
parfois les
deux localités
proches Orthez
et, la moins
connue,
Arthez), marié
en 1733 en
Martinique.
[70]
Ayant
un quart de
sang Noir. Le
degré de
métissage
induisait des
lois et des
droits de
successions
différenciés
[71] Monte Rus est à notre avis
une corruption
par les locaux
de Monte
Taurus, nom
donné par les
lettrés venus
sur ces terres
jusque là peu
occupées. Ces
noms, sur
lesquels il y
a une certaine
confusion,
sont surtout
mentionnés à
Cuba pour être
parmi le
théâtre des
premiers
affrontements
de la guerre
d’indépendance
et des
premières
mises à feu
des caféières.
D’ailleurs le
premier
théâtre des
faits d’armes
d’un fils de
planteur
français et
d’une esclave,
Francisco
« Flor »
Crombet (cf
page du site
Ritmacuba sur
Flor Crombet).
[72]
Ces faits
figurent dans
les Chroniques
de Santiago de
Cuba d’Emilio
Bacardi Moreau
pour les
années 1868,
1869 et 1870.
[73] « d’une famille arthézienne parente
de Casamajor,
Hippolyte
Daudinot, qui
se suicida (…)
à 70 ans,
en 1894, en
son domicile
de la rue du
Palais-Gallien
à
Bordeaux. » Jacques de Cauna
[74]
On relève
pêle-mêle
portant le nom
d’un composé
de tumba
francesa du
début du XXe
siècle, Higinio Eugenio Daudinot, société La Pompadour de
Guantanamo, un
musicien de
changüi
directeur de
groupe, Ariel
Daudinot, une
directrice de
groupe féminin
de changüi, la
tresiste
Floridia
Hernández
Daudinot, une
championne de
volley ball
médaille d’or
de jeux
olympiques de
Barcelone,
Norka
Latemblet
Daudinot, une
universitaire
havanaise, un
chirurgien
renommé, un
jeune
combattant
noir mort
pendant
l’invasion de
la baie des
cochons et à
qui sont
dédiés des
établissements
publics, comme
une clinique
médicale et un
musée, Emilio
Pineda
Daudinot…
[75] Domingo de Heredia est mort sur le bateau parti de Cuba qui devait
l’emmener se
soigner en
France (il
était
parfaitement
bilingue).
[76] Tiguabos était à l’époque la seule agglomération d’importance dans le
versant Sud de
ce qui est
aujourd’hui la
Province de
Guantanamo,
son rôle a été
ensuite
remplacé par
le ville de
Guantanamo, à
l’emplacement
jusque là dit
« El
Saltadero ».
Le versant
Nord, côté
Atlantique
avait pour sa
part la
première
capitale de la
Cuba
coloniale,
Baracoa.
[77] Les Despaigne étaient propriétaires en 1843 de La Lisse (100 carreaux, 100
esclaves) et
d’une autre
propriété
Despaigne Fils
(100 carreaux,
13 esclaves).
C’est
peut-être
cette dernière
qui s’appelait
La Estrella
(Brazo del
Cauto, près
d’El Cobre)?
En 1847, à la
mort de Jean
Despaigne,
cette famille
possédait
aussi les
caféières El
Diamante et El
Eden. Les
Despaigne
étaient liés
par un mariage
au négociant
anglais établi
à Santiago,
Brooks, qui
étendait ses
activités à
New-York,
Londres, La
Nouvelles-Orléans
&
Kingston.
Brooks était
un chaînon
important des
transctions de
la famille
Heredia
Girard, à
laquelle, il
écrivait dans
un français
parfait. Il
fut à un
moment un
employeur d’un
frère
Daudinot.
[78] Pour la compréhension du propos, dans cette partie,
nous
allons choisir
systématiquement
la traduction
en français
des vers
créoles de Hippolyte Daudinot.
[79]
Dans
notre
corpus :
aucun cas sous
la signature
de Prudent.
Chez
Hippolyte :
une
créolisation
du pues
castillan,
dans une seule
occurence :
pouès et dans
une même
expression :
con
caracoles
(avec des
coquillages).
Pas plus.
[80] Dans cette vague, il y avait trois positionnements para rapport à
l’héritage du
créole 1.
les expulsés
de Cuba
installés en
Louisiane qui
avaient déjà
frotté leur
créole
dominguois au
contexte
hispanophone,
2. des
réfugiés de
Saint-Domingue
en Louisiane
qui
rejoignaient
les premier,
3. des
Louisianais
qui avaient vu
arriver chez
eux les
dominguois et
leur créole,
lequel s’était
frotté au
créole
louisianais,
déjà formé sur
place avant
l’arrivée des
réfugiés.
Aucun de ces
positionnements
n’était donc
éloigné d’une
pratique du
créole, ou
plutôt d’un
créole. Sur le
créole
louisianais et
les
dominguois :
Ingrid
Neumann-Holzschuh
(ed.) Morceaux choisis du folklore louisianais, matériaux pour l’étude
diachronique
du créole de
la Louisiane.
https://buske.de/media/upload/leseprobe/9783875485240.pdf
[81] Lettre à M. Escudier de la France Musicale http://www.gottschalk.fr/Ecrits/LettrePortoRico.pdf
[82] « A la muerte de Jean
Despaigne, en
1849, el
avalúo de sus
bienes arroja
luz sobre la
procedencia
étnica de sus
esclavos: de
los 63
esclavos de
sexo masculino
del cafetal La
Lisse, 32 eran
africanos de
origen, una
mayoría
«congos»,
denominación
étnica que
designa de
manera general
una cultura de
origen bantú y
una
procedencia
geográfica
localizada en
el estuario
del río Congo,
pero también
«ibó» (igbo) y
«bibí»
(ibibio), dos
de las etnias
del hinterland
de la ensenada
de Biafra, en
delta del
Níger. De este
modo, aún
dentro de la
reducida
demarcación de
La Lisse,
coexistían
varias
lenguas: el
francés, el
idioma de los
amos blancos
europeos, y
quizás también
el castellano,
necesario para
la
comunicación
externa; las
originarias de
África,
habladas por
los esclavos
de la
plantación,
probablemente
alguna
lengua bantú
como el
kikongo, junto
con el igbó y
el ibibio o
quizás el
efik, y,
finalmente,
una lengua
híbrida, el
creole, que
importado de
Saint-Domingue,
era usado en
las
plantaciones
de café de los
franceses como
lengua franca
en la vida de
cada día. Esta
extraordinaria
polifonía
lingüistica
en los límites
de un solo
cafetal
permite
inferir la
compleja
matriz del
intenso
proceso de
reverberación
cultural que
caracterizó la
experiencia de
la esclavitud
de plantación
en el
Caribe ». IGLESIAS USTET. 2011
[83] C’est le cas des Heredia Girard, comprenant les descendants de Jules Raoulx, emmenant de plus avec eux deux femmes Despaigne ou le cas des parents de Paul Lafargue, futur gendre de Karl Marx (lequel venu en France pour ses études ne retourna jamais à Cuba)… Dans son article « Del sur de Francia a Santiago de Cuba », Catherine Verdonneaud retrace le parcours de ces quelques migrants et de leurs familles venues depuis la France à Cuba, via l’île de Saint-Domingue. Elle cite, le cas qu’elle trouve repésentatif de Paul Lafargue, issus d’une famille bordelaise, dont le grand-père a émigré à Saint-Domingue où il est devenu un petit propriétaire. Ce dernier décède lors de la Révolution haïtienne, ce qui pousse la grand-mère et le père de Lafargue à fuir, non pas à Cuba, mais à la Nouvelle-Orléans, où le père rencontre sa femme. Toute la famille quitte le continent américain pour Santiago de Cuba où naîtra Paul Lafargue en 1842. La famille Lafargue s’installe à la tête d’une exploitation caféière. La famille se voit contrainte de quitter Cuba pour Bordeaux en 1851 en raison du déclin des plantations françaises de café, lourdement concurrencées par les productions brésiliennes. (Cité par Belrose). Un Joseph Dufourcq reviendra dans sa région d'origine dès 1839, fortune faîte à Cuba et y achètera des terres. Théodore Moracin viendra aussi finir ses jours à Bordeaux, comme son parent Hippolyte Daudinot. Un destin différent fut celui de Juan Antonio Benjamin Antomarchi (cousin du dernier médecin de Napoléon Bonaparte, François Antomarchi, qui mourut à Santiago de Cuba de la fièvre jaune). Il était né aux Cayes (Saint Domingue) en 1802, propriétaire de la cafèterie Saint-Antoine en Oriente et avait 43 esclaves en 1843. Il rejoignit la colonie corse des caficulteurs de Mayaguez (Puerto Rico), où il mourut à 59 ans. Saint-Antoine / San Antonio fut inciendiée en 1869 pendant la première guerre d'indépendance.
[84]
Cf Daniel
Chatelain Du «
petit français
» fils
d’esclave et
de colon, le
général
indépendantiste
Flor
Crombet...à
son petit
fils, Romulo
Lachatañere,
pionnier des
études
afro-cubaines
http://www.ritmacuba.com/De%20Flor%20Crombet%20a%CC%80%20Romulo%20Lachatan%CC%83ere.html
[85]
« muchos de los esclavos de la zona, liberados por
las huestes
independentistas,
eran
africanos, o
sus hijos o
nietos, y
hablaban
creole en
lugar de
español ».
[86] El Cobre est un lieu multiséculaire de l’exploitation des gisements de
cuivre.
Visiblement la
plus ancienne
mine de cuivre
des
territoires
espagnols dans
le Nouveau
Monde ;
exploitée de
1544 à 1998.
[87]
« Se procedió al alistamiento de cuantos
estaban libres
de servicio,
se llamó a
todos los
negros de la
población, de
las minas y de
las fincas
vecinas, para
que se
situasen en
las afueras,
recomendando a
los capataces
llevasen
banderas
cubanas, y que
al llegar el
caudillo,
diesen todos
vivas a la
República, a
Carlos Manuel
y a la
libertad; se
mandaron a
decorar las
calles y a que
se iluminaran,
y en cuanto se
supo la
aproximación
de Céspedes,
salió a
recibirle el
gobernador con
su numeroso
per sonal,
todos a
caballo, le
encontraron en
Loma del
puerto del
Cobre, le
saludaron al
descender por
la cuesta con
algunos
disparos de un
cañón muy
antiguo,
conseguido en
la Socapa, al
que
denominaron
Libertador, y
al
pasar por las
filas de
soldados y
negros, estos
batieron las
palmas, dieron
vivas
atronadores,
agitando las
banderolas y
entonaron sus
cantos en
jerga
francesa,
criolla y
africana, que
iban
repitiendo en
coro,
acompañándose
con sus
tumbas,
marugas y
otros
instrumentos
de origen
africano (ibidem). ».
[88] Cf Daniel Chatelain « Notes fragmentaires : Rencontres cubaines
avec des
descendants de
Français liés
à l’Histoire
du café de
l’Oriente
cubain.
Bénégui, Bégué
Bélon,
Castelnau ».
Inédit.
[89] Les exploitations de l’oncle, le plus ancien installé, et du père,
s’appelaient
El Diamante et
El Infierno.
[90] Ce
précédent ne
va pas dans le
sens d’Olavo
Alén dans son
livre donnant
le mot
d’éléctricité
comme exemple
d’emprunt
récent à
l’espagnol.
Retour à l'accueil
