
Retour à l'accueil
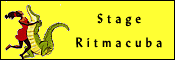
Santiago de Cuba - Juillet

Retour à l'accueil |
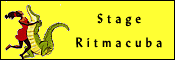 Santiago de Cuba - Juillet |
La page avec tous les textes du site
Page
en actualisation permanente (mise en ligne de la version initiale :
11/12/2016, dernière actualisation 07/03/2023)
"... sous les arcades débordantes de lumière, d'enseignes lumineuses, de musique et de promeneurs du Paseo del Prado où la ville explosait, exultait, devenait riche et prétentieuse et où il était possible, à chaque coin de rue, d'écouter les orchestres de femmes chargés de l'animation des cafés et de cette avenue centrale, des lieux qui ne fermaient jamais leurs portes, si toutefois ils en avaient."
(années
'40)
Leonardo Padura "Hérétiques", roman. 2013
PRÉAMBULE : Le phénomène impressionnant des orchestres féminins à Cuba à partir des années 1930 est unique en Amérique latine. Il a précédé nettement un phénomène analogue aux États-Unis. Mais il a été peu traité jusqu’ici en français. Raison suffisante parfois pour en dire plus (mais conduira à synthétiser lorsque nous pouvons renvoyer à des monographies). Nous avons choisi de traiter ce phénomène dans une optique singulière, le liant à l’avancée des femmes dans la musique cubaine en particulier pour certains instruments qui étaient considérés traditionnellement comme relevant uniquement des hommes, comme la percussion et surtout les tambours. Nous avons été frappés, dans notre approche personnelle de la musique cubaine, des exceptions singulières de présences féminines dans cette Histoire vis-à-vis des tambours, comme le cas de la conga de carnaval où la tumba francesa. Mais au fil du temps, nous avons aussi été témoin de la résurgence contemporaine — en particulierdes orchestres féminins à Cuba et de l’apparition de groupes comparables en Europe. Témoin fraternel aussi, et souvent admiratif dans des situations de cours, d'ateliers, de concerts, de concours, etc.— du franchissement des murs invisibles par des femmes dans la percussion traditionnelle, dans l’île comme au dehors de ses rivages. Cette page croise ces différents domaines d’intérêts et d’expériences et recoud ensemble les différentes époques de cette progression. Qui, bien sûr, n’est pas encore terminée.
Nous espérons, entre autres, que ce texte sera utile aux protagonistes pour un meilleur ancrage historique de leur parcours de pratique musicale. Coïncidence, cet article est paru au moment où le plus célèbre des orchestres féminins cubains, Anacaona, a fêté son 85e anniversaire en se produisant sur les lieux originels du groupe. dc
SOMMAIRE
1.
LES PIONNIÈRES
— Où sont les femmes dans la conga ?
— Femme tambourinaire dans la tumba
francesa
— Pionnières dans le Son del Monte
— Des femmes directrices d'orchestre
María Teresa Vera, Concepción Bravo, "Conchita",
Margarita Lecuona, Justa García, Coralia López...
— Les premières trovadoras
— Des duos et
trios féminins vers des formations plus larges
Hermanas
Lago, Hermanas Márquez, Hermanas Martí, Hermanas
Junco, Dúo Hermanas Patterson, Trio Aloima...
2.
LES PREMIERS ORCHESTRES FÉMININS FONDÉS DANS LES ANNÉES
'20 & '30
— Estudiantina Cuba, Charanga de
Doña Irene, Sexteto Casiguaya, Edén Habanero, Ensueño,
Jazz Queen, Orquesta Social, Topacio,Típica Yambambó,
Orquesta Mezquida
—
De
la Orquesta Orbe ou
Saratoga au Jazz Band Hermanas Álvarez
et
Cuban Melody, Renovación...
— Anacaona,
premières décennies.
— Plus
sur la première génération : Trovadoras del Cayo, Orquesta
Ilusión, Hermanas González, Hermanas Estupiñán, Ónyx,
Margarita Lecuona et les Lecuona Cuban Girls...
— De Santiago de Cuba à Pinar del
Rio : Las Marietas
etc
— Danse et musique :
Las
Mulatas del Fuego
3. VOCALEMENT VOTRE
— Les année
'50 & '60. Groupes vocaux et nouvelle génération
d'orchestres. Las d’Aida, Las Hermanas
Benítez, Las Hermanas Márquez, Ensueño Tropical, Las
Hermanas Valdivil...
— Les nouveaux groupes vocaux
féminins à partir des années '90. Gema 4, Camerata
Romeu, Vocal Universo, Vocal Divas, Vidas, Vocal Adalias,
Sexteto Sentido, Vocal Tres...
— Rap cubain féminin. Instinto
4.
UNE COMPOSITRICE CONTEMPORAINE
5.
LA TRADITION DU SON,
DE NOUVEAU : DES GROUPES FÉMININS DU XXIe
SIÈCLE
— Así Son,
Morena Son, Septeto Las Perlas del Son, Okán, Grupo Café,
Septeto Vida, Ad Libitum, RaSon, La Guantanamera, Las
Flores del Changüí (changüi),
Puro Sabor (organo oriental).
6.
SALSA & TIMBA AU FÉMININ : "Chicas, Mulatas, Girls,
Ladies, Damas..."
— Les
timberas : Mulatas de Fuego, Grupo Canela, Son Damas,
Las Chicas del Sabor, Chicas del Sol, Lady Salsa Mix,
Caribe Girls, Habanera Son, Ricachá (Charanga), Mulatas
Son...
7. FOCUS SUR LES FEMMES PERCUSSIONNISTES
8.
ET L'AFRO-CUBAIN?
—
Des femmes dans les tambours batas ? La distinction
profane/rituel dans la transmission, batas et rumba : Afroamerica,
Grupo d'Akkokán, Obini Batá, Obini Iraguo, Obini Oñi, Rumba
Morena...
— Un groupe féminin de tradition
haïtiano-cubaine Danza
Zetwal
APPENDICE
: Notes fragmentaires sur la dimension féminine de la
diffusion en Amérique du Nord et Europe de la percussion
afro-cubaine
— Les
groupes féminins en France Tana,
Rumbanana, Yemaya La Banda...
Documentation
Bibliographie générale
Bibliographie d'Anacaona
Discographie
Vidéos
Notes
OÙ
SONT LES FEMMES DANS LA CONGA ?
Dès le XIXe siècle, il y avait à Santiago des
organisatrices de comparsa et de formations
de percussion (tahonas)
à Santiago de Cuba : que l’on pense à María La O &
María de la Luz, dirigeantes du Cocoyé de Los Hoyos. Les airs
du Cocoyé de l’époque ont été relevés par Casamitjana en 1836
et un de ceux-ci porte le nom de María La O, d’ailleurs
orchestré dans le pot-pourri cubain de Laureano Fuentes
Matons, élève de Casamitjana, en 1847. La musicologue Zoila
Lapique relève : « Quelque chose de semblable à ce
phénomène contemporain de la conga santiaguera se passa en 1852 quand vint à La Havane la comparsa
del Cocoyé avec ses deux dirigeantes, les métisses (mulatas)
María de la O Soguendo y María de la Luz, jointes au nain
Manuel qui dansait avec l’Anaquillé, marionnette de carnaval.»[2]
Le nom María La O a été célébré à de multiples reprises dans
la musique cubaine et il est resté dans la tradition du
carnaval havanais. [3]
Mais les tambours et les jantes percutées des congas de
Santiago relevèrent de la spécialisation exclusive des hommes
jusqu’à une exception. Ou plutôt deux exceptions
succesives.
« Les congueros
sont tous des hommes et dans l’histoire de la Conga de Los
Hoyos il n’y eut qu’une seule femme nommée Gladys, renommée et
respectée et jouant de la campana[4].
Il est possible
d’établir une ligne de démarcation au sein de la conga lors de
ces sorties entre les hommes qui ont pour rôle de jouer les
instruments alors que les femmes dansent. Ce sont en effet
elles les principales protagonistes du groupe de danseurs qui
accompagne la conga, même
si des hommes sont aussi présents. » [5].
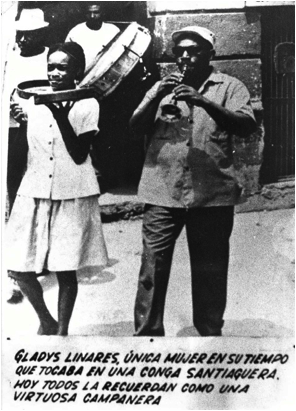
Photo : collection Miké Charropin, avec nos remerciements.
Fait très peu connu, Gladys fut en fait
précédée pendant quelques mois par une certaine Ana Limonta,
mais cette dernière cessa cette activité et Gladys Linares
devint pour longtemps l’unique campanera
de la conga de Los Hoyos,
jouant avec virtuosité ce lourd idiophone qu’est la llanta
ou
campana,
elle fut connue aussi sous les surnoms Mafifa ou La Niña
En tant que "Mafifa ",
elle devint un personnage central d’une pièce en un acte de la
santiaguera Fatima
Patterson : « Repique por Mafifa o La última
campanera », ce qui témoigne d’une dimension
légendaire dans la culture populaire… et la renforce !
Actuellement, son exemple est repris par de jeunes santiagueras avec
l’exemple
d’une
campanera du quartier de
Los Hoyos (conga Los Muñequitos, également membre du groupe
féminin Obini Irawo). Pour la première fois, une campanera, en
l'occurence de la conga de San Agustín, a été primée au
carnaval de Santiago de Cuba de 2017.
Complément
:
HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU CARNAVAL DE
SANTIAGO DE CUBA

FEMME TAMBOURINAIRE DANS LA TUMBA FRANCESA
Une autre de femme de Santiago fut connue par sa pratique de la percussion avant Gladys : Tecla (Consuelo) Venet Danger (septembre 1900-18 mai 1988), reine de tumba francesa, fut également célèbre pour sa pratique du *catá, ce gros idiophone frappé par deux bâtons, au jeu plutôt physique. Les caficulteurs d'origine française Venet et Danger, comme beaucoup d'autres descendants de ceux qui avaient fui l'insurrection aboutissant à l'indépendance d'Haïti en 1804, étaient installés sur deux plantations proches l'une de l'autre, respectivement sur les lieux-dits El Palmar & Limoncito, soit des escarpements surplombant El Caney (actuel Municipio de Santiago de Cuba) sur un versant et la plage de Siboney sur un autre versant. Les esclaves des deux plantations portant tous le nom de famille d'un de ces deux maîtres, certain descendants de l'union d'un de ces maîtres avec une esclave, associèrent ces deux noms à différentes reprises. Décédée à 94 ans, fille de la reine de tumba francesa Nemencia Danger qui avait vécu 115 ans (réputée originaire du congo), elle était la mère de la reine-présidente de la société de tumba Francesa La Caridad de Oriente (anciennement La Fayette*, fondée en 1862) : Yoya (Gaudiosa Venet Danger), à qui a succédé aujourd’hui la reine-présidente actuelle, Andrea Quiala, nièce de celle-ci et descendante de Tecla.
*catá
: voir les articles : La
tumba francesa de Daniel Chatelain et "Traditions
musicales et dansées des communautés haïtiennes de la région
orientale de Cuba" de Daniel Mirabeau
**
du nom du "héros des deux mondes", le général français
Lafayette (1757-1834), combattant de l'indépendance des
Etats-Unis, partisan de l'abolition progressive de l'esclavage
sous Louis XVI, suite à son expérience plantationniste en
Guyane, membre de la "Société des Noirs" (favorable à
l'abolition) en 1789, sympathisant ensuite du héros
latino-américain Simon Bolivar...
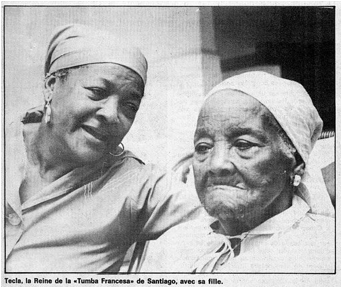
La fille d’Andrea, Queli Figueroa Quiala a repris dès l'enfance cet usage patrimonial des percussions de la tumba francesa, favorisé par la transmission avisée de son père, aujourd'hui décédé, qui dirigeait les percussions de la société de tumba francesa de Santiago de Cuba. Elle resta seule descendante du couple après un drame familial, le décés accidentel de son frère aîné, le jeune homme destiné à continuer la tradition. Elle est la première femme à jouer l'ensemble des instruments de la tumba francesa. Nous considérons que l'apport de Queli et de ses parents, ont été essentiels pour lever les menaces de survie qui planaient sur cette société dans les annés '90. Si on sait que la candidature de l'inscription par l'UNESCO de la tumba francesa au patrimoine immatériel de l'humanité a en fait reposé dans un premier temps sur la société de Santiago, puis étendue aux trois société survivantes (en ajoutant celle de Guantánamo et celle de la rurale Bejuco), on en voit les conséquences dans la reconnaissance mondiale de cette tradition inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité en 2003.

Signalons que dans la tradition de la tumba francesa, il y avait traditionnellement une répartition de rôles traditionnelle entre les « composés » (compositeurs) masculins, qui se livraient plus souvent qu'à leur tour à des controverses et les "reinas cantadoras" (interprètes solistes féminins des chants traditionnels) accompagnées d'un chœur féminins agitant des chacha (maracas métalliques ornées de rubans). Il y a eu cependant des exemples anciens de composés femmes, telle une autre aïeule de Queli : Emelina "Linda" Venet Danger. Aujourd'hui les composés masculins et leurs affrontements virils par la controverse ont disparus mais les reinas cantadoras ont préservé l'existence d'un cancionero de tumba francesa et composent à l'occasion[6]
PIONNIÈRES
DANS LE SON DEL MONTE ET LE CHANGÜI
Toujours en Oriente, dans une famille à l’origine du son, des femmes ont été connues par la pratique de la percussion dans la première moitié du XXe siècle : Catalina Valera, bongosera et joueuse de tumbandera, et sa fille Emilia (Milla) : mère de Felix Valera, directeur-fondateur du groupe Familia Valera Miranda. Et sans doute leur parente Julia Roman Valera, qui composait dans les années 30 ("Murió Valera en San Luis" : ce Valera était un bandit d'honneur) et est décédée à 114 ans en 1980. Particularité : ces femmes jouent alors le bongo posé sur les cuisses, position jugée plus décente.

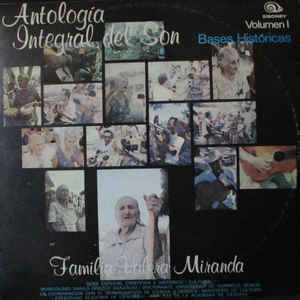
Une autre Julia a précédé en Oriente beaucoup de bongoseros et
autres
soneros, de la
génération des premiers pratiquant connus de ce style, homme
et femmes confondus.
Julia La O, guitariste, bongosera, épouse de Nicolas Hierrezuelo, chanteur et tresiste (joueur de très) des environs de Santiago (par ailleurs lieutenant de l’armée libératrice dans la guerre de l’indépendance cubaine). Elle fut mère de onze enfants, élevés dans la tradition musicale du couple, parmi lesquels les musiciens professionnels Reinaldo Hierrezuelo — 1926 (Cuarteto Patria, Los Compadres, Sonora Matancera, Vieja Trova santiaguera), Ricardo, Lorenzo (Duo avec María Teresa Vera, Los Compadres), Caridad — 1924 (Los Taínos de Mayarí, Los Van Van, Rumbavana, Conjunto Caney).
Dans le son montuno et le changüi des origines, où, dans de petites communautés issolées pouvait commencer une fête avec un tres qui demandait un apport percussif, ces femmes jouant le bongo n'étaient pas forcément des exceptions. Ainsi Chito Latamblé, le plus célèbre des treseros de changüi, né en 1916, a témoigné que son arrière grand-mère Atina Latamblet jouait le bongo de monte. C'était avant la guerre de 1895, dans un bateye et des baraquements de la propriété San Miguel, près d'une localité voisine de Guantanamo, Jamaica. Atina jouait avec ses fils Higinio et Vincente. C'est la plus ancienne des bongoceras dont on ait mention, sinon des bongoceros tout court.
DES
FEMMES DIRECTRICES D’ORCHESTRE
Des femmes qui deviennent directrices de groupes musicaux essentiellement masculins. Cela s’est vu à Cuba depuis les années ’20 du XXe siècle.
Vient inévitablement à l’esprit María
Teresa Vera (1895-1975), qui enregistra en duo
féminin-masculin à partir de 1914 et crée en 1926 le sexteto Occidente,
qui compte dans ses rangs un des plus grand soneros,
le contrebassiste et compositeur Ignacio Piñeiro. Le sexteto Occidente enregistra à New-York l’année de sa création.
María Teresa Vera
(Guanajay 1895 - La Habana 1965) est née à l'extrémité
occidentale de Cuba (sans tradition de trova jusque là) et a commencé sa carrière en 1911.
Elle est d’extraction populaire, métisse avec une
grand’mère esclave (yoruba). Son talent est couvé dans son
enfance par une famille bourgeoise de sa province qui
emploie sa mère et fait fort usage de son piano, les
Aramburu.
Dans la capitale, seul cas repéré chez les chanteuses de
l’époque, elle adopte le mode de vie bohème des trovadores
(en l’occurrence dans le « clan » de
Manuel Corona), lesquels lui enseignent la guitare. Elle
devient une véritable mémoire vivante des compositions des
trovadores (elle
interprète des chansons que leurs propres auteurs ont
oubliées) et rend célèbres certaines d’entre elles. Son
duo avec Rafael Zequeira est anthologique.
Son répertoire est très étendu, de la trova
à la guaracha
(pour laquelle elle est moins connue).
Elle fut la première femme à diriger une formation de son,
le sexteto
Occidente, enregistré par la Columbia dés 1926. A ce
sujet, Cristobal Díaz Ayala, référence maximum pour la
discographie de la musique cubaine, pense que la Columbia
a cherché à travers le Sexteto Occidente une réponse à la
vogue du Sexteto Habanero promu par les disques Victor et
que dans cette perspective avoir dans une formation une
femme comme directeur associée au grand Ignacio Piñeiro
ètait un élément distinctif dans cette compétition
commerciale. "Il n'était pas habituel à cette époque
de confier la direction d'une formation musicale à une
femme, même flanquée d'un directeur musical" (soit
Miguel García). Il ajoute que faisant cela, la Columbia
connaissait le travail de María Teresa Vera avec le
Sexteto Habanero de Godínez en 1918, ses nombreux
enregistrements avec Zequeira et ensuite avec Miguel
García (pour Columbia) des années '20. "Occidente" fut un
mot mis en équivalence avec "habanero", logique de plus
pour une femme née non pas à La Havane mais dans une autre
ville occidentale, Guanajay (cf. chronique de livre
"Ignacio Piñeiro tiene ya su libro, San Juan, 28 de Julio
de 2013). Mais le Sexteto Occidente n'obtint pas un succès
durable.
Maria Teresa s’interrompt de chanter de 1930 à 1935 pour
des raisons religieuses. Devant le succès immense de sa
composition « Veinte años » composée dans cette
période de retrait, elle cède aux pressions conjuguées du
public et de Justa
García, autre femme meneuse de groupe
(cf infra), qui l’intègre à son cuarteto.

Evoquer María
Teresa Vera nous conduit à donner un
exemple étonnant de femme auteur cachée.
La véritable auteur du texte de Veinte años, rien d’autre
que la chanson phare de la trova
cubaine, sur un rythme de habanera, ne fut révélée que
récemment. Il s’agissait d’une amie d’enfance de la
famille Aramburu, déçue de son ménage qui tenait à garder
l’anonymat : Guillermina
Aramburu (Guanajay, 6 février 1895
- La Havane, 17 décembre 1965). En dehors de Veinte años,
d’autres compositions de M. T. Vera ont eu leur texte
écrit par cet auteur féminin clandestin.
Ce destin de femme bourgeoise écrivant clandestinement des
chansons qu’elle confie à son amie d’enfance, laquelle a
choisi la vie bohême de la trova,
mérite d’ailleurs de s’y arrêter plus amplement.
Reynaldo Gonzalez déclara sur María Teresa Vera : « On
dit que son amie d’enfance Guillermina Aramburu eut une
vie maritale heureuse pendant vingt ans, à la suite de
quoi son mari la trahit. Guillermina, qui écrivait des
chansons depuis ses jeunes années (….)
remit à María
Teresa sa création « Veinte años » pour
qu’elle la chante avec la promesse de ne jamais révéler
qu’elle l’avait écrite ; en conséquence, la
majorité du public ignora jusqu’il y a peu de temps que
la majorité des textes de chansons de María
Teresa Vera sont de Guillermina »[7].
Quand Justa García
décide d’arrêter sa carrière, María
Teresa Vera se retrouve seule avec Lorenzo Hierrezuelo (le
futur « Compay primero » de Los
Compadres) et ils décident de continuer en duo sous
leurs deux noms. Dés la première partie de sa vie
professionnelle, elle a poursuivi un chemin différent des
futurs groupes féminins, femme
s’imposant dans le milieu masculin sonero
malgré les préjugés ambiants, jusqu’à diriger une
formation masculine. Elle se retira définitivement en
1962.
Un exemple méconnu des premières directrices d’orchestre
de musique populaire est
Concepción
Bravo, "Conchita", fondatrice en 1927 du premier
groupe format jazz band de Guantánamo : Hatuey.
Serait-ce le premier orchestre jazz band de Cuba? Cette
date pionnière est en rapport entre la vie musicale de la
ville et de la base navale US toute proche. Selon des
recherches menées dans cette ville, elle fut aussi
innovatrice d'un autre point de vue : en introduisant le
piano dans le son,
se faisant populaire auprès des couples de danseurs de
Guantanamo pour ses descargas de piano dans le répertoire
sonero et ainsi prendre rang dans l’évolution qui
conduit du septeto
vers un nouveau format musical pour jouer ce style :
le conjunto
(processus évolutif où le génial
tresero
Arsenio Rodríguez est considéré comme le personnage-clé).
Sa vélocité au piano était en partie acquie pour avoir été
une accompagnatrice au piano des films muets, pionnière
féminine là aussi dans ce domaine.

« Conchita »
Bravo
au piano. Guantánamo - 1996
De tels exemples, auxquels on pourrait ajouter la
notoriété de la pianiste et compositrice Margarita
Lecuona (voir plus loin), dans un registre
musical plus classique, étaient de nature à ouvrir les
portes aux femmes dans la musique cubaine.
Il n’est pas étrange que dans un contexte raciste et
sexiste, où
le mélange des races et des sexes était de nature à
choquer, où la ségrégation sévissait dans la société et la
musique, avec des orchestres de Blancs, de mulâtres et de
Noirs, les femmes musiciennes aient tendance à se
regrouper selon le genre et obtenir ainsi une meilleure
acceptation de leur entourage. Sans oublier une dimension
école de musique de filles de familles nombreuses sur
laquelle nous reviendrons.
Parmi les toutes premières directrices de formation musicale cubaine, revenons sur Justa García (1894-1952), déjà citée, meneuse d'un trio et d'un cuarteto. Le Cuarteto de Justa García subit plusieurs changements de ses membres y participèrent plusieurs chanteuses comme MaríaTeresa Vera, Dominica Verges et quelques hommes dont Francisco Repilado, qui devint plus tard « Compay Segundo » dans Los Compadres, Isaac Oviedo, Graciano Gómez. Justa García intégra par la suite comme chanteuse l’orchestre féminin Anacaona.

Coralia López (1910-1993), dont le nom entier est Juana Coralia López Valdés, est la première femme à avoir dirigé un orchestre de danzón. Egalement pianiste et compositrice elle est la sœur cadette de Orestes López (Macho) et précède Israel López (Cachao) dans la fratrie des López. C'est son père, le musicien Pedro López qui a guidé ses premiers pas dans la carrière musicale. Son orchestre, de 1940 à 1956, joue ses compositions ainsi que celles de Abelardito Valdés et Antonio María Romeu. C'est dans l'orchestre qui porte son nom que son neveu Orlando "Cachaíto" López, fils d'Orestes commence sa carrière. Enrique Jorrín, futur inventeur du ca cha chá y jouait également avant de rejoindre Las Maravillas puis fonder l'orchestre America. Mais il n'y a pas d'enregistrement sonore connu de l'orchestre de Coralia . Sa composition la plus célèbre est Isora Club, du nom d'un club social de Noirs et Mulâtres où on dansait dans le quartier de Luyano, proche du lieu où vivait la famille Valdés. Isora Club est considéré comme un des meilleurs danzones jamais composé, que Cachao enregistre pour la première fois en 1953, puis de nouveau en 1998 (CD, Master Sessions vol. 1, prix Grammy Awards), suivi par Rúben González en 2000 dans la lignée du Buena Vista Social Club (CD Chanchullo).
Article de Rosa Marquetti sur le Isora Club et Coralia López (esp.). Photo.
Audio sur youtube : Isora Club par Rúben González
Audio sur youtube : Isora Club par Cachao
En ce qui concerne les formations vocales, citons deux
femmes remarquables :
María Muñoz de Quevedo fonde le chœur de La Habana
en 1931 et deux décennies plus tard, avec l’arrivée de la télévision, Cuca Rivero dirige le
chœur diffusé par la petite lucarne cubaine.
Une résurgence actuelle de groupe
dirigé par une femme,
est Frasis,
formation avec un front de scène féminin de trois violons
et violoncelle, auquel s'ajoute percussions et voix,
dirigée par la violoniste Roxana Iglesias Morejón. Vidéo
2018
LES
PREMIÈRES TROVADORAS
Avant de rencontrer d’autres directrices de groupe,
arrêtons-nous sur les
premières trovadoras
cubaines.
Une figure qui rejoint, outre l’histoire de la musique
cubaine, l’Histoire cubaine tout court est le cas
tardivement connu de María
Granados (1880-1971), devant qui, selon son propre
récit, José Marti aurait écrit en 1891 à Tampa, où elle
résidait, l’unique texte destiné à être musicalisé du
héros de la nation cubaine (El
proscripto). Alors que cette chanson était oubliée,
elle l’interpréta dans une peña
havanaise à partir de 1966, à l’âge de 86 ans.[8]
La première trovadora
reconnue est cependant Angelita
Bequé. Selon Lino Betancourt, elle interprétait la trova
dans les années 1910-1922. Ressort de cette période son
duo avec Rafael Zequeira. Une photo montre une grande et
jolie Noire. Connue à son époque, elle n’enregistra pas de
disques, contrairement à beaucoup d’hommes trovadores qui furent ses contemporains (López Sánchez. 2008. p. 37).
Une autre défricheuse est Dominica
Vergés (1918-2002). Pianiste, guitariste et
chanteuse s’accompagnant aux
claves,
elle commença sa carrière en 1929 dans un septeto
familial où elle était la seule femme, avant de
participer à Anacaona, Ensueño, Ilusión,
Hermanas Armanza,
Imperio, entre autres,
et de devenir une des premières femmes à chanter le danzonete[9].
[10]
La catégorie des
femmes virtuoses de leur instrument est illustrée en
particulier à Cuba par la guitariste María Luisa Anida « La Gran dama de la guitarra ».[11]
DES
DUOS ET TRIOS FÉMININS VERS DES FORMATIONS PLUS LARGES
Un phénomène remarquable à Cuba est, dès le début des années ’30, le nombre de duos et trios féminins (dans un format défini par le Trio Matamoros : deux guitares, petites percussions : claves, maracas, güiro) — voire cuartetos — constitués en général par des sœurs : « Hermanas… ». Exemples remarquables :

— Les sœurs Cristina (guitare), Esperanza (maracas) & Graciela (mandoline) Lago n’avaient que 12, 13 & 14 ans quand se fonda en 1932 le trio Hermanas Lago. Elles firent de nombreux enregistrements et eurent de nombreuses tournées internationales dans la longue carrière qui suivit. C’est un des trios féminins harmoniques les plus importants d’Amérique latine et tout simplement le premier en date. Contrairement aux trios à deux voix avec un accompagnateur, comme le trio Matamoros, c’est le premier trio à trois voix de la musique cubaine. Avec un répertoire plus latino-américain que celui des Hermanas Martí —au strict répertoire cubain— mais elles interprétèrent cependant les œuvres des grands soneros cubains. La formation a connu divers changements de format après 1939 : une période en duo (Duo Inspiración), le retour au trio avec l’arrivée de Olga Lucía, connue comme Lucia Lago (guitare) en 1947.

Hermanas Lago lors du
retour au trio
En 1950, après une deuxième tournée de neuf mois à travers l'Amérique latine, elles passent en cuarteto avec la réintégration d'Esperanza. Celui-ci obtient un succès croissant, quand décède Esperanza en 1954, fauchée en pleine jeunesse. Les Hermanas Lago ont enregistré avec la Sonora Matancera. Elles se joignirent en 1972 au Trío Ofelia. Lucia Lago Muela (1925) est une des fondatrice de la télévision cubaine. Son décès à 95 ans le 25 janvier 2021 ferme cette belle histoire.

— Le trio Hermanas Márquez se forme véritablement en 1935. (Deux guitares et voix ou guitare-voix-percussion selon les circonstances). Trini Márquez (1924) acquiert une expérience musicale dans l’ensemble de son père, guitariste et tromboniste à Puerto Padre (Oriente). Ce chef de famille et son épouse, qui écrit des chansons, ont quatorze enfants. dans les spectacles locaux les trois filles les plus grandes (14 à 16 ans), alternent avec les petite (6-7-8 ans). Trini forme le trio avec ses sœurs Cusa (1921) & Nerza (1925), qui ont appris la guitare. Après les concerts à Puerto Padre dès 1933, elles participent à des émissions de radio à Santiago de Cuba et sont programmée au théatre Oriente. Elles partent pour La Havane en 1940, où elles passent à la radio CMQ et où leur carrière est impulsée par Ernesto Lecuona. Leurs sones et boleros plaisent au public et elles voyagent à Santo Domingo et Puerto Rico. Elles enregistrent à La Havane, seules (premier disque en 1941) et avec l’orchestre du santiaguero Mariano Mercerón. Autre voyage, à Mexico, où elles participent au film "Pervertida" et à Miami, avec un nouvel enregistrement. En 1949 sort Nerza, qui se marie, au profit de la plus petite sœur, Olga (1932), quelques temps après sort Olga, qui se marie et entre à nouveau Nerza.

Elles s’installent à
New-York en
1951, toujours cornaquées par leur mère, après un contrat
de 5 semaines. En 1960, Trini va chercher Nerza à La
Havane. Un disque est enregistré en 1965 en cuarteto, avec
Nerza. En 1966, Trini et Olga (en situation de divorce)
forment un groupe féminin -—
sous le nom Conjunto
Hermanas
Márquez, avec
l'ajout de la pianiste Margaritas Vargas, de Linda Leyda
& Lourdes López (Cuza
participe les week-ends tandis que Nerza élève ses
enfants),
avec un succès new-yorkais dans les plus grandes
salles suivi de tournées dans tous les USA et le
Canada. Cette trajectoire est compromise par
les destinées personnelles de chacune (remariage
d'Olga, sortie de Cusa...). Trini
s'éloigne de la scène pour se consacrer à la santé de
ses parents. Les deux sœurs Márquez
Nerza et Trini, reprennent la scène en duo vers 1990. Première voix Nerza et
segonde voix Trini. Encouragées par Celia Cruz, elles
enregistrent en 2004 un disque "Paquito D'Rivera presents Las Hermanas Márquez" accompagnées de
Paquito D’Rivera, devenu leur ami, contenant deux chansons
de Trini outre les reprises de classiques. Le concert
filmé de présentation du disque témoigne du charisme
étonnant de Trini, en particulier. Cf
youtube. [12]

Duo Hermanas Márquez, années 2000
Vidéo : séquence d'un film des Hermanas Márquez accompagnées d'un pianiste.
—
Hermanas
Martí
(duo) : Fondé en 1938 par les sœurs Berta (1919-2002),
première voix et guitare d'accompagnement & Amelia
(1922), voix segonde et guitare soliste
(1922), laquelle, après des études de guitare classique
commencées en 1950, gagna
un prix de guitare en interprétant du Villa-Lobos et devint
professeur de guitare au conservatoire de Guanabacoa,
parallèlement au duo. Rodrigo Prats disait d'elles
qu'elles avaient "vêtues la trova d'un frac" (de gala).
Leur répertoire est basé sur la Trova, créé en contact
personnel avec les trobadores de référence (dont Sindo
Garay, Rosendo Ruiz, Alberto Villalón, Manuel Corona...)
avec une prédilection pour les compositions de Manuel
Corona. Elles participèrent à quelques revues musicales
d'Ernest Lecuona. Elles avaient tendance à normaliser les
métriques irrégulières des trobadores
les plus éloignés de la transmission écrite.[13]

Duo
Hermanas Martí
— Hermanas Junco. Le trio Junco, formé en 1947, donnera naissance en 1963 au duo Hermanas Junco, avec José Tejera comme accompagnateur. Composé de María (1919), première voix et Delia Junco Sterling (1923-1992), voix segonde. Leur répertoire est la trova cubaine. Elles sont actives jusqu’aux années ’70. [14]

Duo Hermanas Junco, avec deux accompagnateurs. Collection Roberto Garcia.
— Le Trio Aloima funt fondée par trois sœurs Domech Betancourt aux prénoms peu communs : África (1923), Francia et Belgica. Elles s'étaient formées dans un groupe d'enfants de spectacle, Cubanacán, où se trouvaient aussi dans la fratrie Domech : Patria, Libertad en plus d'un plus commun Raúl. África fut chanteuse d'Anacaona et fut connue dans les années '70 pour ses populaires compositions et interprétations enfantines, pour lesquelles elle fit aussi des tournées internationales. Elle émigra aux États-Unis.

— On peut encore signaler dans la génération pionnière le duo santiaguero Hermanas Reyes [15], qui sera suivi d'autres duos participant à la Casa de la trova de Santiago de Cuba et des Casas de la trova d'autres villes.
Encore plus remarquable est la constitution des orchestres
féminins à Cuba dans les années ’30, au sein desquels les
femmes jouent d’un ample répertoire d’instruments dans les
lieux populaires. Ce phénomène est un événement unique au
niveau mondial et précède la vogue des jazz bands féminins
aux États-Unis d’une décennie (cette vogue est quant à
elle de la fin des années ‘30 et des années ’40).
Cependant, un big band féminin états-unien existait en
1928, la même année où apparaît le premier orchestre
féminin cubain (La charanga de Doña Irene) : The Ingenues.
Un vitaphone témoigne en image de leur présentation
somptueuse et d'un dimension poly-instrumentiste (comme
dans beaucoup de formations féminines cubaines
d'ailleurs). Mais autant les formations féminines dans les
différents formats orchestraux proliférèrent à Cuba
au début des années '30, autant, jusqu'à preuve du
contraire, les Ingenues reste un phénomène isolé aux
États-Unis, avant que la seconde guerre mondiale ne change
la donne.
Par orchestres, on entend d’abord : sextetos,
septetos, charangas (ou mini-charangas)
et jazz bands. Ils sont souvent initiés par deux ou trois
« Hermanas...
». On voit dans l’exemple du Duo Mezquida
que les duos ou trios ont été l’ossature de formations
plus étendues. Ou, comme dans l’exemple de Ensueño,
se regrouper plusieurs binômes ou trinômes de sœurs (cf
infra). Quand ce n'est pas, comme dans le cas d'Anacaona
une dizaine de sœurs qui rejoignent par étapes un septeto
initial pour former l'ossature d'un orchestre pérenne,
lequel agglomère d'autres artistes dans la dynamique ainsi
créée.
Ces orchestres vont avoir un lieu privilégié, celui des Aires Libres de part et d’autre de l’hôtel Saratoga, sur une distance d’environ 200 m. de la promenade du Prado. Plusieurs orchestres féminins jouaient côte à côte, attirant l’attention des badauds havanais et des provinciaux débarqués de la gare centrale, étourdis par l’effervescence de la capitale. Ces groupes jouaient du mardi au dimanche, en semaine de 20h à 24h. Les musiciennes étaient faiblement payées, si bien que les occasions de tournées à l’étranger étaient fort attendues. Mais ils étaient suffisamment nombreux pour créer des concours entre ces orchestres.

Une formation marque une étape vers les orchestres féminin, la Estudiantina Cuba s'est formée en 1926 ou peut-être avant. Elle est composée d'une large majorité de jeunes femmes, dont au début la chanteuse Ana Esther Pérez (voix soprano) avec quelques hommes dont son premier directeur, le compositeur Gumersindo Garcia, puis le professeur Godino. Une photos de 1933 permet de compter seize femmes et cinq hommes. La formation enregistre une douzaine de titres en 1927, surtout des thèmes de son premier directeur et dure au moins jusque 1935 (informations transmises par Patrick Dalmace).
Ce n'est pas une estudiantina à la cubaine avec vents et percussions comme il y en eut dans l'Est de Cuba, mais une estudiantina de tradition espagnole composée de multiples instruments à cordes : guitares, mandolines et bandurrias (mandolines espagnoles).
Une virtuose des timbalès dans les années '20
— Selon María del Carmen Mestas « la première directrice d’orchestre féminin sur lequel on soit informé s’appelait Irene Laferté, qui avait une connaissance profonde de la percussion, spécialement des timbalès.[16] Elle fonda sa "Charanga de Doña Irene" en 1928 dans le quartier habanero Santa Amalia avec ses quatre filles : Mercedes (violon), Josefina (violon), Dora (trompette & arrangements) & Inés (güiro). Cette charanga, qui avait substitué la flûte par une trompette, jouait surtout des danzones.

Au
moins deux de ses filles, passèrent ensuite à
l’orchestre Edén Habanero, dirigé
par l'une d'elles Mercedes Herrera. Doña Irene,
qui fut appelée « la virtuose des timbales »
mourut en 1970 (elle était née le 28 octobre
1877). On a ainsi en même temps la première
directrice de groupe féminin et la première femme
célèbre dans sa dextérité aux percussions cubaines, en
l’occurrence les timbalès. [17]
Elle jouait aussi des
instruments comme le laúd et l'accordéon,
instrument qu'elle aurait joué pour divertir les troupes
indépendantistes.

— La charanga Edén Habanero fut fondée en 1930 ou 31 selon les sources et prend la suite de la charanga d’Irène Laferté. Au danzón s'ajoute d'autres styles comme la guaracha, le bolero et le pasodoble à la mode. La directrice Mercedes Herrera était contrebassiste, la charanga était composée par ailleurs de Alina Rivero, güiro, Carmela Ramos Pestañal, timbalès, Dora Herrera, piano, Rosario Martínez, chanteuse … Cette dernière est à l’origine du premier syndicat de musiciens cubains, en 1933. En 1938 Edén Habanero remplace Anacaona (en tournée aux États-Unis) sur les « Aires libres » où ce dernier groupe se rendit célèbre. L’orchestre prit ensuite le nom de Orquesta Hermanas Herrera.

Orquesta
Edén Habanero. Collection Daniel Chatelain
—
La
formation jazz band Ensueño
est la première formation féminine du genre à Cuba, crée
le 5 avril 1930 selon Radamés Giró. Elle acquit une grande
popularité dans les « Aires
libres », en même temps que les sociétés
récréatives et les fêtes des 15 ans de la bourgeoisie
havanaise. Sa directrice est Guillermina
Foyo Facciolo (piano & violon) et elle est
composé de douze
intégrantes, parfois plus ! On y trouve Estela Junco,
batterie, sœur de Manuela, contrebasse.
Également, des sœurs Foyo, des sœurs Junco, des sœurs
García Cano puis des sœurs Pérez Alderete. Estella
Foyo se distingue à la fois à la
batterie et aux pailas
[18].
En octobre 1932 Ensueño embarque à Santiago de Cuba
pour Santo Domingo avec un grand succès, premier
orchestre féminin cubain à jouer hors de l'île. D’autres
tournées suivent en Amérique latine et aux États-Unis …
dans un cirque. Ce qui ne les empêche
pas de partager la scène avec les gloires
états-uniennes telles que Benny Goodman, Glenn Miller y
Tommy Dorsey.
Le répertoire d’Ensueño était plutôt éclectique :
chansons états-uniennes en vogue, valses, tangos
alternaient avec les chansons cubaines et
latino-américaines. Mercy Mesquida en a fait partie
(clarinette) à plusieurs moments, entre autres dans une
tournée de 1935. Ensueño devint un moment "Cuban Music ". Son activité est mentionéée jusqu'en 1957. Ensueño
fut un groupe rival d’Anacaona pour sa popularité. Mais
au contraire de ces dernières il n’y a pas
d’enregistrement du groupe.
Des risques de confusion existent avec le groupe postérieur "Ensueño Tropical", sur lequel nous reviendrons.

Orquesta
Ensueño
Deux postérités éphémères et ignorées :
— 1. Les sœurs Merceditas & Luisa García Cano respectivement saxophoniste et banjoïste, quittent Ensueño, vraisemblablement en1933, pour créer l'orchestre Jazz Queen, composé de dix à douze jeunes femmes. Le groupe se dissout en 1936 après le décès des parents de Merceditas & Luisa. (Les éléments sur l'existence de ce groupe oublié ont été découverts par Patrick Dalmace ; cf lien, page avec photos).
—
La
même année que Ensueño, 1930, apparaît aussi la Típica Yambambó. Elle est
fondée par les sœurs du Duo Mezquida : Mercy (1913-1951)
& « Cachita » Caridad. Dulce María Brito est
à la batterie.
—
La Orquesta
Mezquida est un jazz band formé à partir de
l’orchestre précédent, un an après. Y est remarqué le jeu
de maracas de la jeune chanteuse Mercy Mezquida — mère
de Leo Brouwer —
très chorégraphié. La belle Mercy Mezquida est par
ailleurs déjà populaire pour ses talents de danseuse et
reçoit des surnoms qui vont de "La poupée Mercy" à
"la danseuse des danses agressives". Dulce María
Brito est à la batterie, comme auparavant dans la Típica
Yambambó. L’orchestre fit une seule tournée internationale
(Pérou, Java, New-York). Mercy jouait les percussions, le
piano, le saxophone, la clarinette, la flûte outre ses
talents de chanteuse. Elle devint ainsi soliste de
l’orchestre Lecuona, où elle rencontra le futur père de
"Leo" Brouwer (de son nom complet Juan Leovigildo Brouwer
Mezquida), apparenté à la famille Lecuona. A la mort de
Mercy en 1951, le futur compositeur et guitariste virtuose
de réputation mondiale Leo Brouwer — il a douze ans — est gardé par sa tante Caridad Mezquida et c'est elle qui lui
apprend la théorie musicale, tandis que son père Juan lui
apprend la guitare. [19]
A la fin de 1931, quelques mois
avant la fondation d’Anacaona, apparaît le Sexteto
Orquesta
Orbe, "entièrement
constitué de jeunes filles de la bonne société
et cette origine sociale va leur faciliter l'accès
aux salons de la classe supérieure"
(P. Dalmace). En fait un septuor avec trompette, dont
deux musiciennes alternent sax et violon, avec les
sœurs Luisa & Delia Vallejo comme chanteuses et Esther
Lines, violoniste, saxophoniste. Luisa Vallejo
et Esther Lines sont toutes les deux mentionnées comme
directrice selon les sources : elles ont pu l'être
successivement, à moins qu'il y ait une directrice et
une directrice musicale... Elsa Díaz est à la
batterie.
On a pu lire que c'est le premier groupe féminin
cubain à avoir
voyagé à l’étranger : à Veracruz en 1934, mais en
fait Ensueño les a précédées : octobre 1932.

Orquesta Orbe.
Collection Daniel Chatelain
En 1937, Esther
Lines sort de l’orchestre, avec
d'autres intégrantes
; elle rejoint Renovación (cf
infra) et entrent
de nouveaux membres dont Juanita & Luz
Álvarez... qui viennent, en sens inverse, de Renovación.
C'est alors que le groupe commence à
apparaître aussi sous le nom Saratoga (du
nom d'un des hôtels des "Aires Libres"), selon les
circonstances. Dans cette période il compte jusque 14
musiciennes.
L'orchestre apparaît aux côtés de
Rita Montaner « La única » dans le film
Romance del Palmar. Lorsque
Juanita Alvarez prend la direction de
l'orchestre, il apparaît comme
Jazz band des Hermanas
Álvarez, avec Estrella Górrin comme chanteuse.
Dans les années 40, il devient Cuban
Melody.

Hermanas
Alvarez. Collection Roberto Garcia.
—
Renovación.
Il est fondé et dirigé par Nena Ballesté, direction
ensuite reprise par Guillermina Zimmerman (en 1935). Son
répertoire inclut les succès de Miguel Matamoros et
de Lecuona. Il apparaît sur les "Aires
libres" dès 1933. Renovación remporte le concours
des orchestres (plus celui des costumes) en 1937.
Passent dans ce groupe le sœurs Manuela (ctb) et Lolita
Zimmerman (tp), qui accueille aussi l'ancienne
directrice de Orbe, la saxophoniste Esther Lines.
Renovación est toujours actif sur les "Aires
libres" en 1944. Le groupe est au départ
entièrement féminin puis est rejoint dans certaines
occasions par le trompettiste soliste Rogelio García (de
l'Orquesta Broadway). Page
de montunocubano (photos)
— Orquesta Social. Groupe constitué de jeunes femmes de la bonnes société havanaise, organisé en 1932 par María Antonia Pedroso, rejointe par ses sœurs Leopoldina (guitariste) et Lydia (maracas). Une photo (lien de l'article de montunocubano.com) les montre constititué de neuf musiciennes et et décline leur instrumentarium : claves, maracas, güiro, bongo, timbales, deux violons, flûte traversière, contrebasse; le piano de María Santamaria n'y apparaît pas). Il commence à se produire début 1933 et sur les "Aires Libres" à partir de septembre. Ses activités cessent au cours de 1934 à la suite du décès du père des jeunes filles Pedroso et du mariage de la directrice.
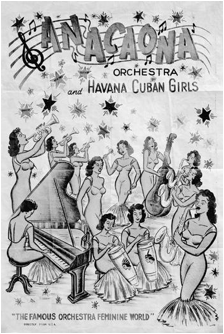
"The
Famous Orchestra Feminine World". Affiche.
L’orchestre féminin le plus connu, au point d’avoir
éclipsé l’existence des autres, est bien
sûr Anacaona. Il
n’apparaît qu’en 1932, au Teatro Payret de La Havane.
Anacaona est d’abord un sexteto.
Sa directrice est Concepción Castro. Ses études de
chirurgie dentaire étant mises à mal par la dictature
de Machado, Concepción Castro décide de changer de
voie professionnelle et entraîne certaines de ses
sœurs dans cette aventure. Le sexteto
Anacaona comprend au départ trois
des dix sœurs Castro (Concepción, Caridad
« Cachita », Ada) plus des amies
de la directrice.

On peut voir au musée de la Musique de La Havane une
très esthétique marimbula
d’Anacaona, l’instrument de percussion qui jouait des
notes basses avant qu’il soit substitué par la
contrebasse. Cette marimbula était jouée, selon Patrick
Dalmace, par Flora Castro (La Havane 1914-?), qui arrêta
rapidement sa participation à Anacaona à la suite de son
mariage. Les dates peintes au moment de sa cession au
musée peuvent cependant laisser penser qu'elle a pu être
jouée après le départ de Flora dans des séquences en
sexteto ou septeto.
Avec l’ajout de la toute fraîche trompettiste Ondina
Castro, le sexteto
devient septeto.
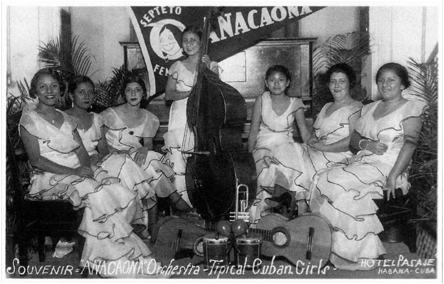
Anacaona :
Le septeto avec contrebasse et trompette.

L’adoption du format jazz band reprenait la vogue des
grands orchestres cubains qui venaient d’éclore entre
1935 et 1937. Ces derniers
étaient eux-mêmes une mise au goût du jour rapide
provoquée par l’éclosion dans ces mêmes années des
orchestres swing, noirs ou blancs, aux États-Unis.

Anacaona : les instruments à vents du jazz band et les percussions cubaines.
En 1935, elles voyagent à Porto Rico et en 1937-1938 à New-York, où il leur est offert un contrat pour trois disques (6 plages). Ces enregistrements, qui ont fait l’objet d’un CD de la collection Harlequin, sont les premiers d’un groupe féminin cubain. Ainsi, elles sont les seule des orchestres féminins des Aires Libres à avoir enregistré. Leur succès américain précède de peu la vogue des orchestres féminins états-uniens.

En 1938, elles sont en formation de 10 musiciennes à Paris. « The ten Anacaona sisters » dit le programme, avec la direction musicale du grand flûtiste cubain Alberto Socarras (crédité du premier solo de flûte enregistré sur un disque de jazz) et alternent avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
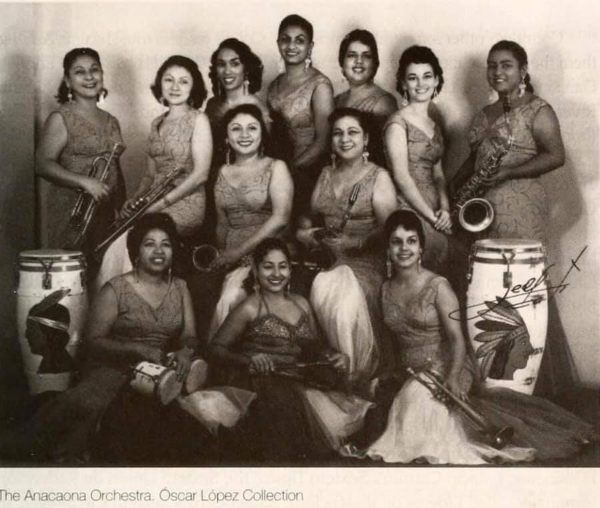
Pendant la seconde guerre mondiale et les années suivantes, elles sillonnent l’ensemble du continent américain, Nord et Sud.

Argimira "Millo" Castro à la batterie & Nena Neyra à
la tumbadora. Anacaona
1951
Certaines sœurs se découvrent d’autres destins et abandonnent
le groupe, ce qui entraîne des recrutement en
dehors des sœurs Castro.
Un cas remarquable est celui de Millo Castro, la principale attraction de l’orquestre, une bongocera prodigieuse dès l’âge de 15 ans, que Dizzy Gillespie voulut recruter. Mais elle préféra rester à ce moment avec ses sœurs. Selon les besoins, elle jouait avec l'orchestre bongo, tumbadoras ou batterie. Plus tard elle vécut momentanément aux USA. Elle joua pour le couple présidentiel Roosevelt à la Maison Blanche pour l’anniversaire du président. Elle abandonna l’orchestre en 1953 pour se marier et vivre en Allemagne. Et décéda finalement à La Havane après un retour à Cuba et des retrouvailles avec ses sœurs et l'orchestre.
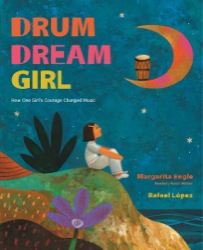
« Drum Dream
Girl ». Livre pour enfant de Margarita Engle &
Rafael Lopez inspiré du destin de Millo Castro

Les sœurs Castro avec Millo enfant tenant une caisse
claire caisse
Alicia Castro (née en 1920) reprend la direction à la mort de Concepción.
Entre autres membres, les chanteuses
promises à une grande destinée :
—
Graciela, (Graciela
Grillo Pérez, La Havane 1915 - New-York 2010) sœur
du maraquero, chanteur et chef d’orchestre Machito, future reine du
mambo ou encore « première dame du jazz
latino », intégrée en 1935. Elle pensait que sa
sûreté en jouant les claves, tout en chantant, lui
avaient ouvert les portes pour chanter avec Anacona. Sa
fascination pour les claves et le chant lui était venue
enfant, en écoutant chez
elle les répétitions de María Teresa Vera et le Sexteto
Occidente (dont Machito faisait partie). Elle
quitta Anacaona en 1941 et rejoignit New-York en 1943
pour remplacer son frère, lequel avait été enrôlé dans
l’armée. Elle y devint la première étoile cubaine à
New-York précédant La Lupe et Celia Cruz[20]
— Celia Cruz, autour de 1947, en particulier pour une tournée au Venezuela.
—
Moraima Secada
(Villa-Clara 1930 - La Havane
1984). Elle
intègre Anacaona en 1950 et rejoint Las d’Aida en 1952
avant de commencer une carrière soliste en 1960.
— A la suite de Haydée Portuondo, prend le relai sa sœur Omara Portuondo. Elles s'étaient auparavant toutes deux familiarisées avec Anacaona dans leur carrière de danseuses. Recrutée pour une tournée d'Anacaona en Haïti en 1951 Omara Portuondo y apprend les percussions : petites percussions, tumbadora et même batterie. En Haïti, elle commence à s'affirmer comme chanteuse soliste tout en jouant tumbadora et batterie. Elle y côtoie Moraima Secada avec qui elle rejoint ensuite Las d'Aida.

Une instrumentiste qui commença sa carrière dans Anacaona à l'âge de 12 ans, Luisa Cotilla, devint par la suite "La dame de la trompette". Après avoir joué avec Ensueño (dernière période) et Pacho Alonso dans les années '50, elle s'exila en Europe en 1960 et constitua sa propre formation en Espagne, le Conjunto Cubano puis continua sa carrière comme soliste à Amsterdam.
Les dernières sœurs Castro prennent leur retraite en 1987. La bassiste Georgia Aguire, qui — en même temps que sa sœur saxophoniste Dora — avait travaillé comme pianiste dans l’orchestre depuis 1983 sous la direction d’Alicia Castro, reprend la direction en 1987 et reconstitue le groupe avec une nouvelle génération de musiciennes. À ce moment Anacaona est le seul orchestre féminin en activité sur l’île.[21] Cela changera avec les années ’90.
Plus
sur Anacaona, de 1932 à 2018,
http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/anacaona.htm
Plus
sur la première génération des orchestres féminins
Cubains.

Trovadoras del Cayo
Isolina Carillo
commença à jouer publiquement du piano en 1917 à dix ans
(dans un cinéma pour un remplacement) et prend ainsi
place parmi les premières instrumentistes
professionnelles femmes de Cuba. Elle jouait aussi la
guitare, le tres,
le bongo, l’orgue et eut une carrière de professeur
de chant. Elle est auteur d’environ… 200
compositions !
—
Dans les années ’40 elle créa une autre formation
féminine, le Conjunto
Vocal Siboney, qui fit des tournées en Amérique
latine.[22]

Isolina Carillo
La liste de la première génération des orchestres
cubains, que nous avons interrompue avec l'arrivée
d'Anacaona dans ce paysage, n’est pas encore close.
Citons :
— Orquesta Ilusión, de 1933 avec pour directrice Alicia Seoanes.
— Hermanas González.
— Hermanas Estupiñán. De Madruga (Province de La Havane).
La plupart des chanteuses et musiciennes de ses
formations, qu’il s’agisse de duos, de trios ou
d’orchestres pratiquent les petites percussions.
Apparurent avec ces orchestres des femmes jouant le
bongo, les timbalès, la batterie. Il est remarquable
que la directrice du premier orchestre féminin
répertorié fût timbalera.
Ces formations ont pu avoir la fonction d’école de
percussion pour les chanteuses, comme en a témoigné Omara Portuondo qui a appris les percussions
dans Anacaona.
— Mais en 1942 elle fonde avec Alicia Yanes (guitare et voix seconde) et Coralia Burguet (guitare et première voix), la formation Lecuona Cuban Girls, pendant féminin des Lecuona Cuban Boys. Les Lecuona Cuban Girls débutent en grand au Casino Nacional, et jouent dans des lieux courus comme l’Hotel Sevilla, au Sans Souci, à la radio, dans les théâtres Encanto y Campoamor, obtenant immédiatement des contrats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Comme danseuse, un des titres de gloire de Margarita Lecuona est d’avoir chorégraphié et dansé la composition Siboney de son oncle illustre. Son œuvre la plus connue est le hit afro « Tabú » (1941) créé pour un spectacle pour lequel elle fut la compositrice, l’interprète, la dessinatrice des costumes, la manager, le metteur en scène… et directrice! Margarita et Ernesto Lecuona, d’extraction bourgeoise, ont en commun un héritage classique mêlé à une proximité avec la culture afro-cubaine, acquise dans leur quartier Guanabacoa, haut-lieu de l'afrocubanité.

— Orquesta Tropical : un orchestre féminin de La Havane des années '40, dont seule est connue une photo avec deux tumbadoras portée, outre des petites percussions et un bugle.
De Santiago de Cuba à Pinar del Rio en passant par Las Villas et Santa Clara
De Pinar del Rio :
Roberto
Garcia en recense d’autres, de Pinar del Rio
également :
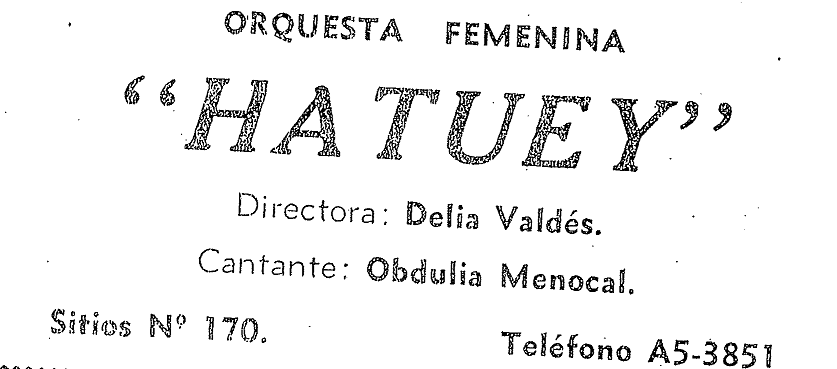
— Septeto Casiguaya, de Camajuaní, province de Las Villas. Septeto & sexteto féminin pionnier, portant le nom d'une héroïne taïna (aborigène) pendue par les espagnols, fondé comme sexteto en 1928, avec Sara Aguilar piano & direction, Blasina Deschapelli chant, Marta Aguilar voix & maracas, Juanita Montejo marimbula , Alfonsa Casalla bongó, Titico très, qui se désintègre à la fin des années '30, non sans avoir substitué auparavant la contrebasse à la marimbula biographie en français (montunocubano)

—
Caracusey
de Conchita Hernández.
—
Caunabo
de Hilda González.
A
Remedios (province de Villa Clara) :
— Orquesta Alegria de Blanca, dirigée par Blanquita del Pozo.

Une conséquence inattendue de cette armée de
musiciennes passées par les orchestres féminins,
dotées souvent d’une bonne formation est qu’elles
contribuèrent largement à constituer la Philharmonie
puis l’orchestre symphonique national cubain.
Le phénomène états-unien des orchestres féminins suit d’une décennie celui des orchestres féminins cubains (dont certains ont suscité des vocations ou au moins des exemples dans leurs concerts aux États-Unis). Dans ce cas, c’est avec la seconde guerre mondiale et la pénurie de musiciens suite à leur enrôlement militaire qu’à été offerte une place vacante pour constituer les formations féminines…

Oscar López avec des danseuses de Las Mulatas del Fuego © Collection Oscar López
Danse et musique : Las Mulatas del Fuego
— Il pourrait paraître s'éloigner de notre sujet de mentionner à ce stade Las Mulatas del Fuego, groupe chorégraphique créé à l'initiative de l'entrepreneur de spectacle Rodney, créateurs des shows du Sans-Souci puis du Tropicana. Ces Mulatas del Fuego créées en 1947 devinrent pour des décennies la référence de la rumba de cabaret. Mais il serait tout-à-fait injuste de d'oublier la dimension musicale de la formation. Dans ses débuts, il y a six danseuses mais aussi trois chanteuses, plus une qui n'est rien moins que Celia Cruz (entrée en 1947 ou 48 selon les sources). Y apparaissent d'autres figures de la musique cubaine. La future maman du chanteur Issac Delgado, Lina Ramírez est une des quatre fondatrices. Rapidement, entre Elena Burke, à la fois danseuse et chanteuse dans la formation. Egalement Omara Portuondo . Cette formation était en fait à géométrie variable selon les nécessités des spectacles (cubains ou internationaux, en particulier au Mexique, tournées ou prestations filmiques et a subi nombre de changement dans ses participantes. Article en espagnol de Rosa Marquetti sur Las Mulatas de Fuego (esp.)
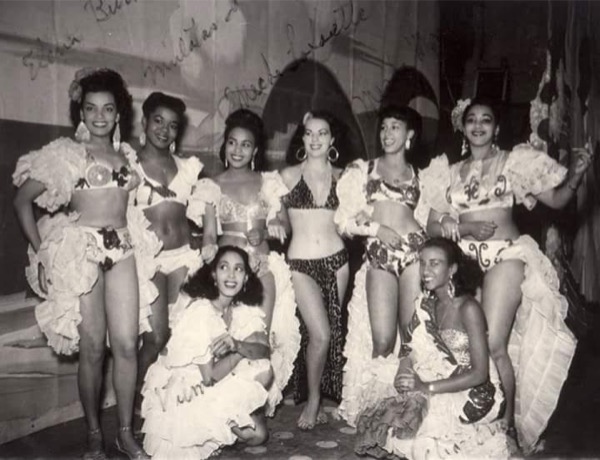
— Las d’Aida
En effet, ces année seront marquées par l’extraordinaire Cuarteto Las d’Aida fondé en 1952, basé sur le chant à quatre voix. Formé par Haydée & Omara Portuondo, Elena Burke, Moraima Secada et dirigé par la pianiste Aida Destro (1928-1973), selon le modèle offert par le Cuarteto d'Orlando La Rosa. Le cuarteto avait été imaginé come une formation mixte, mais la suggestion d'Omara Portuondo d'y faire entrer Moraima Secada, avec qui elle avait travaillé dans Anacaona en décida autrement. Et l'exigence de qualité au sein du cuarteto fit dépasser le modèle. La première prestation de Las d’Aida est dans un programme télévisé "Carusel de las Sorpresas", avec un accompagnement de contrebasse. La formation grave son premier disque en 1957 avec la Orquesta de Chico O'Farril pour la RCA Victor. Elles voyagent à New-York (programme de télévision de Steve Allen), Venezuela, Mexique, Argentine, Puerto Rico. Le cuarteto accompagne Nat Kink Cole au Tropicana. Pianistes et formations de premier plan se mettent à leur disposition pour les accompagner : Bebo valdés, Peruchín, Guillermo Barreto , los Hermanos Escalante...
Son style initial est le feeling, déjà exploré par sa directrice —qui avait acquis ses connaissances de l'harmonie en dirigeant un cœur d'église prebytérienne (celle de la calle Salúd)— mais fait des incursions dans la fusion pop dans les années ’60, voire twist ! comme en témoignent des archives de la télévision cubaine. Aida Diestro y découvre les véritables qualités musicales d'Omara Portuondo et lui apprit à intérioriser les thèmes et transmettre le contenu de chaque chanson. A chacune, elle demande de se pénétrer des textes et d'entrer en osmose avec le compositeur.
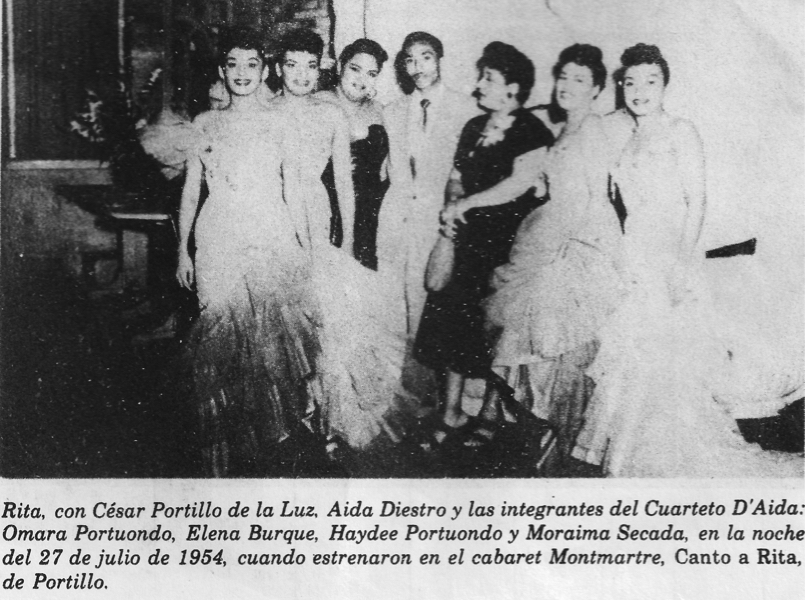
"C'est une université de la musique ; ça m'apparaissait comme si je m'étais diplômée dans une université quand j'ai chanté avec Las d'Aida" (Omara Portuondo, 2004).
Quand Moraima et Elena sont tentées par des
carrières solistes, elles sont substituées par
Leonora Rega et Carmen Lastra, tandis que restent
les sœurs Portuondo. En 1961, aux plus fort des
tensions entre le régime révolutionnaire cubain et
les États-Unis qui aboutissent à la rupture des
relations diplomatiques, Las d'Aida sont à Miami,
elles décident de rejoindre Cuba. Omara y fut une
des fondatrice du Syndicat des Arts et Spectacles.
Haydée décide de quitter le cuarteto, au grand dépit
d'Omara, ce départ entraînant l'entré de Xiomara
Valdés. Haydée désire que sa fille Omarita aille
vivre aux États-Unis, ce qu'elle obtient au cours de
l'opération Peter Pan et la rejoindra en 1967
[24]

Les
voix de Las D’Aida
En 1971, Aida Diestro veut donner une autre dimension au Cuarteto en y faisant entrer les tambours batá joués traditionnellement par trois tambourinaires (Amado Gómez, Juan Pilili González, Alfredo Benítez, Bárbaro Valdés). L'orchestre devient un des premiers à intégrer ces tambours issus des rituels dans un orchestre*.
Les concerts sont accompagnés de tout un orchestre (piano, basse électrique, batterie, congas, tambours bata...) et deviennent de véritables spectacles. Amadito Valdés les rejoint pour jouer la batterie et alternant par la suite timbales et batterie restera jusqu'à la dissolution en 1999. A la mort de Aida en 1973, Teresita García Caturla reprend le rênes de l'exigente directrice — jusqu'en 1998 — et se fait assister par son frère Ramón. Son dernier directeur fut l'estimé Ricardo Pérez, qui avait accompagné pendant vingt ans le quartette au piano.
* avec la Sonoro Matancera : "el ritmo omelencó", Bebo Valdés (un seul bata sur le rythme batanga), Irakere, la Orquesta Revé avec Oderquis Revé (trio de bata réunis et joués par un seul tambourinaire).
On ne peut quitter Las d’Aida sans signaler le rôle
important des femmes dans le mouvement du feeling ou
filin’,
qui ouvrit postérieurement la porte aux
chanteuses-guitaristes de la Nueva Trova.[25]
— Las Hermanas Benítez
Sans doute inspirées par le succès de Las D’aida, tout en s'inscrivant également dans la lignée des célébrissimes Mulatas de Fuego, cinq jeunes sœurs : Beatriz, Beba, Petry, Carmen, Juanita — filles d’un ancien ministre cubain du travail — les Hermanas Benítez forment un groupe vocal qui accède rapidement à la scène internationale et à la télévision mexicaine, initiant des apparitions très commerciales. Après le mariage de la fondatrice Beba Benítez, une sixième sœur plus jeune, Haydee, entre dans le groupe pour garder le quintette. Après deux nouveaux mariages, le quintette devint trio avec un succès médiatique certain dans les années ’60 en Espagne, avant que trois derniers mariages mènent à la dissolution du trio. Juanita Benítez décède en Espagne en 1995, les autres sœurs étant aujourd’hui dispersées entre les États-Unis, le Mexique, l’Espagne et la Suède. Une émission de télévision mexicaine a réuni le trio : Beba, Beatriz & Haydee cinquante ans après leur apparition dans un film de l'acteur comique Cantinflas "Sube y baja", qui fut leur dernière activité artistique.

— Las Hermanas Márquez (cf supra, trio Hermanas Márquez)

Conjunto Hermanas Márquez (probablement New-York 1966). Collection Roberto Garcia
— Ensueño Tropical
On doit à Patrick Dalmace et à son site montunocubano.com, d'avoir mis au jour l'histoire d'un groupe féminin cubain oublié, qui a pourtant connu le succés dans les années '50 et '60 : Ensueño Tropical. La naissance de ce conjunto peut prendre source dans les années '30, mais il est possible qu'il y ait des confusions avec le groupe pionnier Ensueño. Sa directrice fut la pianiste Zoila "Nereida" GONZÁLEZ. Nereida et la trompettiste "La Gorda" se taillent un franc succés personnel en tournée du groupe à Buenos Aires. Dans un 45 tours enregistré en Espagne (cf Deezer) le groupe est accompagné par l'orchestre du péruvien Alberto Cortés.
Source : monunocubano.com

Lien : http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/ensueno%20tropical,%20orquesta.htm

—
Las
Hermanas Valdivia. Cuarteo vocal
composé des sœurs Nancy (1934), Rina (1931) et
Idalia (1932) Valdivia —et de leur nièce Nielvis—
originaires de la localité de San Germán, de la
province d'Holguín. Nielvis
a ensuite été remplacé par Mery Mujica.
Elles ont commencé leur travail artistique à La
Havane en 1957 dans le but de diffuser la musique
populaire cubaine et
ont nourri leur répertoire avec des chansons,
des boléros, des guarachas et des chachachás.
Elles ont participé à des festivals nationaux et
internationaux tels que le XI Festival Mondial de
la Jeunesse et des étudiants et la chanson
internationale Varadero '70, ainsi que des
émissions de radio et de télévision. Elles ont
fait des présentations dans des cabarets, des
enregistrements et des tournées artistiques au
Venezuela. Elles ont arrêté leur vie artistique en
1989.

— Le procesus de formation d'orchestres à partir de duos ou autres petites formations a connu un exemple inverse avec la formation des Hermanas Castro au début des années '60, Ada et Alicia Castro, artistes très expérimentées de l'Orquestre Anacaona (lequel dès le début, dans ses différents format aurait pu prendre le nom d'Hermanas Castro). S'emparant du répertoire de la trova, elles parcoururent le circuit des Casas de la Trova y compris celle de Santiago. Cela correspond à un moment où après les fermetures de salles et cabarets après la révolution cubaine, Anacaona connaissait moins d'activité. Parallèlement au duo voix et guitares, Alicia était entrée comme contrebassiste dans l'Orchestre de l'opéra de La Havane. Détails et photo sur la page http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/anacaona.htm
— Le pianiste, qui se révélera également vocaliste, "Meme" Solís créa, au début de sa carrière un cuarteto vocal composé des chanteuses Lili García, Osiris Aguilar Valdés, Bilin Cabrisas et Francis Domenech, qui se produira dans les cabarets (ex. : Venecia de Santa Clara, 1956). Il accompagnera par la suite Olga Guillot, Esther Borja, Xiomara Alfaro, Renée Barrios, Helena Burke et des formations féminines comme le Cuarteto las d'Aida, Las Hermanas Lago, Las Capelas, Las Hermanas Valdivia... En 1960, en pleine vogue des Platters, il crée sous son nom un nouveau cuarteto vocal de grand impact national, mixte cette fois-ci, autour de la voix de Moraima Secada.
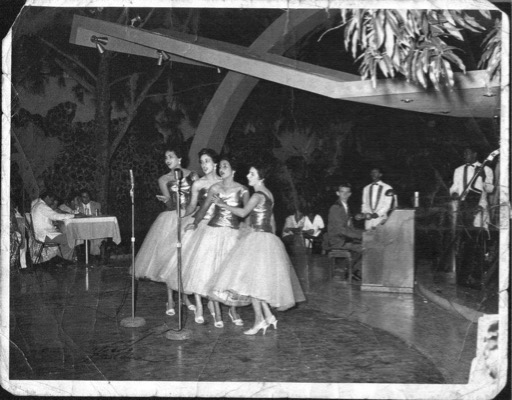
DE NOUVEAUX GROUPES FÉMININS VOCAUX A PARTIR DES ANNÉES '90
Les années 1990-2000 voient l’émergence de
nouveaux groupes vocaux féminins : Gema
4 ou Camerata Romeu à La Havane ou encore Claras Luces à Santiago de Cuba, parallèlement à un essor important
des chœurs et la création de festivals
choraux.
— Gema 4, fondé en 1991 avec comme directrice Odette Telleria Orduña (1972), est remarqué pour son haut niveau d’interprétation et une manière bien particulière dans l’harmonisation des voix. Le groupe a parcouru l’Europe et les États-Unis, avec des contrats prolongés en Espagne, où il a réalisé deux CD au milieu des années ‘90.
— Vocal Universo reprend depuis Pinar del Rio la tradition des quartettes vocaux féminins cubains à l'instar de Las d'Aida. Créé en 1998, le groupe dirigé par Jacqueline Ramírez est invité dans plausieurs pays caribéens et latino-américains. (Aucun point commun avec Vocal Universo d'Uruguay).
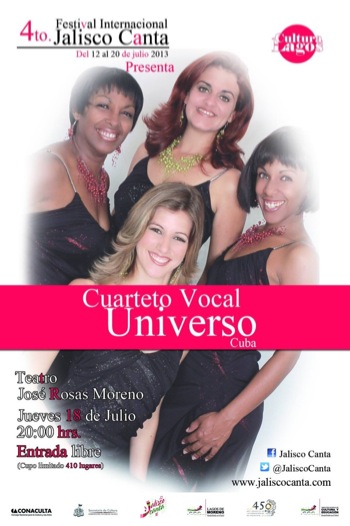
Santiago de Cuba, qui jouit d'une forte tradition des chœurs, entretenue par le maestro Electo Siva — longtemps à la tête de l'Orféon Santiago et créateur dans cette ville du festival international de chœurs — connaît actuellement plusieurs groupes féminins vocaux en particulier :
— Vocal Divas, fondé en 2000 à Santiago de Cuba. Directrice & voix soprano : Silvia Margarita Calzado (1970). Sa directrice reste la seule fondatrice du groupe, entièrement remanié en 2011.
Vocal Divas (2017)
— Cuarteto Vocal Vidas. Ana Hernandez Rosillo (soprano, directrice générale) forme à Santiago de Cuba en 2011-2012 le groupe Vocal Divas avec avec les chanteuses Maryoris Mena Faez (contralto, directrice musicale), Koset Muñoa Columbié (mezzo, auparavant de Vocal Divas), & Annia del Toro Leyva (contralto). L'Etats-unien Robin Miller, les remarque en 2014 et produit un documentaire "Soy Cubana" présenté dans de nombreux festivals, où il obtient plusieurs prix (cf trailer dans le lien). Le film retrace des scènes de la vie quotidienne des membres du groupe. Le groupe Vocal Vidas a reçu un prix Cubadisco en 2016 pour son album "Canción y Vida". Le groupe s'est produit en Espagne, Alemagne, Venezuela, France métropolitaine, Guadeloupe, Mexique et Equateur.

Vocal Vidas (DR)
— Vocal Adalias, Quintette fondé en 2001, longtemps parrainées par l'Alliance Française de Santiago de Cuba. Directrice : Raizary Mariol Ramirez. CD EGREM : "Santiaguerason".
Egalement à La Havane :
—
Sexto Sentido,
fondé à La Havane en 1997 trouve une
personnalité très affirmée en tant que
groupe féminin vocal.
Les
quatre fondatrices, toutes nées en 1982,
sont Arlety Valdés, Eliene Castillo
(remplacée en 2012 par María Karla Pérez),
Melvis Estévez (remplacée en 2010 par Wendy
Vizcaíno, fille du percussionniste de même
nom) & Yudelkis Lafuente. Leur
répertoire combine Bossa
Nova, Latin-Jazz, R&B, Soul et un
cachet particulier dans le son & la
salsa. Vingt ans après
cette fondation, la qualité artistique des
vidéos joint à un style particulier et
élégant du groupe expliquent un phénomène
viral sur les réseaux sociaux. [34]

—
Vocal
tres. Trio vocal havanais fondé en
1998.
Le premier groupe de rap cubain féminin : Instinto. Avec Janet Díaz (1974), direcrice, Doricep Agramonte (1975) & Judith Porto (1973). Elles se firent connaître lors du premier festival de rap havanais de 1996. Elles associèrent le rap à d’autres expressions, comme les chants afro-cubains issus des rituels et le lyrique. Elles poursuivent aujourd’hui des carrières personnelles.
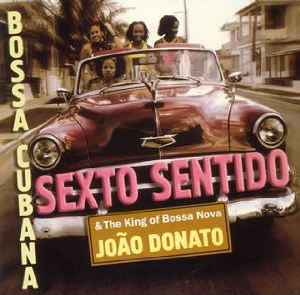
Premier
CD de Sexto Sentido, produit en Russie (2004)
Dans le domaine de la composition
contemporaine se distingue Tania León, née en 1943 à La Havane, résidente aux États-Unis depuis
1967, pianiste, chef d'orchestre et
compositrice cubaine. Elle est devenue l'une
des personnalités majeures de la vie musicale
américaine. Certaines de ses œuvres mettent en
relief la percussion cubaine, à l'instar des
pionniers Amadeo Roldán (Paris 1900 - la
Havane 1939, premier compositeur mondial pour
percussions seules) & Alejandro
García Caturla (Remedios 1906 - Villa Clara
1940). Ainsi
: Ritual, 1987, Batá, 1985, A
la Par (pour piano & percussion), 1986.
Elle est nommée ambassadrice culturelle des
États-Unis à Madrid en 2008.[26]

Tania
León
En ce qui concerne
les orchestres
féminins de son
des années 2000 peuvent être
cités :
—
Así Son
(septeto,
cordes & percussions), majoritairement
féminin. Fondé par
le guitariste Vicente Lerro Fong. Sa
première bongocera fut
: Lina López Hernández, alias "la rubia
del sabor cubano"
— Morena Son. Fondé en 1991, à partir de quelques membres d'une première tentative de groupe féminin à Santiago de Cuba, Tradición Morena, à la suite de la dissolution de ce dernier. Directrice : Aimé Campos. Ce septeto au répertoire de son et trova bénéficie de l'intérêt pour la musique traditionnelle cubaine deans les années '90 et voyage en Italie, Angleterre, Allemagne, Belgique, Hongrie, France (dont 2012), Autriche, Hollande, Isles Canaries, Espagne, Suisse & Belize. Elles présentent en 2018 un nouveau CD, "Lo que traigo yo" produit par Alain Pérez (EGREM).
—
Septeto Las Perlas del Son
(Santiago). Cette
formation de sept musiciennes adopte en fait
le format du sexteto.
Elle apparut en 1995, avec un répertoire du
son traditionnel de Santiago et des
autres particularités locales (conga,
merengue). Elle fit une tournée aux
États-Unis en 1999 et se distingue
admirablement dans la vie musicale de
Santiago de Cuba en revisitant les sources
du son.
Cette fidélité ne va pas sans un impact
international avec ses voyages au Canada,
Australie, Japon et Mexique.
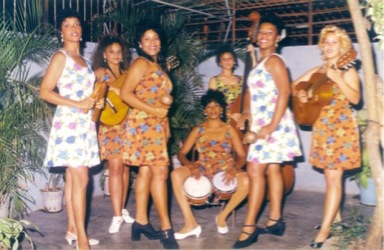
Las
Perlas del Son. Photo du label Corason.
—
Okán
de Santiago de Cuba fut rejoint un moment par
la chanteuse Nancy Garcia Vinent, avec qui se
fait un enregistrement. Le groupe fit ensuite
des tournées en Europe (2009 par exemple).

Okan
en tournée européenne (Hollande)
—
Encore en Oriente, le Septeto
Éxtasis Son de
Guantanamo qui a eu une
flûtiste à la place de
trompettiste.
— Grupo Café, de La Havane, sexteto avec flûte traversière, qui reprend entre autres des compositions de Compay Segundo.
—
Septeto Vida,
de Santa Clara.
—
Ad
Libitum de Cienfuegos est un cuarteto de
son,
tendance « symphonique ».
—
RaSon
de Villa Clara. S’y
distinguent aux percussions Yenisley Rivero
López (congas, percussion, voix) et Bárbara
Daimé Martín Basulto (pailas), par ailleurs
professeur d’école professionnelle de musique.[27]
Le Changüi
Le style changüi
a eu aussi son orchestre féminin et en a
actuellement un nouveau :
— La Guantanamera (fondé le 25 avril 1998) est un groupe féminin de Guantánamo, avec instrumentation et répertoire de changüi, qui fut patronné par le musicien, musicologue et promoteur culturel Santiago Moreaux Jardines (1943 - 2009). Le groupe devint professionnel et fit des émissions de radio et de télévision à Guantánamo & Santiago de Cuba, tout en participant à de grands événements et aux festivités de carnaval. Il a aussi travaillé à La Havane, où il était mené par la marimbulera et vocaliste Lissete Monferrer García. Il n'est plus en activité.

— Las Flores del changüi est la seule formation féminine actuelle du syle changüi. Elle est composée de 7 musiciennes : tres, marimbula, bongo de monte, maracas, guayo et deux chanteuses. Auxquelles il faut ajouter et un couple de danse. Elle a été fondée par Floridia Hernández Daudinot en 2007 à Guantanamo. Floridia, grandit auprès d'une grand'mère tresera dans une montagne à la vie rythmée par ses fêtes de changüi. Elle va ensuite vivre dans la ville de Guantanamo où elle rencontre Chito Latamblet qui lui enseigne le tres à partir de ses 9 ans. Elle s'intègre dans des formations masculines de changüi jusqu'au moment où elle décide de fonder Las Flores del changüi. La chanteuse principale est Yasmin La Rosa Pozo.
A Guantánamo, doit être mentionnée également
la bongosera
Dailín
Márquez Planche (1er prix de bongo du
Festival de changüi 2005). Percussionniste
formée au conservatoire de Guantánamo, elle
s’affirme très jeune comme bongosera
de changüi dans le groupe de Celso « el
guajiro » de Yateras (elle n’avait pas
encore l’âge requis pour recevoir un prix au
1er Festival de changüi de 2003, ou elle
participa la première fois au concours). C’est
la première femme à avoir été récompensée
comme musicienne dans les festivals de
changüi. Elle a continué sa carrière à
Varadero.[28] En
particulier dans la formation féminine Alma
en Clave, en quarteto ou quinteto
qui a sa propre chaîne youtube.

Dailin Marquez Planche - Festival du changüi - 2005 - Photo Daniel Chatelain
L'orgue oriental

Avec l’apparition des orchestres de timba dans
les années ’90 se forme une vague d’orchestre
féminins représentatifs de ce style, ou
naviguant entre salsa et timba. Leur phare
cubain est le groupe Anacaona rénové, qui
lui-même se met à emprunter à la timba. Mais
le succès international du groupe dominicain
Las Chicas del Can, centré sur un répertoire
de merengue comme il se doit, a dû donner des
perspectives et espérances aux groupes en
formation dans les temps difficiles de la
"période spéciale" cubaine, avec, pour atout,
des musiciennes bénéficiant de la qualité de
formation des écoles de musique cubaine. Las
Chicas del Can furent crées en 1981 et se
désintégrèrent en 1999.
— Mulatas de Fuego : salsa, timba. Ces musiciennes reprennent le nom du groupe de danseuses et chanteuses créé par Rodney au cabaret Tropicana avant la Révolution, groupe dont la plastique et les talents chorégraphiques ont marqué l’imaginaire lié à la musique cubaine.
—
Grupo Canela,
formé en 1989.
Dirigé par Zoe Fuentes Aldama, timbalera
(de formation classique et universitaire). Ses
participantes sont formées comme sa directrice
dans les universités de musique de Cuba et ont
aussi fait de la musique classique et presque
toutes ont appartenu à la Banda Nacional de
Conciertos, d’où l’apparition de divers
instruments comme le hautbois, la clarinette,
le violon ou la flûte en même temps que les
timbalès, congas, batterie, claviers,
bata,
saxophone et voix.
On retrouve une dimension familiale, comme
dans les premiers orchestres féminins. La sœur
de la directrice, Giselda,
est la bassiste et son frère Jesús est
directeur musical et arrangeur. C’est lui qui
les a induit à faire du latin jazz et à
reprendre des styles comme le pilón
et le mozambique. Une autre membre de la famille Fuentes est
percussionniste, hors de Canela semble-t-il.
Le groupe reconnaît l’appui de musiciens de
renom pour parfaire leur formation musicale
(Carlos del Puerto, Changuito, Luis Manreza…).
Se distingue au bongo dans Canela :
Yordanka Gutiérrez [29]
Grupo
Canela
Après l’enregistrement de plusieurs CD, elles
créent leur propre label en l’an 2000. Leur
carrière nationale et internationale très
dense est retracée (jusque 2005) dans
l’ouvrage de Valdés Cantero.
2005. Près de 30 ans après la création du
groupe, il y a un changement générationnel du
groupe, par exemple avec la présence de la
fille de Zoe Fuentes et du musicien
martiniquais Jerry Spartacus, la flûtiste et
chanteuse Mélodie
Spartacus. Biographies sur
montunocubano.com : fr
/ esp,
—
Son Damas.

Son
Damas
— Las Chicas del Sabor. Aux timbalès au début du groupe : Regla Milagros Abreu (Santa Clara 1970), percussionniste formée par ailleurs au piano et à la composition contemporaine. Elle jouera ensuite avec Son Damas puis Anacaona [30]
—
Chicas del Sol. Fondé
en 1993, le groupe enregistre dès 1994.
Directrice : Juana
Grisel López Linares (1974), bassiste.[31]
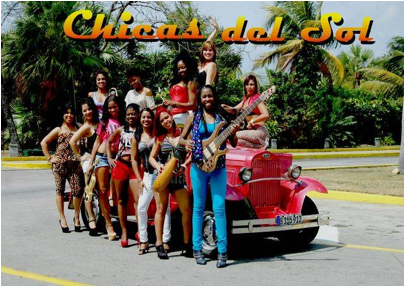
—
Caribe
Girls,
fondé en 1999 est un orchestre salsa havanais
de douze musiciennes dont quatre chanteuses et
deux trombones avec un répertoire de rythmes
cubains, merengue et salsa dirigé par Thiving
Guerra Benitez. Ses premières tournées
furent en Martinique et Guyane et elles ont
ensuite parcouru presque tout l’Europe, dont
la Russie, ainsi que le Mexique et le
Venezuela.[32]

Caribe
Girls
—
Habanera son.
Groupe féminin avec Giraldo Piloto (batteur et
directeur de Klimax) comme mentor.
La fille du timbalero Amadito
Valdés Jr, Idiana Valdés,
y fait ses débuts de chanteuse, avant une
brillante carrière.
—
Musas
son.
Il a été le second groupe féminin où a chanté
Idiana Valdés.[33]
— Ricachá. Charanga fondée à La Havane en 1994. Directrice : Belkis Izquierdo, bassiste — également pianiste — arrrangeuse, par ailleurs musicologue et professeur à l’Ecole Nationale d’Art. Le départ en 2000 de la flûtiste et de la violoniste a eu pour conséquence des fonctions plus larges attribuées aux claviers.
— Lady Salsa Mix est en fait un groupe mixte, dont la présence ici est du coup discutable, avec cinq musiciennes renforcées de trois musiciens (percussion, batterie, trompette), dirigé par le percussionniste Orlandito Mileuna. Il a un répertoire composite basé sur la salsa et les rythmes populaires cubains et abordant merengue, samba et reggae. Ses concerts tirent vers le show avec danseuses et figurant(e)s.
—
Ellas Son
a été fondé à la fin des années ’90. Tamara
Castañeda
y joua les tumbadoras. Le
groupe est originaire de Santa Clara.
Pour la seule province de Pinar del Río, à partir des années ’90 se fondent les orchestres féminins Canvas, Cristal (2002), Almendra & Son Cubanas.
Cristal est un groupe féminin à l'exception du joueur de congas. Le groupe a une audience nationale, du moins à la télévision et adapte à l'occasion des succés internationaux (ex. : Aïcha de J.-L.Goldman).
— Un des groupes havanais féminins les plus récents et abordant une carrière internationale est Mulatason, élargi par étapes de 8 à 11 musiciennes issues des écoles supérieures de musique cubaine. Leurs concerts sont pensés comme des shows. Leur deuxième CD "No vale rendirse", mais le premier sous label est sortfin 2019 sur Bis Music. Mulatason est en tournée en France à l'été 2021. Page facebook.

D’autres orchestres féminins sont cités dans
cette période sans que nous parviennent
jusqu’ici des informations détaillées : Caramelo
Son, Danzonellas, Las Cubanísimas, Indianas,
Chicas Morenas, Las Cecilias, Azúcar, Flores
de Seda, Salsa Morena.
Anacaona continue d’être une figure de proue des orchestres féminins dans les deux dernières décennies, atteignant et fêtant les 85 ans de fondation en 2017et en se produisant sur les lieux originels où jouèrent les fondatrices du groupe, comme le théâtre Peyret et une tournée dans tout Cuba. Nouvelle tournée internationale en 2019.

Anacaona dans la composition de son 85e anniversaire. Photo Marianela Dufar.
Dans les années ’90,
on remarque dans Anacaona la bongocera Leysi Ferrer
(fille du tresiste Felipe Ferrer du Septeto
Habanero). Dans les années 2000 est relevée la
présence des percussionnistes
Isabel
Suárez, au bongo & Yndianis
Quintana
À propos des
percussionnistes femmes de musique latine,
on se doit de nommer la portoricaine
Mirta Silva (1924-1987)
: chanteuse, compositrice, maniant
tumbadora,
bongós,
maracas, clave, timbalès. Elle a été la
première personne jouant des timbalès à
intégrer le syndicat des musiciens aux

Myrta
Silva
Parmi les
percussionnistes cubaines en
activité :
—
Leysi Ferrer
ex-Anacaona (bongo) vit actuellement en
France. (percussionniste et chanteuse de
« Chamaco », percussionniste de
Togo tempo, groupe afro-beat).
—
Bárbara Ferrer,
bongosera
de Dan Den.
—
Liuba García,
congas.
—
María de Los Angeles Lopéz,
bongosera
(Tournée au Japon en 1998).
—
Reina Puebla,
timbalès. Concerts (chant, percussion) aux
USA, France (où elle vit actuellement),
Allemagne.
Le phénomène est fréquent d’instrumentistes
cubaines, en comprenant les percussions,
faisant leurs classes professionnelles dans
des orchestres féminins et poursuivant
ensuite des carrières dans des orchestres
« mixtes ».
De même,
ces instrumentistes passent souvent par
plusieurs orchestres féminins. Prenons
l’exemple de Madeleine Gómez Matos,
tumbadora
de Anacaona, passée par les formations Grupo
Canela, Caribe
Girls, Lady
Salsa[35]
Deux batteuses cubaines sont
particulièrement remarquées ces dernières
années:
—
Yissy Garcia,
qui dirige un
groupe sans une autre femme, Banda
Ancha. Elle a fait partie de Anacaona
(batterie, timbalès, bongo). [36]
— Annette
Guerra, accompagnatrice de Raúl
Paz, de Secreto Cubano et ex-directrice de
groupe (Metis Suwin).
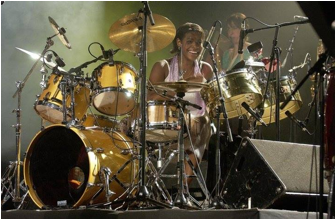
Anette Guerra
En 2014, la saxophoniste canadienne Jane Bunnett réunit sous le nom Maquequé une formation latin jazz féminine où plusieurs instrumentistes cubaines de talent sont aussi compositrices. Leur CD éponyme gagne cette année-là le Juno, catégorie album de jazz. En 2016 sort un second CD : Oddara, avec : Yissy Garcia (batt.), Dánae Olano (p), Melvis Santa (perc., voix), Celia Jiménez (b) & Magdelys Savigne (t. batá, cg). La disque a été nominé aux Grammy Awards de janvier 2018 dans la catégorie latin jazz.
Suite à l'enregistrement de ce CD, Magdelys Savigne, percussionniste originaire de Santiago de Cuba, a été récompensée aux Jazz Awards Station 2016 dans la catégorie percussion, pemière femme à l'être dans cette catégorie.
— Magdelys Savigne est également membre du groupe féminin de mudique cubaine Okan basé à Toronto (à ne pas confondre avec celui de Santiago de Cuba de même nom).
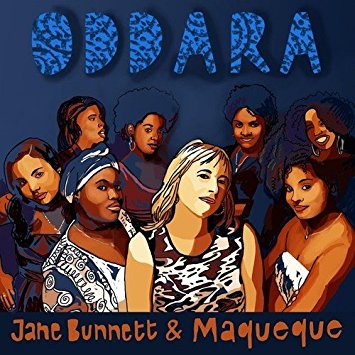
— Le vibraphone a été remis à l'honneur dans les orchestrations de Afro Cuba All Stars en 2017-2018, joué par l'excellente improvisatrice Gliceria González, fille de Juan de Marcos González, le directeur (dans la formation apparaît aussi une sœur de Gliceria, Laura Lydia, à la basse).
Il nous faut
aborder la question du genre dans le cas
des tambours
batas. Les tambours consacrés
étant réservés à des initiés masculins
(omo añá) et les premières apparitions
des tambours batas en dehors du contexte
rituel datant des années ’30, il a fallu
que s’écoule une cinquantaine d’années
après leur apparition publique (laquelle
suivait un siècle de transmission
rituelle) pour que soit mentionnée la
transmission de la tradition de ces
rythmes à des femmes.
La question posée dans les années ’80 à
des maîtres-tambours par des
percussionnistes femmes extérieures à
l’île d’apprendre cette tradition
rythmique (soit au cours de tournées en
Europe ou aux États-Unis, soit lors de
voyages de celles-ci à Cuba) semble
avoir aidé ceux-ci à prendre position.
Pour ceux qui n’ont pas persisté à
refuser, s’est opérée — dans ce domaine
de la transmission —la distinction entre
les tambours profanes et les tambours
consacrés, ceux-ci étant exclus d'usage
féminin pour des raisons initiatiques.
Cette distinction fut le cas de Mililián
Galis (Santiago de Cuba), un des
premiers à s’être déterminé dans ce sens
et avoir entrepris une transmission
systématique à des élèves cubaines ou
étrangères. Les élèves féminines, dont
des japonaises, de Angel Bolaños
témoignent d'une attitude semblable de
sa part[38]
Ce questionnement s’est aussi opéré dans
les groupes professionnels de Folklore,
certaines femmes voulant dépasser leur
cantonnement au chant et surtout à la
danse.
Se manifeste ainsi un phénomène de danseuses afro-cubaines formées à la percussion au début des années ‘90 en particulier à La Havane autour du Conjunto Folklorico Nacional.
Malgré une attribution un peu rapide, habituellement faîte au groupe havanais Obbini bata, selon les informations à notre portée les premières joueuses de batá à Cuba viennent d'Oriente :
— Années 80 - jusqu’environ 1992 : show de batas par une femme percussionniste, Carmen Pratt, à l’hôtel Casa Granda de Santiago.—
Lay
Ferrer Vaillant, une élève de
Gali, jouait les trois batas
rassemblés à Santiago au début des
années ’90. Elle a ensuite continué sa
carrière artistique à Varadero.
À signaler que ce maître-tambour a
transmis ses répertoires rythmiques
afro-cubains à sa compagne Regla
Palacios Castellano, qui est aussi
son assistante en situation de
transmission.
Une autre batalera de Santiago : Nagybe Magdariaga Pouymiró. Sa formation initiale, au cours de 25 ans, s'est faîte auprès d'un maître de La Havane, du maître local Ventura et elle a aussi appris auprès de Gali. Elle a présenté en 2011 le projet d'une nouvelle ritualité des tambours batas pour des femmes, avec des rythmes, des chants et une initiation distinctes de celles des omo aña masculins sous le patronage de l'oricha féminin Ochún (un mouvement parallèle a lieu au niveau rituel rituel afro-cubain de femmes revendiquant une initiation spécifique à Ifa et le titre d'iyanifa, dans un domaine jusque là réservé des hommes babalawo). Le groupe constitué dans cette perspective par cette percussionniste va jusque jouer des tambours de fundamento en 2015 et se fait photographier et filmer ce faisant. Autres membre de son groupe en 2015 : Caridad Rubio Fonseca et Anais López Rubio. Ce jeu de tambours appartenait à un babalawó alaña de la famille Rubio (propriétaire d'un jeu, mais non percussionniste lui-même et d'ailleurs impliqué dans la réforme des iyanifá). Deux ans plus tard, une des deux autres percussionnistes meurt prématurément. Pouymiró se détache du groupe familial auquel elle s'était associée, considère qu'elle s'est exposée à un danger et, si elle ne renonce pas à cet objectif, considère qu'à l'avenir une femme ne doit pas jouer des batas consacrés avant d'avoir reçu le titre de le faire (Vicky Jassey 2018).
À Santiago, le groupe Folkloyuma a innové dans les années ’80 avec un chœur de rumba exclusivement féminin. Cet exemple de « féminisation » semble avoir eu une influence pour arriver à un groupe de rumba et folklore afro-cubain entièrement féminin à Santiago de Cuba : Obini Iraguo.
Obini Iraguo avec Nancy Garcia Vinent en chanteuse soliste
— Obini Iraguo, groupe féminin aussi bien d'afro-cubain — utilisant les batas — que de rumba a été entraîné pendant plusieurs années par un homme : Joaquín Solórzano, percussionniste et joueur de corneta china. Obini Iraguo (ou Obini Irawo) veut dire en yoruba : "Femmes Étoiles". Depuis 2008 environ, Obini Iraguo a changé de direction et ses membres se sont renouvelés. Joaquín Solórzano est devenu directeur des "Tambores de Bonne".
Il existe aussi à Santiago plusieurs femmes percussionnistes jouant les batas sur scène : ainsi dans le groupe Okan (appelé au début Okan Batá ou dans le groupe Galibata (Regla).

Obini
Iraguo (avec le directeur et le roadie).
Photo Daniel Chatelain 2010.
—Obini
Oñi à Cardenas en 2010, dirigé par Dagmaris
Hechavarria Despaigne (ex-membre de
Obini Iraguo de Santiago de Cuba)

À La Havane, Justo Pelladito (ex-Conjunto Folklórico Nacional), fils d’un fondateur de Los Muñequitos de Matanzas et premier enseignant de la percussion afro-cubaine à l’université d’Arts à Cuba, forme en 1991 un groupe de femmes chant-danse-percussion dont il devient directeur et éventuellement soliste :
—
Afroamerica.
Ce groupe transmet (entre autres) un
style peu joué : les tonadas
trinitarias. Ses activités
se répartissent sur les trois dernière
décennies.
Percussionnistes d'Afroamerica : Mercedes Lay Bravo, Marisela Trujillio, Florinda Sabido. CD en 1997 (Suisse). D'autres musiciens se sont agrégés par la suite au trio des femmes percussionnistes et du directeur.
Vidéo Ritmacuba : Afroamerica au début des années '90
— Obini Batá La Havane. Groupe professionnel formé à partir de trois membres féminins du Conjunto Folklorico Nacional en 1993 (ou en 1990 selon une déclaration de Justo Pelladito). Tout en s'affrontant à un certain machisme ambiant, elles bénéficièrent de la transmission de Julio Caballo, El Goyo, ou Mario Jaureguí Aspirina, particulièrement.
Obiní Batá fut fondé par Deborah
C. Méndez Frontela, Mirta Ocanto
González & Eva Despaigne Trujillo,
qui jouaient, chantaient et dansaient.
Depuis 1999, il comporte six artistes
femmes, dirigées par une fondatrice, Eva
Despaigne Trujillo. Au fil des
années se produit un renouvellement des
membres du groupe. Principale
percussionniste : Adairis Amelia Mesa González. [39]

Obini Bata
Interview (français) de Eva Despaigne, retraçant l'histoire de Obini Bata (par Fabrice Hatem)
Vidéo : court-métrage "Obini Bata : una sonrisa para el tambor" (18 mn, esp. non sous-titré)
Dans le court métrage qui lui est consacré, Deborah C. Méndez explique comment la chanteuse Merceditas Valdés, pionnière dans la scénification de la tradition afrocubaine d'origine yoruba, lui a donné le surnom de "dama de la percusión".
— Ibbu Okun se forme à La Havane en 1993 et aborde différents styles de la musique afro-cubaine (Palo, Yuca, Arara) et les différents styles de la rumba. Sa fondatrice et directrice Amelia Pedroso, percussionniste, chanteuse et pédagogue, spécialiste des textes des chants yoruba avait déjà une longue expérience à la fondation du groupe, ayant fait partie de depuis 1985 à Clave Y Guaguancó, et ayant aussi participé à Danza Nacional de Cuba et Danza Contemporanea. Elle se produit avec le groupe aux USA (1995). Elle collabore également avec Lázaros Ros en 1994. Elle meurt d'un cancer en 2000. Aleida Nani, issue d'une famille de tambourinaires traditionnels bien connue, est co-fondatrice. C'est une des premières femmes à avoir joué les tambours batas à Cuba et jour le tambour central, l'iya dans Ibbu Okun.

— Rumba Morena, rélève aussi des répertoire rumba et afro-cubain et a été fondé en 1997 par sept percussionnistes femmes, avec Diunis Valdéz comme directrice. Le groupe est toujours habitué des domingos de la rumba du Callejón de Hamel en 2018. (cf groupe facebook Diunis y su Rumba morena).
— Las Obinis Ache de Cienfuegos dirigée par Elisabeth Oquendo Otero (iyá), complétée par Barbara Pérez Campo (chant), Yipsi Najarro Tartabull (okonkolo), Yeni-Elizabeth Martínez (itotele) : composition en 2015, citée par Vicky Jassey.
Le troisième CD de "Team Cuba de la rumba" du label EGREM porte le titre de "Mujeres en la rumba" (Femmes dans la rumba). Il a été entièrement enregistré par un collectif féminin réuni à partir de toute la nation cubaine par le saxophoniste Germán Velazco et Armando Dedeu. En dehors de chanteuses et percussionistes issues de la tradition de la rumba, ont aussi participé à ce disque des chanteuses reconnues dans d'autre domaines musicaux, ainsi Yuliet Abreu (La papina), Vania Borges, Omara Portuondo, Telmary Díaz ainsi que María Victoria Rodríguez, venue du punto (musique paysanne cubaine basée sur l'improvisation vocale). Ce CD a obtenu le prix Cubadisco dans la catégorie tradition afro-cubaine. Il caractérise une nouvelle marche dans l'avancée des femmes dans un style cubain inscrit désormais au patrimoine immatériel de l'humanité.
En contraste avec les groupes féminins, certaines femmes ayant une maîtrise élevée des tambours batá déclarent préférer jouer avec des hommes, alléguant que la pratique de ceux-ci dans les cérémonies leur permet de jouer à un plus haut niveau. C'est le cas de la matancera Aymé Pelladito de Matanzas (de la famille de Justo et Angel Pelladito) qui a fait partie du groupe mixte matancero Obini Aberíkula créé en 1998, qui fut dirigé par Daniel Alfonso. (témoignage dans la thèse de Vicky Jassey, 2018)

— Fanm Zetwal est un groupe de tradition haitiano-cubaine fondé dans une localité rurale de Morón, province de Ciego de Avila (région centrale de Cuba). Fanm Zetwal signifie "femmes étoiles" en créole. Le groupe est parfois appelé Danza Zetwal. Elles jouent les traditions de la communauté haïtienne, vodu ou gaga, style carnavalesque. Ce dernier style les conduit à une danse tonique et spectaculaire, jusqu'aux exploits physiques : les drapeaux agitent l'air, l'une crache du feu, l'autre soulève une table à la force de ses maxillaires.
Vidéo Ritmacuba : Gagá de Danza Zetwal (Captation de Daniel Mirabeau)
Aux
États-Unis :
—
Sue
Hadjopoulos. Percussionniste
et batteuse d'ascendance
grecque et
porto-ricaine, entourée
familialement de
musiciens elle étudie
d'abord la flûte puis
est co-fondatrice et
timbalera en 1977
du premier groupe de
salsa féminin aux USA, Latin
Fever, composé
de 14 musiciennes et
lancé par Harry Harlow
et y reste deux ans.
Elle fait ensuite une
belle carrière
personnelle, notamment
aux côtés de Joe
Jackson, Cindy Lauper,
Laurie Anderson, Simple
Minds, David Byrne,
Ricky Martin...
—
Nanette
García. Dirige un groupe de bata
féminin. Fut élève de Felipe Garcia
Villamil représentant de la tradition
de Matanzas des tambours batas aux USA
(où elle est peu présente), pendant
sept ans avant la fondation du groupe.
Nous ne savons pas si ce groupe est
uniquement artistique ou s’il joue les
tambours aberikula dans des
cérémonies, ce qui serait inédit et
sujet à controverses ; un article
et un livre de Stefania Capone, où ce groupe est cité, ne lèvent pas cette ambigüité. Selon un
blog de Patrice Banchereau il y aurait
des affirmations très contestables
dans la méthode de bata matancero
publiée par Nanette Garcia[40].
— Melena (Melena Francis Valdes), percussionniste née à Cuba (Marianao, La Havane) est arrivée aux États-Unis à l'âge de 4 ans, emmenée par sa famille et a grandi en Californie. Après avoir étudié la percussion avec Luis Conté, elle est revenue se former à Cuba au sein du Conjunto Folklorico Nacional, puis auprès de professeurs comme Miguel “Angá” Diaz, Roberto Vizcaino Guillot, Yaroldy Abreu, José Miguel Meléndez et pour les batas Cristobal Larraninga & Daniel Alfonso Herrera. Elle enregistre aux congas en 2016, à La Havane, un morceau qui lui est destiné, "La timbera mayor", devenant ainsi la première femme musicienne à jouer au sein du Septeto Nacional de Ignacio Pineiro, depuis sa fondation en 1927. Elle vit actuellement sur la côte Est états-unienne.[41]
— Cocomama (New-York) est un groupe féminin cosmopolite dont le répertoire varie du latin jazz à la timba. Y officient en particulier deux très bonnes pianistes Ariacne Trujillo Durand (Cuba / N.-York) et Nicky Drenner (USA). Et une française, chanteuse, performeuse et arrangeuse, Christelle Durandy. "Quiero" Vidéo officielle Cocomama avec Christelle Durandy
— Robyn Lobe et le groupe Bataleras.

60e anniversaire de Robyn Lobe © 2012 Martin Cohen - DR.
En Suisse :
— Okan Iya est un groupe féminin de Musique et Danses Afro-Cubaines dirigé par Reinaldo Delgado "Flecha" et localisé à Genève. Lien : page facebook
En Espagne :
— Madelín Espinoza Martínez, née à La Havane, est venue tardivement aux percussions malgré un père percussionniste au départ peu favorable à une telle vocation... et un peu grâce à un frère également également percussionniste. Etablie en Espagne, elle développe le jeu à trois et quatre congas, avec une activité intense de professeur de percussions (prof. du festival Percufest). Passée par plusieurs orchestres féminins elle joue dans le quartette féminin "Chicas de La Habana" avec Hilda Rosa (Direction et basse), Rolaine Phinney (Voix et petites percussions) & Joanna González (piano), groupe qui n'hésite pas à se confronter à des compositions latin jazz de haut niveau en dépit de son petit format.
En Allemagne :
— Dorothee Marx, élève de Milián Gali aux batas et autres percussions afro-cubaines a développé des activités autour de la percussion aux côtés de son mari, le percussionniste colombien Daniel Basanta (aujourd'hui décédé). Fondatrice et directrice de la conga "alemana" Takatún, constituée majoritairement de femmes élèves de "Dorotea", qui a participé à différentes reprises au Festival del Caribe à Santiago de Cuba. Les fondateurs de Takatún ont été, en même temps que ceux de Ritmacuba, au sein d'un même cortège, les premiers étrangers à défiler à Cuba en formation carnavalesque de conga oriental (1992).
Quelques percussionnistes femmes
de musique cubaine en
France :
En ce qui concerne l’enseignement des percussions afro-cubaines, dont les batas, se doit être mentionné le rôle précurseur de Claire Gautier (élève de Mililián Galis à la fin des années ’80) dans la banlieue sud de Paris. Elle a dû ensuite abandonner sa pratique des tambours.
Mais les tambours batas ont été introduit en France au milieu des années '80 par des percussionnistes nommés Roger Fixy, Arnold Moueza et Christian Nicolas, tous les trois d'origine antillaise, à l'origine des groupes afro-cubains traditionnels et rumba Iluyenkori et - pour le dernier cité - Macoubary. Iluyenkori a été co-fondé par la chanteuse et danseuse Daniela Giacone.
— Daniela Giacone se fait aussi conteuse en fondant en 2005 le groupe féminin afro-cubain TANA. Entourée de trois joueuses de tambour bata et autres percussions afro-cubaines (Magali Boucharlat, Diana Huidobro, Betty Rojas), elle conte, chante et danse la création du monde et les aventures des divinités du panthéon yoruba : les orichas.

— La percussionniste et choriste Betty Rojas, née aux États-Unis, d’ascendance cubaine, s'est installée à Paris où elle se perfectionne dans la percussion-afro-cubaine avec les piliers de cette musique présents dans la capitale. Elle participe à des tournées de Rumbanana, accompagne la chanteuse afro-cubaine installée en France Marta Galarraga et joue entre autre avec le jazzman Leon Parker.
— Magali Boucharlat, se forme à Paris (auprès d'Orlando Poleo) et à La Havane à la percussion afro-cubaine et à la rumba. A son retour de la capitale cubaine elle intègre Yemaya La Banda aux congas et bongo (album Salsaloca au féminin). Puis TANA dans le domaine afro-cubain traditionnel. Elle joue également avec les groupes Chevere que Son.
— La percussionniste et chanteuse Natascha Rogers, d’origine américaine et néerlandaise, installée à Bordeaux y étudie la percussion et reçoit l’enseignement de maîtres cubains dans ses voyages à Cuba : Maximino Duquesne, Alberto Villareal, Ernesto Gatel «El gato». Elle participe au groupe Bailongo (répertoire cubain et portoricain). L’auteur a pu aussi apprécier sa participation à des concerts de Sandunga Latina. Elle a entamé une carrière de chanteuse soliste et enregistré un CD.
— La percussionniste de nom artistique Marion Ceïba, titulaire d’un DEM, de La Rochelle, a formé un quartette à Bordeaux en 2012 ainsi qu’un groupe de voix et percussion afro-cubain féminin : Irawo.
— Une enseignante titulaire d’un D.E. de musique traditionnelle : Raphaëlle Frey-Maibach (Lyon) a reçu la transmission des percussionnistes cubains El Goyo, Alberto Villareal et Gali (au sein de Ritmacuba). Elle est à l'origine du Collectif « Habla Tambores ».
Mais dans cette deuxième décennie
du XXIe siècle, les digues
ont été rompues et une énumération
deviendrait vite trop longue pour le
cadre imparti… Quelques autres noms
vont apparaître cependant avec deux
exemples d'orchestres féminins
français.
Parmi
les groupes féminins de Salsa en
France :
—
La
primeur de « la salsa au
féminin » est revenue aux Rumbananas
fondées en 1994 où Julie Saury
(fille du musicien de jazz Maxime
Saury) tient la batterie. De 2001 à
2007 y chante Patricia Najera (qui
s’était affirmée auparavant dans
l’orchestre big band Mambomania).
Rumbananas a en particulier de
nombreuses prestations télévisuelles à
son actif.

Les
Rubananas avec Patricia Najera
—
Le
groupe Yemaya
La Banda a atteint
progressivement une envergure
internationale. Fondé en 1998 avec 12
musiciennes de diverses nationalités,
il s’inscrit dans le courant de la
« salsa consciente » aux
paroles portées par trois chanteuses
hispanophones d’origine (Espagne,
Chili, Argentine). Le nom choisi est
celui d’une divinité marine, l’oricha
féminin Yemaya. Depuis 2009,
les percussionnistes en sont
Lidia
Ruccio : timbales, Raphaëlle
Rayon : conga, Magali
Boucharlat : bongos.[42]

Remerciements à Claudine Jobet pour son attentive relecture.
Bibliographie générale
(les références datées d'après 2016
sont postérieures à la première
version de l'article):
Jorge
Calderón. María
Teresa Vera, Letras Cubanas, La
Havane, 1986.
Julia Calzadilla. Trío hermanas Lago. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2002.
Stefania
Capone. « Des batá à New York :
le rôle joué par la musique dans la
diffusion de la santería
aux États-Unis. » https://nuevomundo.revues.org/2258
Patrick Dalmace. Les orchestres féminins des années trente http://www.montunocubano.com/Tumbao/info/orchestres%20feminins%20des%20annees%20trente.htm
Mercy
Díaz. « La mujer en la música cubana » http://www.archivocubano.org/diaz.htm
The Díaz Ayala Cuban and Latin American Popular Music
Collection http://latinpop.fiu.edu/
Roberto García. « Las
Orquestas femeninas en Cuba »
Radames Giro. Diccionario enciclópedico de la música en Cuba. Letras Cubanas La Havane. 2007.
Vicky Jassey. "Tambor Reverberations: Gender, Sexuality and Change in Cuban Batá Performance". Thèse. 2018.
Vicky Jassey. "Gender, Sexuality, and Taboo in a Cuban Ritual Tradition". 2019. https://folklife.si.edu/magazine/gender-taboos-cuban-bata-drumming
Lorenzo Jardines Pérez. Chepín, la música de una ciudad. Casa del Caribe, Santiago de Cuba. 2012.
Antonia López Sánchez. Trovadoras . Ed. Oriente 2008.
Pierre
Maraval. Portraits x 1000 :
"Mille Femmes Cubaines" http://www.maraval.org/spip.php?article72
Orovio,
Elio. Diccionario
de la música
cubana Letras cubanas, La
Havane, 1992
Pryor,
Andrea. 1999. « The House of Añá:
Women and Batá ». CBMR Digest 12,
no. 2. : 6-8.
Elizabeth
Sayre. « Cuban
Batá Drumming and Women Musicians: An
Open Question » Center for Black
Music Research Digest Spring 2000. http://musicandculture.blogspot.fr/2008/03/women-and-bat-drums.html
Nora Sosa “Anacaona. 45
años de música”,
Revista Mujeres septiembre,
La Havane.1979.
Luis Tamargo. 2007. « A brief history of Cuba’s
female bands ». Latin
beat magazine.
Alicia
Valdés. Diccionario de mujeres notables en la música
cubana.
Mariposa Estudios. Ed Oriente.
Santiago de Cuba. 2011.
Alicia
Valdés Cantero. Con música, textos y presencia de Mujer. Ediciones UNIÓN. La Havane.
2005.
Raquel Vinat Mata. « De qué callada manera », una mirada desde la historia al discurso musical femenino cubano del siglo XIX. Revista Clave año 16 n°2. 2014. La Havane.
Luis Rovira Martínez. "Orquestas Feminina en Cuba" Revista Musica Cubana n°0. La Havane. 1997.
http://www.mujeres.co.cu/articulo.asp?a=2007&num=327&art=16
http://www.granma.cu/frances/culturelles/26sep-Les
groupes.html
Bibliographie
sur Anacaona :
(sans
titre). http://www.lajiribilla.co.cu/2006/n283_10/memoria.html
Bruce
Bastin. "Notes du CD CD HQCD-27".
J-M. Carrasc. http://www.blogin-in-the-wind.es/2007/12/30/anacaona/
Patrick Dalmace. "Sexteto, Septeto, Conjunto Anacaona" (en français) http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/anacaona.htm
"Anacaona El Sonido de las flores" (mai 2006) : http://lacubamia.blogspot.com/2006/03/anacaona-el-sonido-de-las-flores.html
María del Carmen Mestas "Al compás de Anacaona". Mujeres n°327.
2007. » http://www.mujeres.co.cu/articulo.asp?a=2007&num=327&art=16
mars 2007
Alicia Castro, Ingrid Kummels Queens of Havana : The Amazing Adventures of Anacaona, Cuba's Legendary All-Girl Dance Band. USA. 2007
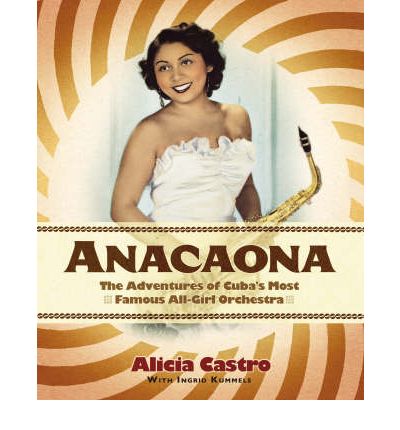
Discographie :
100 Lindas Cubanas. Festival de mujeres soneras. 1995
(enregistré en public en 1994).
Afroamerica
Cuba. Chants et rythmes
afrocubains. CD, VDE-GALLO CD-959, Genève 1997. Suisse.
Anacaona. Septeto Anacaona. L.H. 1937, Harlequin, HQCD
27. Grande-Bretagne.
Anacaona. Anacaona ¡Ay! L.H. 1991, P.M. Records. Grande-Bretagne.
Anacaona. Anacaona. Lo que tu no esperabas. L.H. 2000, Lusafrica. France.
Anacaona. Aniversario 75. Bis Music, 2017, La Havane
Canela. Algo Fresquito.
Canela. Cien Lindas Chicas. ARTEX. Cuba.
Canela. Llego el momento. Welwurden record. Allemagne.
Canela. Échate Canela. Welwurden record. Allemagne.
Canela. Pegando.
Fuencane Productions. Cuba.
Canela. Live in La Zorra y El Cuervo. Fuencane Productions. Cuba.
Canela. Jazzeando a lo Canela. Fuencane Productions. Cuba.
Canela. De fiesta. Fuencane Productions. Cuba.
Canela. Confusión. Fuencane Productions. Cuba.
Canela. De medio lao.
COLIBRI. Cuba.
Chicas del Sol. Chicas del Sol. Deshima Music. Allemagne.
1999.
D'Akokkán, Grupo. Tiembla la tierra. Envidia. Allemagne;
Gema 4. Grandes boleros a capella. Cosmopolitan,
Espagne, 1994
Gema 4. Te voy a dar. PICAP, Espagne, 1996
Las d’Aida. Soy la mulata. Belafont record, Allemagne
1994
Las d’Aida. Cuarteto Las d’Aida. EGREM 1995. Cuba.
Hermanas Marti. Manuel Corona. EGREM, 2001. Cuba.
Las Perlas del Son. Si Senor! Corason Records. 1998 /
2006. México.
Morenas son. Morena Son. EGREM. Cuba.
Morenas son. Cuidaó que te quema. BIS MUSIC. Cuba.
Mulatason. No vale rendirese. BIS MUSIC. Cuba.
Son Damas. Llegó son Damas. EUROTROPICAL 1996. Espagne.
Son Damas. A todo ritmo. BIS MUSIC. 1998. Cuba.
Son Damas, in : 100 Lindas Cubanas. Festival de mujeres soneras, 1995. BIS MUSIC. Cuba.
Vocal Divas. Vocal Divas. EGREM 2001. Cuba.
Vocal Divas. Soy Santiaguera. EGREM 2002. Cuba.
Vocal Divas. Canción y vida. Cuba. Prix Cubadisco.
Yemaya La Banda. Salsaloca au féminin. http://yemayalabanda.free.fr Paris.
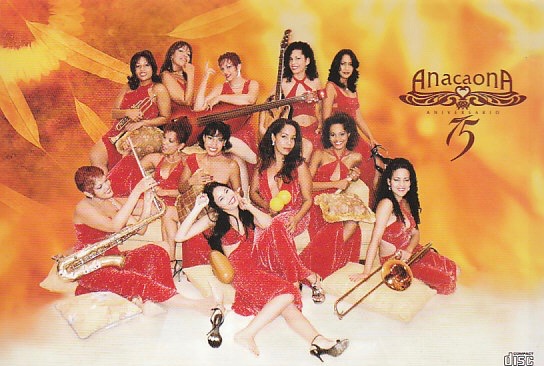
Verso
du CD Anacaona Aniversario (partiel)
Documents
vidéos :
Anacaona.
« 70 años después »
Réalisation Jorge Aguirre .
Citmatel/ RTV La Habana, Cuba.
(N.
B. : Ce premier DVD cité va
plus loin que son titre, car
il part de témoins de
l’histoire d’Anacaona et
d’avis de spécialistes pour
la situer dans le contexte
des orchestres féminins).
Anacaona.
Anacaona. Ten Sisters of Rythm.
Allemagne 2003. Timba
Records.
Anacaona.
DVD promotionnel 2012 (France).
Anacaona.
The Buena Vista Sister’s Club.
USA
Obini Bata Cuba. Conjunto femenino de percusión, canto y danza. DVD. Earthcds partners.
Vocal
Divas. Soy Santiaguera. Produit par
Robin Miller. USA. 2015.
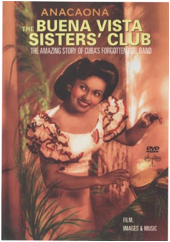
[1]
Malgré
tout
l’intérêt de ce domaine, nous ne
traiterons pas ici des chanteuses
cubaines, innombrables et
largement répertoriées dans les
dictionnaires de la musique
cubaine. Atteignant la dimension
de divas comme l’impériale Celia
Cruz ou « prenant le
pouvoir » sur la scène et les
plateaux comme l’attachante
provocatrice La Lupe (cf
http://www.ritmacuba.com/Lupe-en-Santiago.html),
ou
encore surgie de la domesticité
pour devenir le centre
d’attraction d’une
capitale et un
mythe
romanesque : Freddy devenue
« la que cantaba
bolero » dans Tres
Tristes Tigres de Lezama
Lima, ou, pour en finir avec les
exemples, héroïnes populaires
extraites de la pauvreté rurale
comme Celina González. Ni
même des alter ego femmes des
auteurs-compositeurs
s’accompagnant à la guitare surgis
autour de la Révolution avec la
Nueva Trova et reconnues par le
régime révolutionnaire.
Par rapport à cette place
institutionnalisée des femmes dans
la musique cubaine — ou
contestataire
— et quelque soit le mérite
de la conquête pour l’obtenir,
nous déplacerons un peu les
projecteurs sur d’autres
individualités artistiques, tout
en prenant en compte le phénomène
collectif d’ampleur inédite, aux
origines jusqu’ici assez mal
connues, des groupes féminins.
Pour une approche plus exhaustive
des femmes dans la musique cubaine,
nous
renvoyons au dictionnaire d’Alicia
Valdés figurant dans la
bibliographie.
[2]
« Algo
similar a este fenómeno
contemporáneo de la conga
santiaguera ocurrió en 1852
cuando vino a La Habana la
comparsa del Cocoyé con sus dos
guías, las mulatas María de la O
Soguendo y María de la Luz,
junto al enanito Manuel que
bailaba con el Anaquillé, muñeco
de carnaval. ».
[4] Instrument au son de cloche fait à partir d’une jante de camion ou d’un tambour de frein (D. L.)
[5]
Didier Laurencin « La conga de
Los Hoyos, une tradition
moderne ; Repenser les notions
d’identité et de tradition à partir
d’une formation musicale et dansante
de rue à Santiago de Cuba ».
Master 1 — Université Louis Lumière.
Lyon 2006.
[6]
Chatelain, Daniel & Daniel
Mirabeau : Chants de tumba francesa http://www.ritmacuba.com/Chants-de-tumba-francesa.html
(paru en nov. 2017).
[7]
« Se
cuenta que su amiga de la niñez
Guillermina Aramburu tuvo un
buen matrimonio durante 20 años,
al cabo de los cuales su esposo
la traicionó. Guillermina que
escribía canciones desde
joven... le entregó a María
Teresa su creación Veinte Años,
para que la cantara con la
promesa de que nunca dijera que
había sido escrita por ella;
esto provocó que la mayoría de
las personas desconocieran,
hasta hace muy poco, que la
generalidad de los textos de las
canciones de María Teresa,
son de Guillermina ».
[8]
Ana Nuñez Machín La
otra María : o La niña de Artemisa
: testimonio sobre María Josefa
Granados, precursora de la lucha
por los derechos de la mujer en
Cuba.
La Habana : Editorial Arte
y Literatura, [1975] &
[9]
style où le danzón
est chanté
[11] Aldo Rodriguez : Maria Luisa Anida, una vida a contramano. Testimonio. Letras
Cubanas. 1992.
[12] http://www.montunocubano.com/Tumbao/biographies/d'rivera,
paquito.htm
http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/marquez,
hermanas.htm
https://www.ecured.cu/Tr%C3%ADo_Hermanas_M%C3%A1rquez_(agrupaci%C3%B3n_musical)
[13] Valdés. 2005 (cf bibliographie) / interview par Mayra A. Martínez. 2010 in Cubanos en la Música (ed. Unión) / https://www.ecured.cu/D%C3%BAo_Hermanas_Mart%C3%AD
[16]
Nous
reprenons l’orthographe proposée
par Michel Faligand (fondateur
de la revue Percussions)
pour le français, conforme à la
prononciation et permettant de
distinguer cet instruments des
timbales classiques). cf
http://www.ritmacuba.com/instrumentsCuba.html
[17] « La primera directora de orquesta femenina de
que se tienen noticias se llamó
Irene Laferté, quien tenía un
conocimiento profundo
de la percusión, y en
especial, de los timbales. Fundó
su charanga en 1928 y varias
integrantes de su agrupación
pasaron luego a la orquesta Edén
Habanero, dirigida por Mercedes
Herrera y que tuvo como cantante
a Rosario Martínez. Doña
Irene, a quien llamaban la
virtuosa del timbal, falleció en
l970 después de una fructífera
vida dedicada a engrandecer
nuestra música.»
[18]
Premières intégrantes :
Suseta Ramos (contrebassiste),
Manuela Junco (contrebassiste),
Olga Villazón (saxophoniste),
Ofelia Menéndez (saxophoniste),
Emilia Marcos (saxophoniste),
Blanca A. Foyo (trompetiste),
Nuvia Pérez (chanteuse), Maria del
Carmen Cabeza (chanteuse), Olga
Galú (chanteuse). http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/ensueno,
orquesta.htm
[19]
Valdés 2005.
Article : http://www.montunocubano.com/Tumbao/biographies/mesquida,
mercy.htm
[24] Oscar Oramas Oliva. 2009. Omara, Los ángeles también cantan. Ed Caserón / http://www.montunocubano.com/Tumbao/biogroupes/d%27aida, las.htm
[28]
http://www.youtube.com/watch?v=i8AiOrXBccA
(vidéo Ritmacuba)
[31]
Valdés. 2005 (bibliographie).
[34]
Site officiel : www.sextosentidomusic.com
[36]
http://suenacubano.com/news/8fbc006ea5fb11e3a27e3860774f33e8/yissy-garcia-el-jazz-es-mi-pasion/
Site officiel : http://yissygarcia.com
[38]
Ce phénomène semble avoir eu un
peu d’antériorité au Brésil,
avec une distinction plus
clairement établie dans
l’imaginaire collectif entre
usage profane et religieux, en
l’occurrence pour les atabaques
consacrés du
candomblé : en 1992 pour
mon étude des tambours et
rythmes du candomblé, c’est une
tambourinaire femme vivant au terreiro
du Gantois qui m’a été présentée
comme une des meilleures
spécialistes
de ces rythmes. Conformément à
la prescription religieuse, elle
ne jouait pourtant jamais les
instruments consacrés, réservés
aux hommes, au Brésil comme à
Cuba.
[40]
« The
sacred music of Cuba: Bata
drumming matanzas
style », sans mention
d’éditeur, 1999.
[41]
Site www.melena.com
[42]
Site
yemayalabanda.free.fr
